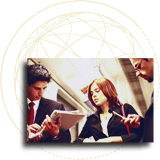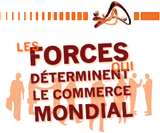- accueil
- nouvelles
- nouvelles 2010
- nouvelles
NOTE:
LES INFORMATIONS SUR LE FORUM PUBLIC QUI FIGURENT SUR LE SITE WEB DE L'OMC
ET LES PAGES DES MEDIAS SOCIAUX COMME FACEBOOK ET TWITTER SONT DESTINÉES
à AIDER LE PUBLIC à SUIVRE LES DÉBATS ET SONT NÉCESSAIREMENT SéLECTIVES.
UN COMPTE RENDU PLUS COMPLET DES SESSIONS SERA PUBLIé SUR LES PAGES DU
FORUM PUBLIC PEU APRÈS SA TENUE
TOUT A ÉTÉ FAIT POUR GARANTIR L'EXACTITUDE DU CONTENU, MAIS IL EST SANS
PRÉJUDICE DES POSITIONS DES GOUVERNEMENTS MEMBRES.
Établi par: des collaborateurs volontaires de l'OMC
Séance 22: Pas de sanctions commerciales souhaitées concernant les questions sociales, mais ?/h2>
TITRE DE LA SÉANCE: Normes sociales et clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords commerciaux: poudre aux yeux, protectionnisme caché ou défense de la cause?
Les intervenants étaient d'accord pour dire que le commerce ne devrait
pas être utilisé comme une sanction pour faire respecter les normes
sociales mais certains, même parmi les pays en développement, ont
considéré que l'OMC avait là un plus grand rôle à jouer.
L'Ambassadeur de la Colombie auprès de l'OMC, M. Eduardo Muñoz, a
demandé instamment aux Membres de l'OMC de se montrer moins réticents à
discuter de questions sociales (y compris du travail et de
l'environnement) dans l'Organisation. Il a dit espérer que, quand le
Cycle de Doha serait achevé, cela ferait partie du nouvel agenda de
l'institution.
Les intervenants ont accepté le consensus général sur la non-utilisation
du commerce comme sanction pour faire appliquer les normes sociales,
mais le chef de la délégation de l'UE auprès de l'OMC, M. John Clarke,
a dit que l'UE avait l'obligation, conformément à ses traités internes,
de promouvoir la démocratie, la règle de droit et les droits de l'homme
dans ses accords internationaux.
Mme Claudia Hofmann, de l'Université de Kassel en Allemagne, a
fait remarquer qu'il n'y avait eu aucune avancée à l'OMC sur la question
du travail depuis la Conférence ministérielle de Singapour de 1996 mais
que 31 pour cent des accords commerciaux régionaux comportaient déjà une
clause sur le travail.
La question soulevée par M. Pradeep Merhta de CUTS selon laquelle
“il vaut mieux avoir un travail que pas de travail du tout” a déclenché
un débat. Il a dit que, dans les pays en développement, un enfant qu'on
empêchait de travailler risquait de sombrer dans la prostitution ou le
désespoir. Il a poursuivi en disant que les enfants inemployés devraient
pouvoir être scolarisés et nourris gratuitement.
Mais d'autres intervenants ont fait remarquer que le débat avait évolué
ces dernières années et que la question aujourd'hui était de fournir un
“travail décent” à tout un chacun. Pour l'Ambassadeur Muñoz, cela
voulait dire une protection sociale et un salaire minimum.
Il a indiqué que l'expression “clauses sociales” englobait les problèmes
liés à l'environnement et au travail et que les pays en développement
acceptaient aujourd'hui davantage leur prise en compte dans les accords
commerciaux. Il a souligné que le commerce ne pouvait pas, à lui seul,
résoudre les problèmes de développement. Il faut, selon lui, que le
commerce s'accompagne de politiques publiques solides, en particulier
dans le domaine social.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 23: Les intervenants regardent au delà du Cycle de Doha
TITRE DE LA SÉANCE: Le renforcement du système commercial multilatéral: une solution pour la reprise économique?
Le but de la séance était de
parvenir à un consensus sur la façon de renforcer encore le système
commercial multilatéral, plus particulièrement dans le contexte économique
fragile actuel de l'après-crise.
Les discussions se sont surtout articulées autour du thème subsidiaire
concernant l'avenir et le rôle de l'OMC après la crise dans le contexte de
l'évolution des forces en puissance. Les principales questions débattues
ont été les suivantes:
-
Un système commercial multilatéral solide est primordial et l'OMC a donné la preuve de sa résilience, en particulier par ses règles qui ont, dans une large mesure, limité les réactions protectionnistes envisagées par certains pays face à la crise économique.
-
Le commerce reste un moteur majeur de la croissance.
-
Il faut conclure le Cycle de Doha pour étayer tout effort crédible visant à renforcer davantage le système commercial multilatéral.
-
Il faut plus de flexibilité à l'avenir, y compris au niveau de l'engagement unique (au titre duquel les pays acceptent en bloc tous les accords découlant d'une négociation).
-
Les liens établis dans les chaînes de valeur mondiales impliquent une libéralisation s'opérant en majeure partie de manière autonome. Il n'y a pas lieu de considérer cette évolution comme négative, même si l'intérêt est incontestable d'en tenir compte au niveau du système commercial multilatéral en transformant la libéralisation en engagements contraignants dans le cadre de l'OMC.
-
Il est nécessaire que les pays sortent des sentiers battus et se concentrent sur d'autres domaines comme le travail courant de l'OMC, l'amélioration des systèmes de notifications, la disponibilité des données, les changements dans les procédures des comités afin de les rendre plus inclusifs, la facilitation du règlement de différends mineurs en dehors du système formel de l'OMC par l'arbitrage ou la médiation, etc.
-
Un nouveau programme de travail portant sur les accords commerciaux régionaux serait peut être nécessaire pour améliorer l'analyse des grandes tendances et, de manière générale, intégrer ces éléments positifs dans le système multilatéral.
-
Le contexte économique est difficile mais il est important de rappeler que, lorsque le Cycle d'Uruguay s'est achevé, la situation économique était comparable.
-
Des propositions ont été faites concernant les questions à examiner après le Cycle de Doha:
1. les obstacles non tarifaires tels que les mesures sanitaires et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce;
2. une libéralisation plus poussée dans les domaines où il restera du travail à faire après le Cycle de Doha comme l'agriculture (subventions), l'accès aux marchés pour les produits non agricoles et les services;
3. la création de valeur dans les pays faiblement développés, en particulier en Afrique;
4. la mobilisation de ressources supplémentaires pour maintenir le système, notamment en ce qui concerne les notifications et la transparence;
5. des améliorations dans les négociations avec les pays désireux d'accéder à l'OMC, en particulier les petits pays pauvres. -
Il est nécessaire que l'OMC renforce ses accords de coopération avec d'autres institutions internationales comme l'OCDE et la CNUCED.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 24: Les experts disent que la réglementation et les règles de l'OMC ont permis au secteur des télécommunications de mieux faire face à la crise
TITRE DE LA SÉANCE: Programme d'action de l'après-crise pour la croissance des économies en développement: libérer le potentiel des télécommunications
Les technologies de l'information et des
communications (TIC) ont bien résisté à la crise financière et la
recherche montre que les télécommunications, en particulier la
téléphonie mobile et le haut débit, peuvent stimuler la reprise et le
développement économique.
Les intervenants ont dressé ce bilan et reconnu aussi de manière
générale qu'une réglementation efficace, “la règle de droit”, doit
sous-tendre les politiques requises pour garantir que les
télécommunications remplissent leur fonction et favorisent la
croissance. Ils ont reconnu que les disciplines commerciales sont, elles
aussi, un instrument important pour une réglementation efficace.
Ils ont cité des recherches estimant par exemple
qu'une augmentation de 10% dans le taux de pénétration des TIC au niveau
des ménages peut entraîner une croissance moyenne annuelle de 0,6 à 0,7%
du produit intérieur brut (PIB). Des chiffres similaires existent, qui
indiquent que la croissance des services haut débit peut aller jusqu'à
stimuler le PIB de 1,3%.
M. Tilmann Kupfer, Vice Président de BT,
Trade and International Affairs, a souligné qu'il était reconnu que les
télécommunications et la “préparation à la mise en place de réseaux”
faisaient partie des efforts nécessaires pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement et que les TIC jouaient un rôle
important dans l'intégration des pays en développement et des pays
développés dans l'économie mondiale.
Il a indiqué que les TIC ont entraîné une nouvelle
vague de dégroupage des processus de production et permis à des
entreprises de compléter les échanges de produits finis avec des
échanges de tâches, ce qui a donné naissance à des services de soutien
administratif et à des centres d'appel, dans lesquels les économies en
développement ont excellé.
Prenant en considération les changements intervenus au niveau de BT pour
s'adapter à ces évolutions, M. Kupfer a estimé que l'OMC et ses règles
applicables aux télécommunications dans le cadre de l'Accord général sur
le commerce des services (AGCS) revêtaient d'autant plus d'importance
que BT était un nouvel entrant sur tous les marchés, hormis celui du
Royaume Uni, et il offrait désormais ses services à des sous traitants
locaux et à des sociétés multinationales.
M. Mike Corcery, Executive
Director for Government Affairs d'AT&T, a dit ensuite que l'AGCS avait
eu un effet de catalyseur sur la libéralisation des télécommunications
et fait d'AT&T un grossiste mondial en connectivité pour les petits
opérateurs de télécommunications et les sociétés multinationales.
Il a dit que l'augmentation du nombre d'acteurs sur les marchés de
télécommunications avait déclenché un cercle vertueux de
l'investissement dans le domaine des TIC et des industries connexes et
que le respect des engagements pris dans le cadre de l'OMC faisait
partie des principales conditions à remplir pour entrer sur un nouveau
marché. Il a cité d'autres critères comme la transparence de l'octroi de
licences, la protection de la concurrence, les prises de participation
ou le contrôle étrangers, et la vaste portée de la libéralisation
favorisant l'innovation.
L'intervenant a soutenu qu'une actualisation des règles et des
engagements favoriserait encore davantage le développement des TIC et
que les outils pour y parvenir incluaient les accords commerciaux, les
groupements économiques régionaux et les initiatives concernant le haut
débit adoptées dans le monde entier.
Le délégué sud africain, M. Wamkele Keabetswe,
a souligné que le secteur des télécommunications était très dynamique et
avait figuré parmi ceux qui avaient le mieux résisté à la crise
financière. Il a dit que la téléphonie mobile en particulier avait
favorisé la croissance économique en Afrique mais qu'il était nécessaire
également de mettre en place des politiques de soutien et une
réglementation adaptées, aussi bien pour les télécommunications que pour
l'activité économique de manière plus large.
M. Keabetswe a indiqué que le lien entre télécommunications,
développement et croissance économique était manifeste et difficile à
contester mais que le problème était d'ordre réglementaire, et il a cité
l'exemple de la nouvelle loi sud africaine sur les communications
électroniques qui avait conféré force obligatoire à certaines parties du
document de référence de l'OMC.
Il a ajouté qu'il était important également que la loi offre des voies
de recours en cas de soupçons d'interventions politiques ou commerciales
auprès du régulateur indépendant.
L'intervenant a dit que les engagements pris par l'Afrique du Sud en
matière de télécommunications dans le cadre de l'AGCS tenaient compte
des difficultés politiques mais aussi du désir d'intégration du pays à
l'économie mondiale. En dépit des problèmes à surmonter, les résultats
avaient été globalement positifs, en tout état de cause pour les
consommateurs. L'Afrique du Sud est devenue exportatrice de
télécommunications sur les marchés des autres pays en développement par
le biais d'investissements étrangers directs.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 25: La recherche sur les accords préférentiels laisse entrevoir des résultats inattendus
TITRE DE LA SÉANCE: “Beaucoup de bruit pour quoi? Les accords préférentiels permettent-ils de créer des échanges commerciaux?”
Le risque de crédit a été plus dévastateur lors de la crise financière
que la faiblesse de la demande. Les accords commerciaux régionaux
seraient susceptibles d'encourager une “spécialisation verticale”, c'est
à dire dans des segments de la chaîne de production. Et la
libéralisation des biens est indissociable de celle des services.
Ces observations font partie des conclusions les moins évidentes
évoquées par les intervenants dans leur présentation de trois projets de
recherche empirique en cours sur la dynamique qui sous tend la relation
entre l'intégration régionale, les accords commerciaux préférentiels et
l'architecture du commerce mondial.
M. Pierre Sauvé, Directeur exécutif adjoint de l'Institut du
commerce mondial, était le modérateur de cette séance. Il a noté que le
“préférentialisme” prenait de plus en plus d'importance dans les
relations commerciales internationales et a expliqué en quoi il
représentait désormais un élément moteur de la diplomatie commerciale et
de la coopération commerciale. Il a fait remarquer que la mondialisation
n'était, après tout, rien d'autre que l'agrégation d'évolutions
régionales, même au niveau des relations commerciales. Il a ensuite
présenté les thèmes de trois documents de recherche qui sont discutés
actuellement.
M. Javier Lopez Gonzales, chercheur associé à l'Université du
Sussex, Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex (CARIS),
a décrit dans les grandes lignes l'évolution de la spécialisation
verticale dans le commerce et l'investissement. Partant de la dimension
mondiale de la spécialisation verticale (délocalisation), le document
sur le sujet tente de définir ses causes sous jacentes.
Les travaux effectués par M. Gonzales montrent qu'il pourrait exister un
lien entre l'apparition de la spécialisation verticale et les accords
commerciaux régionaux. Ce lien est manifeste au niveau des effets
découlant de la suppression des droits de douane et des mesures
tarifaires à l'intérieur des frontières, de l'harmonisation des normes
et de la réduction des coûts de transaction qui créent de nouvelles
possibilités de réaliser des économies d'échelle.
M. Michael Gasiorek, Directeur d'unité de CARIS, a passé en revue
les incidences de la crise sur les échanges, les facteurs qui l'ont
influencée et l'impact que les accords régionaux ont eu s'agissant d'en
répercuter les effets. Il a défini les facteurs qui sont normalement
considérés comme ayant provoqué le recul des échanges durant la récente
crise économique: la baisse de la demande, les difficultés d'accès au
crédit, la montée du protectionnisme et les effets amplificateurs de la
spécialisation verticale.
La recherche a montré jusqu'à présent que la baisse de la demande avait
eu un impact important sur la réduction des échanges mais que
l'augmentation du risque de crédit avait eu un effet dévastateur sur les
membres à revenu élevé des accords régionaux. L'orateur a indiqué que
les accords régionaux n'avaient pas protégé leurs membres d'un
effondrement des échanges et a indiqué que ce phénomène s'expliquait par
une spécialisation verticale de plus en plus importante et par la
dépendance des entreprises à l'égard du crédit.
M. Anirudh Shingal, chercheur principal à l'Institut du commerce
mondial, s'est penché plus spécialement sur la question des accords
préférentiels dans les services et leurs spécificités en termes de
création nette d'échanges. Les résultats ont montré qu'il existait une
corrélation positive entre la libéralisation du commerce de marchandises
et le commerce des services. Il a précisé que dans le cadre des accords
commerciaux régionaux, ce sont les contrats de services Nord Sud qui ont
eu le plus d'impact sur les échanges de services. Cependant, il a
indiqué que, dans le domaine des services, la recherche ne disposait pas
de données suffisantes.
M. Bernard Hoekman, Directeur du Département du commerce à la
Banque mondiale, a complété l'analyse en attirant l'attention sur
l'importance de ce type de recherche et sur les facteurs déterminants de
la physionomie des échanges non encore explorés, comme les changements
technologiques, la géographie et l'investissement étranger direct.
Le débat ouvert a été animé. L'assistance a communiqué des
informations importantes sur d'autres éléments que la recherche pourrait
prendre en compte comme le rôle du commerce à l'intérieur des régions,
la désagrégation des données et le rôle potentiel des institutions
financières internationales.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 26: Des intervenants de South Centre, du Réseau tiers monde se penchent sur les évolutions les plus récentes
TITRE DE LA SÉANCE: Questions clés concernant le développement du commerce et le changement climatique
Lors de cette séance, les intervenants ont défini les liens qui existent
entre le développement, le changement climatique et le commerce. Ils se
sont concentrés plus particulièrement sur les brevets pharmaceutiques,
l'intégration mondiale et régionale, la nécessité que les pays
développés assument leur responsabilité dans la lutte contre le
changement climatique, et les accords sur les services.
Mme Sanya Reid Smith, du Réseau tiers monde, a déclaré que les
accords de libre échange (ALE) et les accords de partenariat économique
(APE) pouvaient compromettre l'accès des pays en développement à des
secteurs, comme la médecine, qui sauvent des vies humaines. Elle a fait
observer que les brevets servaient principalement les intérêts des pays
développés.
Elle a fait valoir que les dispositions “ADPIC plus” (qui vont plus loin
que les règles de la propriété intellectuelle de l'OMC ou l'Accord sur
les ADPIC) sur les moyens de faire respecter les DPI ne devraient
concerner que les médicaments de qualité inférieure qui peuvent
entraîner des problèmes de santé mais pas les médicaments génériques qui
recoupent peu les premiers.
Mme Aileen Kwa du South Centre a présenté des données qui
montrent que le nombre de pauvres augmente dans les pays les moins
développés et que le revenu par habitant en Afrique est pratiquement au
même niveau qu'en 1980, et ce malgré les programmes d'ajustement
structurel, et aujourd'hui les programmes stratégiques visant à réduire
la pauvreté.
Elle a indiqué qu'au cours des 25 dernières années il a été recommandé à
la majorité des pays de s'intégrer davantage à l'économie mondiale par
le biais des exportations. Les poussées d'importations de produits
agricoles sont fréquentes et le nombre de pays africains désormais
tributaires des importations de produits alimentaires est de plus en
plus important.
Les abaissements tarifaires opérés dans les années 1980 avaient
désindustrialisé l'Afrique. La situation est aujourd'hui différente. Le
commerce régional est en plein croissance. Pour l'Afrique, le marché
africain est plus important que le marché de l'UE et les exportations
africaines à destination d'autres pays africains augmentent rapidement
tandis que celles des exportations à destination de l'UE stagnent. En ce
qui concerne les exportations de produits industriel, l'Afrique se
suffit à elle même, ce qui est prometteur.
M. Vicente Paolo Yu du South Centre a indiqué que le changement
climatique était un problème économique grave. Il a fait valoir qu'il
fallait aborder ce problème compte tenu des impératifs de
l'environnement, du développement et de l'équité. Il a analysé la
relation qui existe entre les émissions de dioxyde de carbone et
l'Indice de développement humain (IDH) et a proposé de les dissocier.
Il a cité des chiffres et a conclu que les moyens employés pour
s'attaquer au changement climatique demeuraient inadaptés et
inefficaces.
En réponse à une question posée par l'assistance, l'intervenant a dit
que les pays développés devaient assumer leur responsabilité en
réduisant leurs propres émissions et aider les pays en développement en
leur accordant une aide financière et technique.
Mme Sanya Reid Smith du Réseau tiers monde a fait remarquer que
des problèmes comme les visas, les qualifications et la citoyenneté ne
sont pas pris en compte dans le volet libéralisation des services des
accords commerciaux.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 27: G 20 — De la priorité financière au rôle du commerce
TITRE DE LA SÉANCE: Le rôle du G-20 dans la gouvernance de l'OMC
(Les engagements du G 20 et les rapports établis par l'OMC ont contribué
à éviter un protectionnisme à grande échelle durant la crise financière,
ce qui a amené l'OMC à jouer un rôle plus important au sein du G 20,
initialement axé sur la finance, a t il été dit lors de cette séance.
Les questions qui ont été posées à propos du G 20 concernaient notamment
le nombre limité de ses membres, l'obligation de rendre des comptes et
la transparence. Le premier rôle du G 20 est d'élaborer des politiques,
et il aiderait à conclure le Cycle de Doha en jouant un rôle de chef de
file s'agissant des questions commerciales.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 28: Règles commerciales et accords sur l'environnement: à qui revient l'initiative?
TITRE DE LA SÉANCE: Changement climatique, commerce et compétitivité: Défis pour l'OMC
Cette séance s'est transformée en débat sur la question de savoir qui,
de l'OMC ou des forums environnementaux, devrait prendre l'initiative de
définir la relation entre les politiques internationales de lutte contre
le changement climatique et les règles commerciales internationales.
Certains intervenants ont estimé que l'OMC ne devrait adapter ses règles
qu'après l'approbation par la communauté internationale d'une politique
mondiale de lutte contre le changement climatique. D'autres ont
préconisé que l'OMC énonce dès à présent ses règles concernant les
méthodes de production et les services environnementaux, sujets déjà
traités dans le cadre des politiques nationales sur le changement
climatique du fait de l'absence d'accord international en la matière.
Par ailleurs, une présentation de la recherche menée sur le plan
théorique et empirique concernant l'application d'ajustements aux
frontières de la taxe carbone a montré que ces ajustements unilatéraux
pouvaient protéger certains secteurs au détriment du reste de l'économie
nationale et mondiale, ce qui les rendait inefficients d'un point de vue
économique.
En outre, les dispositifs unilatéraux de plafonnement des émissions de
carbone ont entraîné en règle générale une réduction de la demande
intérieure de combustibles fossiles dont les prix ont de ce fait baissé.
La conséquence a été une “fuite de carbone” lorsque la consommation à
l'étranger a augmenté à la suite de la baisse des prix. Les observations
empiriques ont révélé que les entreprises n'ont pas beaucoup délocalisé
même s'il y a eu une réorientation des investissements du pays d'origine
vers l'étranger.
Enfin, tous les intervenants ont reconnu que l'OMC appliquait
actuellement des procédures plus efficaces et plus solidement établies
pour la négociation et le règlement des différends que les forums
environnementaux qui traitent des politiques sur le changement
climatique.
En raison de l'absence d'accord à l'OMC et au niveau des forums
environnementaux, on s'attend dans le futur immédiat à ce que ce soit
effectivement le système de règlements des litiges de l'OMC qui
définisse la relation entre les politiques de l'environnement et les
règles commerciales ce qui inquiétait certains intervenants qui
pensaient que l'OMC ne possédait pas l'expertise requise en matière
d'environnement.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 29: Les intervenants considèrent la lutte contre le changement climatique comme une occasion de mieux coordonner les politiques
TITRE DE LA SÉANCE: Le commerce, l'environnement et 9 milliards de personnes souffrant de la faim: coordonner les efforts de l'OMC et d'autres OIG pour assurer la sécurité alimentaire et atténuer les effets du changement climatique
Lutter contre le changement
climatique et la faim est un défi qui exige une meilleure coordination des
politiques au niveau national et international et qui offre l'occasion de
le faire, a t il été dit lors de cette séance.
Les trois experts ont abordé les problèmes rencontrés pour assurer une
cohérence et une coordination des politiques menées par l'OMC et les
autres organisations internationales, sur le plan de leurs règles, de
leurs négociations et d'autres initiatives visant à assurer la sécurité
alimentaire et limiter l'impact du changement climatique. M. Thaddeus
Burns, Conseil juridique principal de General Electric, Intellectual
Property & Trade, était le modérateur de cette séance.
Le professeur Ruth Oniang'o, ancienne parlementaire qui travaille
sur le terrain en étroite collaboration avec les femmes a évoqué les
problèmes suivants:
-
l'importance du partage direct des données d'expérience;
-
la nécessité que les scientifiques informent les décideurs;
-
la notion d'agriculteurs entrepreneurs dans les pays en développement (et pas uniquement bénéficiaires de l'aide);
-
la priorité à accorder à la bonne gouvernance à tous les niveaux (national et international) et les incidences au niveau local;
-
l'engagement et la volonté politique comme condition nécessaire à toute avancée;
-
le respect de la dignité humaine.
Mme Gretchen Stanton, de la Division de l'agriculture et des produits de base, a dit ce qui suit:
-
nous avons l'obligation politique et morale d'assurer aux populations une alimentation suffisante et l'accès à des produits alimentaires sains et il nous appartient de trouver des solutions pratiques à cette fin;
-
tant que des millions de personnes mourront de faim et seront poussées à utiliser l'agriculture itinérante sur brûlis ou des pratiques similaires, la protection de l'environnement sera une cause perdue;
-
le commerce est l'un des instruments disponibles pour atteindre des objectifs tels que la réduction de la faim dans le monde;
-
ce défi exige une étroite collaboration entre diverses disciplines;
-
une approche bien coordonnée est nécessaire au niveau national avant de porter ces questions au niveau international;
-
la difficulté est d'instaurer des politiques qui créent le moins de distorsions possible dans les échanges.
M. Anatole Krattiger, Directeur de la Division des défis mondiaux de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a commencé sa présentation en posant une question essentielle: quelles sont les réalisations visées dans la lutte contre le changement climatique? Il a cité trois objectifs: accélérer le transfert de technologie, encourager l'invention de nouvelles technologies et trouver des solutions novatrices adaptées aux pays en développement. Il a également évoqué d'autres idées comme:
-
l'intégrité du processus d'élaboration des politiques au niveau mondial;
-
la non opposition entre le secteur des biens publics et celui des biens privés qui doivent au contraire travailler ensemble;
-
la lutte contre le changement climatique en tant qu'élément catalyseur, une façon de transformer un problème en une opportunité.
Questions posées par l'assistance:
-
Un représentant du gouvernement namibien: quelle a été l'erreur des Africains? Aucune. Le problème de l'Afrique, c'est l'insuffisance du système éducatif.
-
Canada: qui assurera la cohérence?
-
L'Organisation des agriculteurs allemands: l'aide ne parvient pas à ceux qui pourraient influer sur la sécurité alimentaire, comme les agriculteurs auxquels il faudrait donner les moyens d'agir.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 30: Les experts évaluent en quoi les subventions accordées à la pêche sont bonnes ou mauvaises et ce qu'il est urgent de faire
TITRE DE LA SÉANCE: L'avenir du commerce et l'environnement: imaginer la solution de l'OMC pour le commerce, le développement et des océans durables
L'objectif de cette séance était d'évaluer l'impact négatif des
subventions et de la surcapacité de la pêche industrielle sur la
durabilité des stocks de poissons ainsi que leurs effets sur
l'appauvrissement des océans. Étant donné que les poissons franchissent
les frontières les problèmes de surcapacité concernent aussi bien les
pays développés que les pays en développement.
Les intervenants ont dit que les aides étaient “bonnes” (pour les
pêcheries à petite échelle) et “mauvaises” (le plus souvent dans le cas
de pêcheries industrielles). L'OMC peut aborder ces questions urgentes
dans le cadre des négociations sur l'accès aux marchés, les subventions
et l'Aide pour le commerce et, dans ce domaine, la conclusion du Cycle
de Doha est primordiale.
M. Peter Allgeier, ancien Ambassadeur des États Unis, a commencé
sa présentation en rappelant que le Cycle de Doha est la première
négociation commerciale qui inclut les questions de durabilité et de
préservation de l'environnement. Il a indiqué que le but de la
négociation sur les subventions accordées à la pêche était de s'attaquer
aux surcapacités tout en conservant une flexibilité pour les pays en
développement.
Il a dit que les négociations visaient ainsi à protéger les intérêts
commerciaux tout en réalisant un objectif commun qui est la viabilité
des océans. Étant donné que le respect des frontières n'existe pas pour
les poissons, le problème de la pêche dépasse la ligne de démarcation
Nord Sud. Il est indispensable de trouver un équilibre entre
développement et commerce, d'une part, et environnement et durabilité,
d'autre part. Il faut examiner les questions essentielles: la portée des
interdictions, le traitement spécial et différencié en faveur des pays
en développement, et l'applicabilité du système de règlement des
différends.
M. Rainer Froese du Leibniz Institute a présenté des chiffres qui
montraient la responsabilité des flottes industrielles dans le déclin
rapide des stocks de morue canadiens dans les années 1970, stocks qui
n'étaient toujours pas reconstitués aujourd'hui. Il a rappelé les
prévisions alarmistes de la FAO concernant l'effondrement des stocks
mondiaux de poissons pour 2048.
Il faut s'attendre, selon M. Froese, à une régression totale de
l'augmentation des stocks de poissons d'ici à 2020. Les stocks mondiaux
de poissons ont diminué de 90 pour cent depuis les années 1950. Les
flottes industrielles subventionnées sont responsables de
l'appauvrissement des océans. L'avidité, la mauvaise gestion et les
subventions sont les causes de la surpêche. Il a conclu que les
subventions incitaient à la surpêche et devaient être réduites.
M. Anthony Charles, de St Mary's University (Canada), s'est
concentré sur la pêche artisanale et à petite échelle et sur les
difficultés auxquelles elles doivent faire face. Il a indiqué qu'il
partageait les préoccupations que suscitaient les subventions et que
toutes les pêcheries pouvaient être confrontées à la surpêche.
Il a dit que la pêche de subsistance, artisanale et à petite échelle
n'était pas l'apanage des pays en développement puisqu'elle pouvait
également se pratiquer dans les pays développés. Les pêcheries à petite
échelle sont, selon lui, les mieux placées pour contribuer à atteindre
les Objectifs du Millénaire pour le développement en ce sens qu'elles
favorisent le bien être des communautés locales, la sécurité alimentaire
et les droits fondamentaux tout en respectant l'impératif de
préservation des ressources.
Les subventions sont “bonnes” si elles répondent aux besoins de la pêche
à petite échelle qui sont d'assurer l'accès au poisson; la sécurité
alimentaire et le bien-être des ménages ou de la communauté; la bonne
gouvernance et la capacité de bien s'organiser; une flexibilité
juridique et l'accès à l'autonomie et, enfin, la diversification des
moyens de subsistance.
Les “mauvaises” subventions accordées à la pêche industrielle incluent
l'investissement dans la modernisation des navires, les crédits d'impôt,
les exonérations fiscales pour les pêcheurs ou les propriétaires de
navires, le déclassement de navires, les subventions au carburant et les
subventions en matière d'accès aux marchés.
M. Ricardo Meléndez Ortiz, Directeur général de ICTSD, a demandé
de se concentrer sur les subventions, l'accès aux marchés et l'Aide pour
le commerce dans les discussions sur le commerce du poisson.
Il a indiqué que 70 à 80 pour cent des subventions sont responsables de
la surcapacité et ne sont pas axées sur la durabilité. La réduction des
subventions est un problème complexe en raison des ajustements du marché
du travail qu'elle implique. Un meilleur accès aux marchés et l'Aide au
commerce aideraient le secteur de la pêche artisanale à s'élever dans la
chaîne de valeur.
L'intervenant a précisé que des changements considérables touchant
l'environnement mondial sont intervenus depuis que nous avons pris
conscience que nous sommes passés du monde de l'abondance à celui de la
pénurie. Il ne peut pas y avoir de commerce et donc de gains sans
ressources durables. Le poisson ne respecte pas les frontières mais les
politiques peuvent respecter les spécificités des pays en développement.
Les pays prennent de plus en plus conscience de l'importance des
questions environnementales et des subventions à la pêche. Le système de
règlement des différends de l'OMC porte habituellement sur le respect
des obligations; il existe aujourd'hui un nouveau sujet de droit qui est
le développement durable. Il est admis que le commerce n'opère pas dans
le vide.
Discussion: Les questions posées concernaient notamment
l'incidence d'une réduction de la pêche en haute mer par les flottes
industrielles ou les substituts simples à utiliser pour atteindre le
rendement maximal équilibré; la faisabilité de préserver les moyens de
subsistance dans certaines communautés ne bénéficiant pas de
subventions; la façon d'intégrer les partenaires non commerciaux dans
les négociations; les augmentations de prix découlant de la suppression
des subventions et leur caractère impopulaire au niveau national;
l'impossibilité pour l'OMC de fournir une solution miracle dans le cadre
des négociations sur la pêche en raison de la complexité du problème; le
problème que pose le fait que l'appauvrissement des océans touche tout
le monde mais que tout le monde n'est pas responsable. Les intervenants
ont également évoqué la perspective d'un échec du Cycle de Doha et la
nécessité impérative de le conclure.
> En savoir plus sur cette séance
Séance 31: Les problèmes auxquels les femmes
sont confrontées dans le cadre du commerce informel transfrontières
TITRE DE LA SÉANCE: Campagne pour l'intégration et la représentation des questions relatives aux femmes dans le commerce: renforcer les réponses pour créer de la richesse et réduire la pauvreté des femmes dans le domaine du commerce informel transfrontalier en Afrique australe
Cette séance a mis en évidence la nécessité d'inclure une budgétisation
sexospécifique dans le commerce aux niveaux national et régional. Elle a
indiqué la place importante qu'occupent les femmes dans le commerce
informel transfrontières en Afrique australe et les nombreux problèmes
auxquels elles doivent faire face.
Les problèmes liés au commerce transfrontières incluent les maladies, la
fatigue, la malaria, la grippe, les maladies véhiculées par l'air et par
l'eau. Pour certaines femmes, la relation sexuelle est une stratégie
d'adaptation qui permet de limiter le problème d'hébergement.
Le harcèlement n'est pas rare; les sévices sexuels, les violences
verbales et physiques sont monnaie courante. Les personnes qui font du
commerce transfrontières sont également confrontées aux comportements
abusifs de fonctionnaires corrompus qui exigent des pots de vin ainsi
qu'à des attentes fréquentes aux frontières, des formalités fastidieuses
et des fouilles. Il arrive même parfois que leurs marchandises soient
saisies par les fonctionnaires des services de l'immigration.
Propositions pour régler ces problèmes: Les gouvernements doivent
reconnaître le commerce informel transfrontières et mettre en place des
politiques de soutien, faciliter l'octroi d'aides financières, mettre à
disposition des moyens de transport sûrs et abordables, donner aux
femmes les moyens de leur autonomie grâce à l'acquisition de compétences
commerciales, etc.
Actuellement, il existe un énorme déficit d'information entre ceux qui
élaborent les politiques et ceux qui les mettent en œuvre.
> En savoir plus sur cette séance
POUR EN SAVOIR PLUS
>
Forum public
2010
>
ces sessions
|
Suivre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YouTube |
|
|
Flickr |
|
|
RSS |
> Des problèmes pour visualiser cette page?
Veuillez écrire à [email protected] en indiquant le système d’exploitation et le navigateur que vous utilisez.
![]()