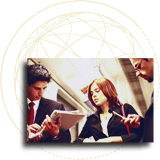- page d'accueil
- nouvelles
- communiqu閟 de presse 1996
- communiqu?de presse
PRESS/57
9 octobre 1996
“Commerce et investissement 閠ranger direct”: Nouveau rapport de l'OMC
Vu la multiplication des liens r閏iproques d'ordre 閏onomique, institutionnel et juridique entre le commerce et l'investissement 閠ranger direct (IED), les gouvernements Membres de l'OMC devraient-ils continuer ?recourir aux accords bilat閞aux IED ou devraient-ils cr閑r un cadre multilat閞al qui reconnaisse l'existence de ces liens et tienne compte des int閞阾s de tous les Membres de l'OMC - qu'il s'agisse des pays d関elopp閟, des pays en d関eloppement ou des pays les moins avanc閟?
On trouvera ci-joint le texte int間ral du rapport.
Note aux journalistes:
Les coauteurs - Richard Blackhurst, Directeur de la Division de la recherche et de l'analyse 閏onomiques, et Adrian Otten, Directeur de la Division de la propri閠? intellectuelle et des investissements - donneront une conf閞ence de presse le mercredi 16 octobre ?15h.00 dans la salle III du Palais des Nations ? Gen鑦e. Les journalistes (t閘関ision, radio et presse 閏rite) sont cordialement invit閟 ?y assister.
Chapitre IV
Commerce et investissement 閠ranger direct
I. Introduction
On parle maintenant beaucoup de l'investissement 閠ranger direct (IED) et il y a ?cela de nombreuses raisons. L'une d'elles est l'augmentation spectaculaire des flux annuels globaux d'IED, qui sont pass閟 de 60 ?315 milliards de dollars selon les estimations entre 1985 et 1995 (graphique 1), et l'accroissement de leur importance relative en tant que source d'investissements pour plusieurs pays qui en est r閟ult? L'encours de l'IED progresse quant ?lui et il ressort des estimations que les ventes des filiales 閠rang鑢es des soci閠閟 multinationales d閜assent la valeur du commerce mondial des marchandises et des services (qui a atteint 6 100 milliards de dollars en 1995), que les 閏hanges intragroupe de ces soci閠閟 repr閟entent environ un tiers du commerce mondial et leurs exportations vers des entreprises non affili閑s un autre tiers, le tiers restant correspondant aux 閏hanges entre les entreprises nationales (autres que les soci閠閟 multinationales).
Le vif int閞阾 que suscite l'IED fait aussi partie de l'int閞阾 plus g閚閞al port?aux forces qui participent au processus d'int間ration de l'閏onomie mondiale, plus connu sous le nom de “mondialisation”. Outre l'augmentation plus ou moins r間uli鑢e du ratio du commerce mondial au PIB mondial, l'importance accrue des installations 閠rang鑢es de production et de distribution dans la plupart des pays est cit閑 comme une preuve tangible de la mondialisation.

Evolution r閏ente de l'IED
Le graphique 1 couvre un peu plus de 20 ans. A la fin des ann閑s 70, les flux sortants annuels d'IED des pays de l'OCDE vers toutes les destinations (y compris entre ces pays) avaient doubl? passant d'environ 25 milliards ?pr鑣 de 60 milliards de dollars (les pays de l'OCDE accueillent actuellement 73% de l'encours mondial de l'IED et 92% de cet encours en 閙anent). Il s'agit l?toutefois de chiffres nominaux et, 閠ant donn?que les pays de l'OCDE ont connu dans les ann閑s 70 deux p閞iodes d'inflation ?deux chiffres, il est 関ident qu'en termes r閑ls, il y a eu au mieux une l間鑢e augmentation des flux sortants annuels. Apr鑣 avoir brutalement diminu?au d閎ut des ann閑s 80, ces flux ont recommenc??augmenter. De 1986 ?1989, les flux annuels d'IED ont progress??un rythme ph閚om閚al, puisqu'ils ont 閠?multipli閟 par quatre en quatre ans. Dans la seconde moiti?de cette p閞iode d'intense activit? le total global a re鐄 une nouvelle impulsion, quoique relativement faible, sous l'effet d'un triplement (?partir d'un niveau tr鑣 bas) des flux sortants annuels d'IED des pays non membres de l'OCDE, et en particulier de Hong Kong. Plus pr閏is閙ent, la part de ces pays dans les flux sortants mondiaux d'IED est pass閑 de 5% pendant la p閞iode 1983-1987 ?15% en 1995.
Dans les pays de l'OCDE, cette p閞iode de forte croissance de l'IED a 閠?suivie par cinq ann閑s (1990-1994) de stagnation, voire de baisse, des flux sortants annuels, ce qui tient sans doute en partie au ralentissement g閚閞alis?de l'activit?閏onomique. Puis, en 1995, on a assist??un autre inversement de tendance spectaculaire, les flux sortants d'IED de la zone de l'OCDE ayant selon les estimations progress?de 40%.
On se demande souvent si l'IED progresse plus rapidement que le commerce mondial. La r閜onse est fonction de la p閞iode. Pendant la p閞iode 1986-1989 et ?nouveau en 1995, les flux sortants ont augment?beaucoup plus vite que le commerce mondial. En revanche, pendant les p閞iodes 1973-1984 et 1990-1994, la croissance de l'IED a 閠?plus lente que celle du commerce. Sur l'ensemble de la p閞iode 1973-1995, la valeur estimative des flux sortants annuels d'IED a 閠?multipli閑 par plus de 12 (de 25 ?315 milliards de dollars), alors que la valeur des exportations de marchandises a 閠?multipli閑 par 8,5 (de 575 ?4 900 milliards de dollars).
Une comparaison entre les flux d'IED et les flux d'investissements de portefeuille internationaux pendant la p閞iode 1988-1994 montre qu'en moyenne annuelle, ils ont 閠? plus ou moins 間aux pendant la p閞iode 1988-1990, apr鑣 quoi les investissements de portefeuille ont connu trois ann閑s de croissance rapide qui les ont port閟 ?un niveau (630 milliards de dollars en 1993) 閝uivalant ?plus de deux fois celui de l'IED. L'閏art s'est ensuite un peu r閐uit du fait du net ralentissement de la croissance des investissements de portefeuille en 1994 (les chiffres sur les investissements de portefeuille en 1995 ne sont pas encore disponibles). Une troisi鑝e cat間orie de flux financiers, particuli鑢ement importante pour de nombreux pays en d関eloppement, est celle du financement public du d関eloppement. En 1994, ann閑 o?les flux d'investissements de portefeuille internationaux ont 閠?d'environ 350 milliards de dollars et les flux d'IED de 230 milliards de dollars (dans les deux cas vers toutes les destinations), les pays de l'OCDE ont consacr?au financement public du d関eloppement environ 60 milliards de dollars, dont environ 50 milliards de dollars sont all閟 ?des pays en d関eloppement et le reste ?des 閏onomies en transition.
En 1995, les flux entrants d'IED dans la zone hors OCDE se sont chiffr閟 au total ?112 milliards de dollars selon les estimations. Sur ce montant, 65 milliards de dollars environ sont all閟 ?l'Asie et 27 milliards de dollars ?l'Am閞ique latine (y compris le Mexique). Les 20 milliards de dollars restants se sont r閜artis presque 間alement entre les 閏onomies en transition d'Europe, d'une part, et l'Afrique et le Moyen-Orient, d'autre part.
La part des pays non membres de l'OCDE dans les flux entrants mondiaux d'IED, qui avait diminu?dans les ann閑s 80, est pass閑 de pr鑣 de 20% ?environ 35% entre 1990 et 1995. La Chine en tant que pays d'accueil est responsable en grande partie de cette augmentation mais d'autres pays en d関eloppement, en particulier en Asie et en Am閞ique latine, ont aussi b閚閒ici?d'un fort accroissement de l'IED. Par ailleurs, les flux d'IED ?destination des pays non membres de l'OCDE sont fortement concentr閟. En 1995, la Chine a absorb?environ un tiers de tous les flux d'IED destin閟 aux pays non membres de l'OCDE (38 milliards de dollars sur 112 milliards), et neuf autres pays se r閜artissent une part de 35%. Les 135 autres pays en d関eloppement et en transition se sont partag閟 (pas 間alement) les 31% (36 milliards de dollars) restants. Les pays les moins avanc閟 ont attir?en moyenne pendant la p閞iode 1990-1995 des IED de 1,1 milliard de dollars, ce qui correspond ?environ 0,5% des flux globaux d'IED.
Le tableau 1 pr閟ente des chiffres sur les flux entrants cumul閟 globaux dans les principales 閏onomies d'accueil pendant la p閞iode 1985-1995. Sur les 20 閏onomies consid閞閑s, sept sont en d関eloppement. La Chine vient en quatri鑝e position et le Mexique, Singapour, la Malaisie, l'Argentine, le Br閟il et Hong Kong figurent aussi sur la liste. Le tableau 1 attire aussi l'attention sur le fait que les principales 閏onomies d'accueil de l'IED sont aussi, pour la plupart, les principales 閏onomies d'origine de ce type d'investissement (les noms sont alors en caract鑢e gras). Les neuf premi鑢es 閏onomies d'accueil, et sept des onze 閏onomies restantes, figurent sur la liste des 20 principales 閏onomies d'origine de l'IED.
Tableau 1
Principales 閏onomies pays d'accueil pour l'IED, sur la base des flux entrants
cumul閟, 1985-1995
Rang |
Economie |
IED, en milliards de dollars EU |
IED, par habitant, dollars EU |
|
1 |
Etats-Unis d'Am閞ique |
477,5 |
1 820 |
(13)* |
2 |
Royaume-Uni |
199,6 |
3 410 |
(7) |
3 |
France |
138,0 |
2 380 |
(10) |
4 |
Chine |
130,2 |
110 |
(20) |
5 |
Espagne |
90,9 |
2 320 |
(11) |
6 |
Belgique-Luxembourg |
72,4 |
6 900 |
(2) |
7 |
Pays-Bas |
68,1 |
4 410 |
(3) |
8 |
Australie |
62,6 |
3 470 |
(6) |
9 |
Canada |
60,9 |
2 060 |
(12) |
10 |
Mexique |
44,1 |
470 |
(17) |
11 |
Singapour |
40,8 |
13 650 |
(1) |
12 |
Su鑔e |
37,7 |
4 270 |
(4) |
13 |
Italie |
36,3 |
630 |
(16) |
14 |
Malaisie |
30,7 |
1 520 |
(14) |
15 |
Allemagne |
25,9 |
320 |
(18) |
16 |
Suisse |
25,2 |
3 580 |
(5) |
17 |
Argentine |
23,5 |
680 |
(15) |
18 |
Br閟il |
20,3 |
130 |
(19) |
19 |
Hong Kong |
17,9 |
2 890 |
(9) |
20 |
Danemark |
15,7 |
3 000 |
(8) |
* Les chiffres entre parenth鑣es indiquent le classement sur la base de l'IED par habitant.
Note: Les 閏onomies indiqu閑s en caract鑢es gras se classent aussi parmi les 20 principales 閏onomies d'origine pour l'IED (il convient de noter que la d閒inition de l'IED varie consid閞ablement d'une 閏onomie ?l'autre). Cette liste ne mentionne pas les Bermudes, o?les flux entrants cumul閟 d'IED, principalement dans le secteur financier, se sont 閘ev閟 ?21,5 milliards de dollars EU pendant la p閞iode consid閞閑.
Source: CNUCED, base de donn閑s IED pour les 20 principales 閏onomies d'accueil, et Nations Unies (1996) pour les chiffres de population utilis閟 pour le calcul de l'IED par habitant.
Les flux entrants cumul閟 sont aussi donn閟 par habitant dans le tableau 1 (rien ne dit que ces pays occupent les 20 premi鑢es places dans un classement des flux par habitant). Dans de nombreux cas, le classement est tr鑣 diff閞ent de celui qui repose sur les chiffres globaux. La diff閞ence la plus spectaculaire concerne la Chine qui passe du quatri鑝e rang sur la base des montants globaux au vingti鑝e rang sur la base des chiffres par habitant. Apr鑣 la Chine, les pays qui reculent le plus sont les Etats-Unis (du premier au treizi鑝e rang) et la France (du troisi鑝e au dixi鑝e rang). En revanche, bien s鹯, certaines 閏onomies - en particulier certaines des plus petites - progressent dans le classement par habitant: c'est le cas du Danemark, de la Suisse, de Hong Kong et de Singapour qui gagnent chacun dix places (ou plus).
La partie sup閞ieure du graphique 2 indique o?les soci閠閟 multinationales de six des principaux pays d'origine ont effectu?leurs IED (les six pays ont 閠?choisis parce que des donn閑s 閠aient disponibles ?leur sujet; ensemble, ils ont contribu?pour environ deux tiers aux flux sortants globaux d'IED pendant les dix derni鑢es ann閑s). En 1984 comme en 1994, la principale destination a 閠?les autres pays de l'OCDE. M阭e le Japon, qui 閠ait le moins ax?sur les pays de l'OCDE en 1984, a vu la part de son stock d'IED dans la zone de l'OCDE augmenter de plus du tiers entre cette ann閑 et 1994. Sur les trois pays europ閑ns du tableau, seul le Royaume-Uni avait plus qu'une part tr鑣 minime de son stock d'IED dans des pays d'Asie non membres de l'OCDE l'une et l'autre ann閑s.
La variation entre les six pays est plus nette lorsqu'on analyse la r閜artition sectorielle de leur stock d'IED ?l'閠ranger, comme il appara顃 dans la partie inf閞ieure du graphique 2. La part de l'IED dans l'agriculture et les industries extractives (principalement les combustibles) 閠ait la plus 閘ev閑 au Royaume-Uni et la plus faible en Allemagne. Le Royaume-Uni est le seul des six pays ?avoir accru la part de l'IED dans le secteur manufacturier entre 1984 et 1994, et la France le seul ?l'avoir accrue dans le secteur agricole et les industries extractives. En revanche, tous les six ont augment? la part de l'IED dans le secteur des services pendant cette p閞iode, les progressions les plus fortes ayant 閠?enregistr閑s par l'Allemagne et les Etats-Unis. La part de l'IED dans le secteur des services a d閜ass?en 1994 sa part dans le secteur manufacturier de ces pays, ?l'exception du Royaume-Uni et de l'Allemagne, o?elles ont 閠?間ales (au Japon, la part dans les services a 閠?plus du double de la part dans le secteur manufacturier).

II. Commerce et investissement 閠ranger direct
Pour la plupart, les travaux empiriques sur les relations entre l'IED et le commerce ne visent pas ?閠ablir entre ces deux 閘閙ents un lien de cause ?effet - par exemple ?d閠erminer si les flux entrants d'IED entra頽ent un accroissement des exportations ou si, au contraire, le d関eloppement des exportations se traduit par une augmentation de l'IED. Ils cherchent ?r閜ondre ?un objectif plus modeste, celui de d閠erminer si un accroissement de l'un est syst閙atiquement associ??un accroissement ou ?une diminution de l'autre - en d'autres termes s'il existe entre eux une corr閘ation. Plus simplement, il s'agit de voir si le commerce et l'IED sont substituables (s'il existe entre eux une corr閘ation n間ative) ou compl閙entaires (s'il existe entre eux une corr閘ation positive).
Si l'on met l'accent sur les liens r閏iproques, la question de savoir si l'IED et le commerce sont substituables ou compl閙entaires passe au deuxi鑝e plan. Qu'ils soient substituables ou compl閙entaires, leurs liens r閏iproques sont tout aussi solides. Et s'il y a entre eux des liens r閏iproques, cela signifie que la politique commerciale affecte les flux d'IED et que les politiques en mati鑢e d'IED affectent les flux commerciaux; aussi serait-il bon que les deux ensembles de politiques soient trait閟 de mani鑢e int間r閑.
La pr閟ente section, qui r閟ume les r閟ultats des recherches sur la relation entre l'IED et le commerce, contient d'abord une br鑦e analyse de la pens閑 actuelle sur les facteurs qui stimulent l'IED au niveau de l'entreprise. Comme on le verra, il est important de savoir ce qui motive l'IED pour bien comprendre les liens r閏iproques entre l'IED et le commerce. La seconde partie est consacr閑 aux donn閑s empiriques sur les liens r閏iproques entre l'IED et le commerce, du point de vue du pays d'origine, puis du point de vue du pays d'accueil.
1) Pourquoi les entreprises se lancent-elles dans l'IED?
Pourquoi les entreprises d閜loient-elles les efforts n閏essaires pour investir ?l'閠ranger plut魌 que de s'int閞esser au march?int閞ieur et de produire pour l'exportation et/ou de conc閐er des licences ?des entreprises 閠rang鑢es pour l'exploitation de leurs technologies? Les analystes se posent la question depuis pr鑣 de 40 ans. On s'accorde maintenant ? penser qu'une soci閠?multinationale est g閚閞alement le fruit de trois circonstances interd閜endantes. Premi鑢ement, l'entreprise poss鑔e des actifs qui peuvent 阾re exploit閟 de mani鑢e rentable ?une 閏helle relativement large - par exemple, propri閠?intellectuelle (technologies et noms de marque), comp閠ences en mati鑢e d'organisation et de gestion et r閟eaux de commercialisation. Deuxi鑝ement, il est plus rentable de produire ?l'aide de ces actifs dans plusieurs pays que de produire exclusivement dans le pays d'origine et d'exporter. Troisi鑝ement, les avantages potentiels d'une “internalisation” de l'exploitation des actifs sont plus importants que ceux qui d閏oulent de l'octroi de licences ?des entreprises 閠rang鑢es pour l'exploitation des actifs et sont suffisants pour qu'il vaille la peine pour l'entreprise d'engager les frais additionnels qu'entra頽e la gestion d'une grande organisation, dispers閑 sur le plan g閛graphique.
Les actifs des soci閠閟 multinationales
On fait souvent observer que les actifs des soci閠閟 multinationales comprennent de nombreux actifs incorporels, principalement sous forme de propri閠?intellectuelle, y compris des technologies, des noms de marque et des droits d'auteur, auxquels il faut ajouter le “capital humain” (les comp閠ences des employ閟) associ??ces actifs. Une grande partie des travaux sur les soci閠閟 multinationales soulignent que la technologie est l'un des 閘閙ents moteurs de l'internationalisation de leurs op閞ations. La technologie peut 阾re ax閑 sur les produits (l'entreprise peut produire une gamme de produits que, du fait de la technologie utilis閑, les consommateurs pr閒鑢ent ?d'autres variantes du m阭e produit produites par des entreprises rivales) ou sur les proc閐閟 (l'entreprise peut 阾re en mesure de produire des produits normalis閟 ?un co鹴 plus faible que ses rivales). Toutefois, les avantages comp閠itifs des entreprises qui reposent sur la technologie ont tendance ?devenir obsol鑤es avec le temps. L'avantage r閑l que poss鑔ent certaines entreprises est donc peut-阾re non pas une technologie donn閑 mais la capacit?d'innover r間uli鑢ement du point de vue technologique.
Quel que soit l'閘an donn?par la technologie ?l'internationalisation des entreprises, elle n'est pas le seul actif incorporel que les entreprises peuvent chercher ?exploiter ? l'閏helle mondiale. Les brevets et les droits d'auteur peuvent donner des avantages comp閠itifs 関idents ?l'entreprise qui les poss鑔e. Dans certains secteurs, les actifs rev阾ent la forme de noms de marque pour lesquels les consommateurs du monde entier sont dispos閟 ?payer un suppl閙ent (par exemple, coca ou pepsi cola). Les entreprises poss閐ant ces actifs peuvent bien s鹯 accorder des droits de production sous licence ?des pays donn閟 plut魌 que de d閏ider d'investir dans des 閝uipements de production ?l'閠ranger.
Pourquoi produire dans plus d'un pays?
Le fait qu'une entreprise poss鑔e des actifs qui peuvent 阾re exploit閟 ?large 閏helle et qui la rendent comp閠itive au plan international ne suffit toujours pas ?expliquer le caract鑢e international des soci閠閟 multinationales. Apr鑣 tout, la gestion d'actifs situ閟 dans des pays 閠rangers entra頽e des co鹴s suppl閙entaires, par exemple pour obtenir des renseignements sur les lois et r間lementations locales, g閞er localement les relations professionnelles, financer l'augmentation du nombre de voyages d'affaires et g閞er des op閞ations dans diff閞entes langues et diff閞entes cultures. Pourquoi ne pas produire ?un seul endroit et desservir les march閟 閠rangers en exportant?
Pour de nombreuses industries de service, la r閜onse est tr鑣 simple. Pour 阾re comp閠itif sur les march閟 閠rangers, le fournisseur de service doit avoir une pr閟ence physique sur ces march閟. Le fait est que la plus grande partie du commerce transfronti鑢es des services s'est d関elopp閑 sous l'impulsion de l'IED. Alors que dans le cas des produits manufactur閟, l'IED suit souvent le commerce, dans le secteur des services, c'est le contraire qui se produit. Ce fait a 閠?express閙ent reconnu pendant le Cycle d'Uruguay, au cours duquel les participants sont convenus d'inclure des r鑗les sur la “pr閟ence commerciale” dans l'Accord g閚閞al sur le commerce des services.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les op閞ations multinationales peuvent aussi 阾re plus int閞essantes pour les branches produisant des marchandises, qui se r閜artissent le plus souvent en deux grandes cat間ories. Premi鑢ement, il y a celles qui tendent ? mettre l'accent sur l'IED vertical, c'est-?dire qui localisent diff閞entes 閠apes de la production dans diff閞ents pays. On consid鑢e g閚閞alement que ces types d'investissements r閟ultent des 閏arts entre les co鹴s des intrants dans les divers pays. Une soci閠?multinationale op閞ant dans le secteur des industries extractives, o?les ressources naturelles sont concentr閑s dans certains pays, en est un exemple 関ident. On peut aussi mentionner le cas d'une entreprise qui localise une partie ? forte intensit?de travail de sa cha頽e de production dans un pays o?les co鹴s de la main-d'oeuvre sont faibles, alors qu'elle localise des op閞ations de production exigeant de grosses quantit閟 de “capital humain” dans une nation o?l'offre de main-d'oeuvre hautement qualifi閑 est relativement importante. En d'autres termes, en vue de r閐uire au minimum ses co鹴s de production, l'entreprise 閠ablit ses op閞ations de production dans plusieurs pays et utilise le commerce pour r閜ondre ?la demande de produits donn閟 - y compris des intrants - sur des march閟 donn閟.
L'autre grande cat間orie d'avantages d閏oulant des op閞ations multinationales donne lieu ? l'IED horizontal, selon lequel des op閞ations de production analogues sont effectu閑s dans des pays diff閞ents. Ce type d'IED est motiv?par exemple par le fait que les frais de transport des produits dont le rapport poids/valeur est 閘ev?peut rendre la production locale plus rentable, que certains produits doivent 阾re fabriqu閟 ?proximit?des consommateurs; que la production locale fait qu'il est plus facile de s'ajuster aux normes de produits locales; et que la production locale permet une meilleure information sur les concurrents locaux. L'IED peut aussi s'expliquer par les obstacles au commerce existants - il s'agit alors par exemple d'un IED destin??contourner les droits de douane - ou par la volont?de r閐uire le risque de mesures protectionnistes futures - c'est alors l'IED "quid pro quo".
Pourquoi ne pas accorder de licences?
Le fait de poss閐er des actifs incorporels, et les 閏arts entre les co鹴s de production dans les divers pays, ne peuvent ?eux seuls expliquer pourquoi une entreprise s'occupe elle-m阭e de la production. De nombreux actifs incorporels, y compris les technologies, peuvent faire, et font souvent dans la pratique, l'objet de licences accord閑s ?des entreprises 閠rang鑢es. Lorsqu'une entreprise d閏ide de se lancer dans l'IED, il doit y avoir des raisons pour lesquelles elle pr閒鑢e “internaliser” l'utilisation de ses actifs plut魌 que de les faire exploiter sous licence.
Les travaux sur la question 閚um鑢ent un grand nombre d'avantages d閏oulant de l'internalisation. Il y a les avantages qui r閟ultent du fait que l'entreprise 関ite les co鹴s associ閟 aux transactions entre soci閠閟 ind閜endantes, co鹴s qui sont li閟 ?la passation des contrats et ?la garantie de la qualit?dans les transactions avec les fournisseurs, les soci閠閟 d'export-import et les titulaires de licences 閠rangers. Gr鈉e ?l'internalisation des transactions au sein d'une seule entreprise, ces co鹴s, entre autres, peuvent 阾re r閐uits, sans doute de mani鑢e importante. Une question 閠roitement li閑 est celle de savoir si l'environnement juridique dans le pays d'accueil, en particulier pour ce qui est de la protection de la propri閠? intellectuelle, donne ?une soci閠?multinationale qui octroie des licences pour l'exploitation de ses technologies un contr鬺e sur l'utilisation de ces technologies qui soit 閝uivalent ?celui qu'elle aurait exerc?si elle avait mis en place une filiale et s'閠ait livr閑 elle-m阭e ?la production.
Par ailleurs, le march?ext閞ieur des technologies peut sous-関aluer une technologie par rapport ?ce qu'elle repr閟ente pour l'entreprise qui l'a mise au point. Ainsi, pour exploiter pleinement une technologie donn閑, une entreprise peut avoir besoin d'autres technologies, compl閙entaires, de personnes ayant des connaissances et comp閠ences pr閏ises qu'il n'est pas facile de trouver ailleurs. Dans ce cas, la technologie aura probablement une plus grande valeur dans l'entreprise qui l'a cr殫e que pour les entreprises ext閞ieures, ce qui signifie que l'entreprise y perdra en faisant exploiter la technologie sous licence sur le march?libre. Plus l'閏art est important, plus il est probable que les gestionnaires de l'entreprise d閏ideront d'internaliser l'utilisation de la technologie.
2) Incidence des politiques commerciales sur l'IED
Les politiques commerciales peuvent influer sur les incitations ?l'IED de nombreuses mani鑢es; nous venons d'en voir deux. Un droit suffisamment 閘ev?peut 阾re ?l'origine d'un IED destin??le contourner pour desservir le march?local. D'autres types d'obstacles ?l'importation peuvent 関idemment avoir le m阭e effet. Ce n'est pas par hasard que les constructeurs automobiles japonais ont commenc??produire dans l'Union europ閑nne et aux Etats-Unis apr鑣 qu'eurent 閠?pass閟 les accords de limitation volontaire des exportations restreignant le nombre d'automobiles qui pouvaient 阾re exp閐i閑s du Japon. L'IED peut aussi servir ?d閟amorcer une menace protectionniste. Ces investissements quid pro quo sont motiv閟 par l'id閑 que le co鹴 additionnel li??la production sur le march?閠ranger est plus que compens?par le fait qu'il y a moins de risques d'阾re assujetti ?de nouveaux obstacles ?l'importation pour les exportations existantes vers ce march? Il appara顃 par exemple que la menace protectionniste per鐄e a eu une incidence tr鑣 importante sur les IED japonais aux Etats-Unis dans les ann閑s 80 et que ces investissements ont r閐uit le risque d'阾re soumis ult閞ieurement ?une protection contingente du fait de mesures antidumping et de mesures au titre de la clause de sauvegarde.
Si certains pays d'accueil ont volontairement recours ?des droits 閘ev閟 pour attirer l'investissement, les avantages de cette politique paraissent limit閟. L'IED attir?vers des march閟 prot間閟 rev阾 g閚閞alement la forme d'unit閟 de production ind閜endantes, ax閑s sur le march?int閞ieur et qui ne sont pas comp閠itives quand il s'agit de produire pour l'exportation. De fait, les droits 閘ev閟 sur les mati鑢es premi鑢es et les biens interm閐iaires import閟 peuvent r閐uire encore la comp閠itivit?au plan international, en particulier si les intrants locaux sont co鹴eux ou de qualit?m閐iocre (ce qui semble 阾re le cas puisqu'on juge bon de prot間er les producteurs nationaux de ces produits). Pour contrer les effets n間atifs des droits 閘ev閟 applicables aux intrants, les pays d'accueil mettent souvent en place des r間imes de ristourne des droits pour les intrants 閠rangers servant ?produire pour l'exportation. C'est l?un 閘閙ent de l'ensemble type d'incitations offertes aux investisseurs 閠rangers, en particulier dans les zones franches pour l'industrie d'exportation.
Un faible niveau de protection ?l'importation - en particulier s'il est consolid?- peut 阾re beaucoup plus attrayant pour l'IED ax?sur l'exportation que les r間imes de ristourne de droits. Si l'on compare les flux d'IED vers les march閟 relativement ouverts de certains pays d'Asie ?ceux qui sont destin閟 aux march閟 d'Am閞ique latine relativement prot間閟 (jusqu'?une 閜oque r閏ente), on constate que les premiers ont tendance ?attirer l'IED ax?sur l'exportation alors que les seconds attirent g閚閞alement l'IED ax?sur le march?local. Ces r閟ultats sont 閠ay閟 par une autre 閠ude selon laquelle, en 1992, le ratio des exportations aux ventes totales des filiales japonaises dans le secteur manufacturier en Asie 閠ait de 45%, alors que le chiffre correspondant pour les filiales japonaises en Am閞ique latine 閠ait d'?peine 23%.
Les faits confirment que les pays d'accueil qui souhaitent s'int間rer plus pleinement dans l'閏onomie mondiale ont pour strat間ie d'appliquer des droits de faible niveau - et que ces droits doivent 阾re consolid閟 pour rendre cr閐ible le r間ime tarifaire. Les d閏isions en mati鑢e d'investissement sont, de par leur nature m阭e, orient閑s vers le long terme et les investisseurs sont certains d'阾re affect閟 par les incertitudes entourant la durabilit?des r間imes de ristourne de droits et des autres programmes d'incitation, lesquels peuvent 阾re retir閟 ou modifi閟 si les autorit閟 le jugent bon.
Les accords commerciaux r間ionaux et l'IED
La taille du march?est un facteur important pour une soci閠?multinationale qui envisage un IED donn? En supprimant les obstacles internes au commerce, une zone de libre-閏hange ou une union douani鑢e donnent aux entreprises la possibilit?de desservir un march?int間r??partir d'un ou plusieurs sites de production, et par cons閝uent de tirer parti des 閏onomies d'閏helle. Cela peut avoir une nette incidence sur les flux d'investissement, tout au moins pendant la p閞iode o?les entreprises restructurent leurs activit閟 de production. Le programme du march?unique de l'Union europ閑nne s'est traduit par une activit?intense dans le domaine de l'investissement, tant ?l'int閞ieur de l'Union que vers celle-ci en provenance de pays tiers, et des effets analogues sur les flux d'IED ont 閠?observ閟 pour d'autres accords commerciaux r間ionaux.
La forme la plus courante d'accord commercial r間ional est celle qui 閠ablit une zone de libre-閏hange, laquelle diff鑢e d'une union douani鑢e en ce sens que chaque membre conserve son propre tarif ext閞ieur. Il est donc n閏essaire d'avoir des "r鑗les d'origine" pour d閠erminer si un produit qui a 閠?import?par l'un des membres et qui a subi une ouvraison additionnelle, est admis ?b閚閒icier du r間ime de franchise applicable entre les Etats membres (en d'autres termes, s'agit-il toujours d'un produit du pays tiers auquel il a 閠?achet?ou s'agit-il ?pr閟ent d'un produit du pays partenaire)? Etant donn?que les r鑗les d'origine peuvent avoir un effet protectionniste (sinon un but protectionniste), elles peuvent aussi avoir une incidence sur la localisation de l'IED. Par exemple, en vertu des r鑗les d'origine de l'ALENA, des v阾ements produits au Mexique b閚閒icient de l'acc鑣 en franchise sur le march?des Etats-Unis, ?condition de satisfaire ?la r鑗le “au niveau du fil?#148; qui, pour de nombreux produits, exige que la quasi-totalit?des intrants proviennent d'Am閞ique du Nord. Les fabricants de v阾ements mexicains ont le choix entre se procurer tous leurs intrants au-del?du stade de la fibre en Am閞ique du Nord pour obtenir le traitement applicable ?la zone de libre-閏hange et se procurer leurs intrants hors de l'ALENA, ?des co鹴s potentiellement inf閞ieurs, mais renoncer alors ?l'acc鑣 en franchise ?leur march?le plus important. Comme les droits NPF sur les v阾ements restent 閘ev閟, ils peuvent d閏ider de s'approvisionner dans l'ALENA plut魌 qu'en dehors. Cela incite 関idemment davantage les producteurs de textiles de pays tiers ? investir dans des installations de production implant閑s dans la zone de l'ALENA pour regagner les clients perdus que ne leur feraient des r鑗les d'origine moins restrictives.
Certains accords d'int間ration r間ionale ont 関olu?et sont devenus des syst鑝es “en 閠oile”. Cela arrive par exemple lorsque les membres d'une union douani鑢e signent des accords de libre-閏hange avec un pays X et un pays Y, mais qu'il n'existe pas d'accord de libre-閏hange liant X et Y - l'union douani鑢e est alors le “noeud central” et les pays X et Y les “branches”. Ces accords r間ionaux faussent la structure de l'IED parce qu'il existe une raison suppl閙entaire d'implanter l'IED dans le noeud central, d'o?il est possible d'acc閐er en r間ime de franchise aux trois march閟 plut魌 que dans l'une des branches, puisque les marchandises ne peuvent aller d'une branche ?l'autre en b閚閒iciant du r間ime de franchise.
Ces exemples montrent que la politique commerciale peut avoir une incidence significative sur les flux d'IED. La relation inverse existe aussi, comme il est indiqu?dans la section suivante.
3) Incidence de l'IED sur le commerce
On pr閠end souvent que l'IED r閐uit les exportations du pays d'origine et/ou accro顃 ses importations, et a donc des cons閝uences n間atives sur l'emploi et la balance des paiements de ce pays. D'autres en revanche pensent que l'IED r閐uit les importations du pays d'accueil et/ou accro顃 ses exportations. Ces points de vue ont leur origine dans la th閛rie traditionnelle concernant l'IED, laquelle repose sur l'id閑 qu'il est possible d'utiliser la production 閠rang鑢e en remplacement des exportations ?destination des march閟 閠rangers.
Deux faits expliquent en grande partie cette th閛rie traditionnelle selon laquelle l'IED et les exportations du pays d'origine sont substituables. Premi鑢ement, un article th閛rique important, publi?en 1957, d閙ontre que, selon certaines hypoth鑣es restrictives (simplifi閑s), la libre circulation des capitaux (et de la main-d'oeuvre) pouvait se substituer ?la libert?des 閏hanges - c'est-?dire que la libert?totale de circulation des facteurs de production aurait les m阭es r閟ultats que la libert? totale de circulation des marchandises et des services. Une relation de substitution entre les flux de capitaux et le commerce est manifestement au coeur de cette analyse. Deuxi鑝ement, les politiques de remplacement des importations ont 閠?tr鑣 en vogue dans de grandes r間ions du monde en d関eloppement jusqu'au d閎ut des ann閑s 80. Comme on l'a d閖?vu, les obstacles 閘ev閟 ?l'importation encourageaient - comme le souhaitaient souvent express閙ent les gouvernements qui les imposaient - l'IED destin? ?contourner les droits, le r閟ultat 閠ant que la production locale rempla鏰it les importations.
Quelle que soit son origine, cette th閛rie traditionnelle qui consid鑢e que le commerce et l'IED sont substituables ne tient pas compte de la complexit?des relations dans l'閏onomie mondiale contemporaine. Pour commencer, le simple fait que, par suite de l'IED, certaines exportations du pays d'origine sont 関inc閑s par la production du pays d'accueil, ne signifie pas n閏essairement que les exportations totales du pays d'origine vers le march?d'accueil diminuent. Prenons le cas d'une entreprise qui dans un premier temps se voit refuser la possibilit?d'effectuer des IED et dessert le march? 閠ranger en exportant. Si l'entreprise est ensuite autoris閑 ?investir dans le pays 閠ranger, l'effet total sur les exportations du pays d'origine r閟ulte de plusieurs facteurs dynamiques. Premi鑢ement, pour des niveaux de ventes donn閟 sur le march? 閠ranger et ?condition que les activit閟 de production qui ont lieu dans ce qui est maintenant une soci閠?multinationale soient les m阭es qu'avant la lib閞alisation, il pourrait y avoir un remplacement des exportations ant閞ieures du produit final par les nouvelles productions sur le march?閠ranger (d'accueil). Les exportations de biens interm閐iaires ou de services du pays d'origine pourraient s'en trouver stimul閑s mais, la production totale du produit final ou du service de la multinationale restant inchang閑, cela ne suffirait pas ?emp阠her une baisse globale des exportations.
Toutefois, la raison d'阾re de l'investissement est sans doute d'am閘iorer la position comp閠itive de l'entreprise dans le secteur par rapport ?celle d'autres entreprises, tant dans le pays d'origine qu'?l'閠ranger. Cette am閘ioration de la position comp閠itive peut 阾re due au fait que l'entreprise a acc鑣 ?de la main-d'oeuvre ou ?des intrants mat閞iel meilleur march?mais elle peut d閏ouler aussi d'un abaissement des co鹴s des transactions, du rapprochement des consommateurs locaux, etc. Les ventes totales devraient augmenter par suite de l'investissement, ce qui ?son tour entra頽era un accroissement de la demande de biens interm閐iaires de la filiale. De ce fait, les exportations du pays d'origine augmenteront, dans la mesure o?la filiale continue d'acheter les biens interm閐iaires et les services ?la soci閠?m鑢e ou ?d'autres entreprises dans le pays d'origine. Pour autant que la filiale se procure ses intrants dans le pays d'origine et que les ventes totales de la soci閠?multinationale augmentent (sur le march?du pays d'accueil et/ou dans des pays tiers), il pourrait y avoir un accroissement net des exportations totales du pays d'origine (il est probable bien s鹯 que la composition des exportations se modifiera au profit des biens interm閐iaires et des services). En outre, si l'IED stimule la croissance 閏onomique dans le pays d'accueil, comme cela semble 阾re le cas (voir ci-dessous), il en r閟ultera une augmentation de la demande d'importations, y compris en provenance du pays d'origine.
Voyons maintenant l'incidence de l'IED sur les importations du pays d'origine. Une partie (et peut-阾re la totalit? des intrants qui 閠aient import閟, avant l'IED, pour 阾re utilis閟 dans la production maintenant relocalis閑 ?l'閠ranger ne sera plus import閑 dans le pays d'origine apr鑣 que l'IED aura eu lieu. Par ailleurs, la filiale 閠rang鑢e pourra commencer ?desservir le march?du pays d'origine et, dans ce cas, les importations du produit final augmenteront. L?encore, en raison de ces effets et d'autres effets pouvant se neutraliser, il n'y a aucune raison en soi de consid閞er l'IED et les importations du pays d'origine comme 閠ant soit substituables soit compl閙entaires.
La discussion a port?jusqu'ici sur la complexit?des relations entre l'IED et le commerce du pays d'origine. Mais il faut pr閏iser que, souvent pour les m阭es raisons, il n'est pas plus facile de d閠erminer ?priori la relation entre l'IED et le commerce du pays d'accueil. L?encore, on ne peut traiter la question de la relation entre l'IED et le commerce qu'en se remettant aux faits. Cela est particuli鑢ement vrai car les effets plus vari閟 et en grande partie dynamiques de l'IED dans le pays d'accueil - comme l'閘an donn??la concurrence, ?l'innovation, ?la productivit? ?l'閜argne et ?la formation de capital - peuvent 阾re importants. Etant donn?que ces effets, et d'autres effets dynamiques li閟 ?l'IED, influeront probablement sur le niveau et la composition par produit des importations et exportations du pays - y compris ses 閏hanges avec le pays d'origine - il est 関ident que la relation entre le commerce et l'IED est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense souvent.
Avant d'en venir aux preuves empiriques, il faut souligner quatre points. Premi鑢ement, la th閛rie ne s'est gu鑢e montr閑 utile pour les travaux empiriques. Inversement, il est tr鑣 risqu?de tirer des conclusions g閚閞ales d'閠udes de cas. Deuxi鑝ement, du fait que les probl鑝es de donn閑s se posent en particulier dans le cas des industries de service, la plupart des recherches sur l'IED sont ax閑s sur les marchandises. Le manque de recherches empiriques sur l'IED dans le secteur des services est de plus en plus g阯ant, 閠ant donn?le r鬺e croissant des services dans la production, le commerce et l'investissement. Troisi鑝ement, les travaux th閛riques sont largement consacr閟 ? l'analyse de l'incidence d'un investissement (marginal) donn? A la limite, l'investissement marginal peut avoir des cons閝uences tr鑣 diff閞entes de celles qui d閏oulent de l'ensemble du r間ime en mati鑢e de commerce et d'IED. Enfin, les travaux empiriques sur l'IED souffrent g閚閞alement du manque de donn閑s et leur qualit?n'est pas toujours satisfaisante (voir l'Encadr?1). De ce fait, les recherches empiriques sur les soci閠閟 multinationales ne d閜assent pas le cadre de quelques pays, notamment les Etats-Unis, la Su鑔e et le Japon.
4) Commerce du pays d'origine: ce que les statistiques montrent
La relation entre les flux sortants d'IED des Etats-Unis et les exportations de ce pays a fait l'objet de plusieurs 閠udes. Les premi鑢es, fond閑s sur des donn閑s des ann閑s 70, ont conclu ? l'existence d'une relation positive entre les exportations d'une cat間orie de produits donn閟 des Etats-Unis vers un pays et le niveau de la production des soci閠閟 multinationales des Etats-Unis dans ce pays, l'effet 閠ant plus marqu?pour les filiales implant閑s dans des pays en d関eloppement. Les analyses de l'effet de la production des filiales sur les exportations totales des soci閠閟 m鑢es vers toutes les destinations sugg閞aient que le d閠ournement des exportations des Etats-Unis vers les pays tiers, s'il existait, n'閠ait pas suffisant pour neutraliser les effets positifs sur les exportations des soci閠閟 m鑢es vers les pays d'accueil. Dans chaque secteur, pour les soci閠閟 multinationales des Etats-Unis dont la production ?l'閠ranger 閠ait sup閞ieure ?la moyenne sectorielle, on enregistrait aussi des exportations des Etats-Unis sup閞ieures ?la moyenne. Une autre 閠ude montrait que, dans environ 80% des secteurs, la production des filiales ?participation majoritaire des Etats-Unis n'閠ait pas li閑 ou 閠ait li閑 par une relation positive aux exportations des entreprises des Etats-Unis dans le m阭e secteur.
Une 閠ude plus r閏ente sur la relation entre l'encours de l'IED des Etats-Unis et des exportations des Etats-Unis, fond閑 sur des donn閑s pour 1980, 1985 et 1990, concluait que les exportations de ce pays 閠aient li閑s de mani鑢e positive et significative ? l'encours de l'IED des Etats-Unis, et ce pour chacune des trois ann閑s. En 1990, par exemple, une augmentation de 1% de l'encours de l'IED dans un pays d'accueil s'accompagnait d'une progression de 0,25% des exportations des Etats-Unis vers ce pays. Suivant une m閠hode statistique diff閞ente, destin閑 ?corriger (entre autres choses) la tendance que les soci閠閟 multinationales des Etats-Unis pourraient avoir ?exporter vers les grands march閟 plut魌 que vers les petits march閟 et ?y effectuer des investissements, une 閠ude encore plus r閏ente a confirm?la relation de compl閙entarit?entre l'IED et les exportations pour l'ensemble du monde, ainsi que pour les pays de l'Asie de l'Est et les pays d'Europe. La relation apparente d'opposition ou de substitution pour les pays de l'h閙isph鑢e occidental pourrait s'expliquer par les politiques de remplacement des importations adopt閑s par les pays d'Am閞ique latine pendant les ann閑s 70 et au d閎ut des ann閑s 80.
La conclusion g閚閞ale des 閠udes portant sur les soci閠閟 multinationales su閐oises est que les ventes des filiales 閠rang鑢es, dans la mesure o?elles influent sur les exportations de la Su鑔e, contribuent de mani鑢e positive aux exportations du pays d'origine. Des r閟ultats analogues ont 閠?obtenus pour l'Allemagne, l'Autriche et le Japon.
Il y a eu relativement peu de travaux empiriques visant ?関aluer l'incidence des flux sortants d'IED sur les importations du pays d'origine. Il appara顃 que le volume des investissements des Etats-Unis ?l'閠ranger n'influe pas de mani鑢e significative sur les importations de ce pays. En revanche, un volume donn?d'investissements directs du Japon ?l'閠ranger se traduit par deux fois plus d'importations que d'exportations pour ce pays; les flux sortants d'IED d'Allemagne quant ?eux ont probablement stimul? les importations de ce pays au d閎ut des ann閑s 80 mais pas n閏essairement ?la fin de la d閏ennie. Une 閠ude r閏ente montre que, dans le cas des Etats-Unis, il y avait quelques preuves 閠ablissant l'existence d'une relation positive entre l'encours de l'IED et les importations dans le secteur manufacturier alors que, pour l'IED au Japon, les r閟ultats n'閠aient pas concluants.
En r閟um? la recherche empirique donne ?penser que, dans la mesure o?il existe un lien syst閙atique entre l'IED et les exportations du pays d'origine, celui-ci est positif mais pas tr鑣 marqu? A coup s鹯, il n'y a pas de donn閑s empiriques s閞ieuses permettant de penser que l'IED a un effet n間atif important sur le niveau global des exportations du pays d'origine. Il y a moins de preuves de la relation entre l'IED et les importations du pays d'origine mais celles qui existent tendent ?montrer que la relation est positive mais peu nette.
5) Commerce du pays d'accueil: ce que les statistiques montrent
Des 閠udes d閠aill閑s sur l'IED dans le secteur des industries extractives et des autres industries de ressources ont confirm?l'existence d'une tr鑣 nette corr閘ation positive entre l'IED et les exportations du pays d'accueil. Plusieurs 閠udes portant sur un large 関entail de secteurs ont aussi conclu ?l'existence d'une corr閘ation positive marqu閑 entre les flux entrants globaux d'IED et les exportations globales des pays d'accueil.
Des preuves indirectes fond閑s sur des 閠udes sectorielles montrent que les IED sont souvent effectu閟 par des soci閠閟 qui exportent d閖?en grande quantit? Ces constatations sont 閠ay閑s par des 閠udes qui concluent que les entreprises 閠rang鑢es ont tendance ?exporter une plus grande part de leur production que leurs homologues appartenant ? des nationaux. C'est peut-阾re que les entreprises 閠rang鑢es ont g閚閞alement un avantage comparatif tenant ?leurs connaissances des march閟 internationaux, ?la taille et ?l'efficacit?de leurs r閟eaux de distribution et ?leur capacit?de r閍gir rapidement ?l'関olution de la structure de la demande sur les march閟 mondiaux. Les filiales 閠rang鑢es peuvent aussi avoir un effet d'entra頽ement sur la propension des entreprises locales ?exporter. Des donn閑s empiriques provenant de l'Asie du Sud-Est tendraient ?confirmer ce processus d'apprentissage des entreprises locales, et il est prouv?que les entreprises mexicaines situ閑s ?proximit?de soci閠閟 multinationales 閠rang鑢es ont tendance ?exporter une part plus importante de leur production que les autres entreprises mexicaines.
Il peut aussi y avoir des liens fond閟 sur les politiques entre l'IED et les exportations du pays d'accueil. Les prescriptions de r閟ultat selon lesquelles les filiales des soci閠閟 multinationales doivent exporter une partie de leur production, et les incitations ?l'IED qui sont r閟erv閑s aux secteurs ax閟 sur l'exportation ou les favorisent sont des exemples de politiques qui peuvent produire (ou renforcer) une corr閘ation positive entre les flux entrants d'IED et les exportations.
Un exemple frappant ?cet 間ard est celui des zones franches pour l'industrie d'exportation. De nombreuses entreprises 閠rang鑢es ont 閠abli des op閞ations dans ces zones, qui ont 閠?mises en place par les gouvernements des pays d'accueil dans le but de stimuler les exportations, l'emploi, l'am閘ioration des comp閠ences et le transfert de technologie. S'il n'y a pas de tendance tr鑣 nette quant aux avantages que les zones franches pr閟entent pour les pays d'accueil, en particulier du point de vue des liens avec le reste de l'閏onomie, il semble 阾re g閚閞alement admis que ces zones ont jou? un r鬺e positif en stimulant les exportations des pays, en particulier au d閎ut lorsqu'elles ont encourag?le d関eloppement des exportations de produits ?forte intensit?de main-d'oeuvre.
S'agissant des liens r閏iproques entre l'IED et les importations des pays d'accueil, certaines 閠udes indiquent que les flux entrants d'IED soit n'ont pas d'incidence sur les importations du pays d'accueil soit r閐uisent l間鑢ement le niveau des importations. Toutefois, la plupart des recherches empiriques donnent ?penser que ces flux ont tendance ?accro顃re les importations du pays d'accueil. L'une des raisons en est que les soci閠閟 multinationales ont souvent une forte propension ?importer des biens interm閐iaires, des biens d'閝uipement et des services qu'il n'est pas facile de trouver dans les pays d'accueil. Sont incluses les importations de biens interm閐iaires et de services provenant de la soci閠?m鑢e qui sont tout ?fait sp閏ifiques ? l'entreprise. Des pr閛ccupations concernant la qualit?ou la fiabilit?des intrants locaux peuvent 間alement jouer un r鬺e ?cet 間ard.
Pour r閟umer, les preuves disponibles donnent ?penser que l'IED et les exportations du pays d'accueil sont compl閙entaires et qu'il existe une relation moins nette mais toujours positive entre l'IED et les importations du pays d'accueil. Si l'on exclut le lien de compl閙entarit?apparemment plus fort entre l'IED et les exportations du pays d'accueil (qu'entre l'IED et les exportations du pays d'origine), ces r閟ultats sont tr鑣 proches de ceux qui ont 閠?obtenus au sujet de la relation entre l'IED et le commerce du pays d'origine.
III. Investissement 閠ranger direct: co鹴s et avantages per鐄s
1) G閚閞alit閟
Etudi閑 dans le chapitre pr閏閐ent, l'incidence de l'IED sur le commerce des pays d'accueil et des pays d'origine est apparue comme g閚閞alement positive. On s'attachera tout d'abord dans la pr閟ente section ?analyser plus en d閠ail deux th鑝es bri鑦ement abord閟 dans la section pr閏閐ente, ?savoir les aspects de l'IED li閟 au “transfert de technologie” et ?l'“emploi”; on 閠udiera ensuite les cons閝uences de la surench鑢e ? laquelle se livrent les pays pour attirer les IED. Cependant, avant d'en venir ?ces th鑝es, on examinera tr鑣 bri鑦ement les “co鹴s” les plus souvent d閚onc閟 par les d閠racteurs de l'IED.
L'histoire montre que l'importance des co鹴s et des avantages de l'IED alimente d'鈖res controverses. D'un c魌? ses partisans mettent ?son cr閐it un transfert de technologie vers les pays d'accueil, une expansion du commerce, des cr閍tions d'emplois, une acc閘閞ation du d関eloppement 閏onomique et une int間ration aux march閟 mondiaux. D'un autre c魌? ses d閠racteurs l'accusent de cr閑r des probl鑝es de balance des paiements, de permettre une exploitation du march?du pays d'accueil et, d'une mani鑢e g閚閞ale, de r閐uire la capacit?de ce dernier de g閞er son 閏onomie. Le d閎at a fait appara顃re une tendance de plus en plus favorable ?l'IED ces derni鑢es ann閑s, de plus en plus de pays ayant adopt?des strat間ies de d関eloppement fond閑s sur une int間ration accrue au march?mondial, mais les critiques n'en continuent pas moins ?se faire entendre.
L'id閑 que les afflux de capitaux profitent au pays d'accueil repose sur le postulat que l'augmentation des revenus du pays d'accueil ?mettre au compte de l'investissement sera sup閞ieure ?l'accroissement des revenus de l'investisseur. Autrement dit, le pays d'accueil est gagnant aussi longtemps que l'IED augmente la production nationale et que cette augmentation n'est pas totalement accapar閑 par l'investisseur. Ces avantages peuvent prendre la forme d'une hausse des salaires r閑ls pour la main-d'oeuvre locale, d'une baisse des prix et/ou d'une am閘ioration de la qualit?des produits pour le consommateur et d'une augmentation des recettes fiscales pour l'Etat. L'IED a encore, via les externalit閟, d'autres retomb閑s b閚閒iques sur lesquelles on reviendra par la suite, ?propos du transfert de technologie.
Pour les adversaires de l'IED, le tableau est trompeur ou du moins incomplet car il passe sous silence les effets fr閝uemment n閒astes qu'ils lui attribuent, ?savoir:
Effets sur la balance des paiements. Les d閠racteurs font valoir que si l'afflux d'IED peut avoir, dans un premier temps, un effet b閚閒ique sur la balance des paiements du pays d'accueil, il a un impact souvent n間atif ?moyen terme lorsque la multinationale accro顃 ses importations de biens interm閐iaires et de services et commence ?rapatrier ses b閚閒ices. L'id閑 d関elopp閑 dans la section pr閏閐ente selon laquelle il y aurait une compl閙entarit?plus forte entre l'IED et les exportations du pays d'accueil qu'entre l'IED et les importations du pays d'accueil est encore valable ici. Il en va de m阭e du constat selon lequel l'IED est, dans les pays tr鑣 protectionnistes, moins tourn?vers les exportations que l'IED dans les pays faiblement protectionnistes. Il faut bien s鹯 prendre 間alement en compte le rapatriement des b閚閒ices.
Supposons que, dans une situation particuli鑢e, la demande de devises suscit閑 par l'afflux d'IED exc鑔e en fin de compte l'offre de devises g閚閞閑 par ces m阭es investissements. Est-ce une raison suffisante pour rejeter l'IED?
La r閜onse d閜end bien 関idemment de la comparaison qui peut 阾re faite entre les “co鹴s” de l'IED li閟 ?son incidence sur le march?des changes et les “avantages” retir閟 du transfert de technologie et d'effets dynamiques comme l'augmentation de l'閜argne et de l'investissement int閞ieurs. On y reviendra plus en d閠ail par la suite. S'agissant des “co鹴s”, il importe de se souvenir que l'incidence de l'IED sur la balance des paiements d閜end du r間ime des changes. Dans un syst鑝e de taux de change flottants, toute rupture de l'閝uilibre entre l'offre et la demande de devises est corrig閑 par une variation du taux de change, en l'occurrence une d閜r閏iation.
Si le pays a au contraire un r間ime de taux de change fixes, un accroissement net de la demande de devises de la part du projet d'IED aura pour effet de r閐uire l'exc閐ent ou de creuser le d閒icit de la balance des paiements. Il importe toutefois de replacer les choses dans leur perspective. Premi鑢ement, le constat dont il a 閠?fait 閠at plus haut donne r閟olument ?penser que, en moyenne, l'apport d'IED a un impact positif plus grand sur les exportations du pays d'accueil que sur ses importations. Les probl鑝es de balance des paiements, si probl鑝es il y a, seront d鑣 lors probablement mineurs. Deuxi鑝ement, l'IED est loin d'阾re l'unique source des fluctuations de la demande et de l'offre de devises et, en cas de perturbations, les gouvernements ont r間uli鑢ement recours ?des mesures mon閠aire, budg閠aire et de taux de change pour maintenir le solde des op閞ations courantes dans les limites du supportable. Troisi鑝ement, l'IED est susceptible de g閚閞er des gains dont l'avantage net pour l'閏onomie peut exc閐er le co鹴 d'une 関entuelle perturbation de la balance des paiements.
Structure du march?int閞ieur. Prenant argument de leur poids 閏onomique, g閚閞alement sup閞ieur ?celui des concurrents int閞ieurs, on fait valoir que les multinationales peuvent se livrer dans le pays d'accueil ?diverses pratiques restrictives qui entra頽ent une hausse des profits, une baisse de l'efficacit? des restrictions ?l'entr閑, etc. Si les IED ont 閠? attir閟 par les droits de douane du pays d'accueil, on risque d'assister ?un afflux de soci閠閟 閠rang鑢es agissant par mim閠isme, d'o?une diff閞enciation excessive des produits et une prolif閞ation de petites unit閟 de production inefficaces (l'exemple de la production automobile en Am閞ique latine dans les ann閑s 60 et 70 vient ici ? l'esprit). A l'inverse, naturellement, l'incursion d'une multinationale peut avoir pour effet de briser la structure oligopolistique, si commode, du march?int閞ieur et de stimuler la concurrence et l'efficacit? Il faut bien 関idemment tenir compte des politiques antitrust du pays d'accueil qui s'appliquent tant aux multinationales qu'aux entreprises nationales. En bref, il n'est pas facile de dire ?priori quels pourraient 阾re les effets de l'IED sur la structure, le comportement et l'関olution du march? dans les pays d'accueil. Cependant, les donn閑s empiriques mettent largement en 関idence les effets favorables ?la concurrence.
Politique 閏onomique et souverainet?nationales. Les adversaires de l'IED expriment aussi des inqui閠udes au sujet de ses effets sur la politique publique, de la vuln閞abilit?aux pressions des Etats 閠rangers et des int閞阾s nationaux du pays d'accueil. Ils font valoir que, du fait de ses relations internationales, la filiale d'une multinationale a des solutions de rechange que n'ont pas les entreprises d閠enues par les nationaux, et qu'elles peuvent ainsi, entre autres choses, se soustraire aux politiques publiques. Par exemple, confront閑s dans le pays d'accueil ?une r間lementation sociale ou environnementale nouvelle qui rench閞it les co鹴s de production, la multinationale peut plus facilement transf閞er ses activit閟 dans un autre pays. Pouvant ais閙ent emprunter ? l'ext閞ieur, elle peut mettre en 閏hec les contr鬺es macro-閏onomiques directs institu閟 pour pr閟erver les 閝uilibres internes ou externes. La crainte d'une vuln閞abilit?aux pressions des Etats 閠rangers et de son impact sur les int閞阾s nationaux des pays d'accueil vient de ce que la filiale d'une multinationale est responsable envers deux autorit閟 politiques: le gouvernement du pays d'accueil et le gouvernement du pays o?la soci閠?m鑢e a son si鑗e.
Ce sont l?des inqui閠udes compr閔ensibles. Cependant, une fois encore, il est important de les replacer dans leur perspective. Il faut comparer les co鹴s li閟 ?ces inqui閠udes (calcul tr鑣 subjectif, on l'admet) ?ceux que l'on encourt en renon鏰nt aux avantages dont s'accompagnerait l'IED. Au surplus, un accord multilat閞al sur l'IED pourrait dissiper un grand nombre de ces inqui閠udes. L'institution de disciplines multilat閞ales serait par exemple un moyen de mettre fin ?la qu阾e du r間ime le plus avantageux ?laquelle se livrent les multinationales d閟ireuses d'閏happer aux r間lementations nationales. De m阭e, un accord multilat閞al servirait de cadre au r鑗lement des diff閞ends relatifs au comportement des multinationales impliquant autorit閟 du pays d'accueil et autorit閟 du pays d'origine. De surcro顃, ?en juger par les accords d'investissement bilat閞aux, r間ionaux et plurilat閞aux, il est probable qu'un accord multilat閞al permettrait aux Etats signataires d'exciper du caract鑢e sensible de certains secteurs.
2) Investissement 閠ranger direct et transfert de technologie
Parmi les raisons qui expliquent le changement d'attitude de nombreux pays en d関eloppement ou en transition vis-?vis de l'IED, il y a la conviction que ce peut 阾re un vecteur important pour les transferts de technologies, la technologie s'entendant ici non seulement des proc閐閟 scientifiques mais aussi des comp閠ences en mati鑢e d'organisation, de gestion et de commercialisation. La pr閟ente section analyse tout d'abord la fa鏾n dont les IED peuvent, par les transferts de technologies, favoriser une utilisation plus efficace des ressources locales; elle passe ensuite en revue les donn閑s empiriques dont on dispose en ce domaine. Si l'accent est mis sur l'incidence que peut avoir l'IED sur l'efficacit?des entreprises d閠enues par les nationaux, il est ?noter que le pays d'accueil peut aussi tirer profit du fait que la filiale d'une multinationale est elle-m阭e susceptible d'utiliser plus efficacement les ressources locales en raison de sa sup閞iorit? technologique.
Comment l'IED favorise une utilisation plus efficace des ressources du pays d'accueil
Comme le donne ?penser l'閠ude des motivations qui am鑞ent une entreprise ?prendre la d閏ision de proc閐er ?un IED, il y a de bonnes raisons de croire que les multinationales sont un important vecteur pour le transfert direct et indirect de technologies entre les pays. La sup閞iorit?technologique ou la capacit?d'innovation figure en bonne place parmi les attributs sur lesquels une entreprise r閍lisant un IED compte pour compenser le handicap qu'elle a au plan des co鹴s vis-?vis des entreprises locales du fait de ses op閞ations ?l'閠ranger. La sup閞iorit?technologique de nombre de multinationales a conduit les chercheurs ?mettre l'accent sur l'am閘ioration de l'efficacit?qu'entra頽ent leurs investissements ?l'閠ranger.
L'IED a tr鑣 souvent des effets b閚閒iques secondaires en raison de la diffusion des technologies qu'il entra頽e dans le pays d'accueil. Cette diffusion peut 阾re d閘ib閞閑, par exemple lorsque la filiale c鑔e une licence ?une entreprise locale, ou peut prendre la forme de retomb閑s technologiques, les activit閟 de la multinationale profitant, ?son insu, aux agents 閏onomiques locaux.
A titre d'exemple de diffusion d閘ib閞閑, on citera le cas d'une multinationale qui renforce les capacit閟 technologiques des entreprises locales traitant avec elle pour leur permettre de satisfaire aux sp閏ifications techniques qu'elle leur impose. Les retomb閑s technologiques peuvent 阾re horizontales ou verticales. Il y a retomb閑s technologiques horizontales lorsque, par exemple, la filiale a une technologie nouvelle qui est ult閞ieurement copi閑 ou assimil閑 par les entreprises concurrentes. Il y a retomb閑s verticales lorsque la filiale transf鑢e, ?titre gratuit, une technologie aux entreprises qui lui fournissent des intrants ou des services en aval (distribution ou vente au d閠ail par exemple). Exemple de ce que les 閏onomistes appellent les “externalit閟 positives”, les retomb閑s technologiques ont ceci de particulier que les bienfaits qu'elles apportent au pays d'accueil n'entrent pas en ligne de compte dans la d閏ision d'investissement de la multinationale. Le pays d'accueil peut tirer pleinement parti de ces retomb閑s si, en rivalisant avec les autres pays pour attirer l'IED, il n'a pas renonc??tout ou partie de ces avantages indirects au profit de la multinationale (pour plus de d閠ails, voir ci-apr鑣).
Par ailleurs, l'IED peut 間alement avoir d'autres effets non voulus sur l'efficacit? lorsque, par exemple, les entreprises locales sont oblig閑s de renforcer leurs capacit閟 technologiques face ?la pression concurrentielle de la filiale locale de la multinationale. Aux Etats-Unis par exemple, l'irruption des constructeurs automobiles japonais sur le march?local par suite d'IED a amen?les grandes firmes automobiles am閞icaines (elles-m阭es multinationales) ?am閘iorer la qualit?de leurs propres produits et ?accro顃re l'efficacit?de leurs unit閟 de production locale. L'ensemble des consommateurs en ont profit?aux Etats-Unis, qu'ils ach鑤ent des automobiles japonaises ou am閞icaines. Il est tout ?fait manifeste qu'il y a des retomb閑s similaires dans les pays en d関eloppement. Ainsi, les IED cor閑ns ont contribu?au d関eloppement des entreprises locales exportatrices de v阾ements au Bangladesh.
Dans maintes circonstances, l'IED peut entra頽er une diffusion plus large du savoir-faire que d'autres fa鏾ns de servir le march? Si les importations de produits de haute technologie, ainsi que l'achat de technologies 閠rang鑢es ou l'octroi de licences, contribuent largement ?la diffusion internationale de la technologie, l'IED peut avoir davantage de retomb閑s. Ainsi, la technologie et la productivit?des entreprises locales peuvent s'am閘iorer lorsque des entreprises 閠rang鑢es prennent pied sur le march?et pr閟entent de nouvelles technologies et de nouveaux modes d'organisation et de distribution, fournissent une assistance technique ?leurs fournisseurs et clients locaux, et forment des travailleurs et des cadres qui seront peut-阾re ult閞ieurement recrut閟 par les entreprises locales. Les filiales 閠rang鑢es peuvent elles-m阭es faire de la recherche-d関eloppement pour adapter les nouvelles techniques mises au point par la soci閠?m鑢e aux conditions locales. Il est manifeste que l'IED favorise plus les contacts avec les 閠rangers et la d閏ouverte de nouvelles fa鏾ns de proc閐er que ne le fait le commerce.
Ce que les donn閑s empiriques montrent
Les 閠udes empiriques consacr閑s au r鬺e de l'IED dans le transfert et la diffusion des technologies abordent le probl鑝e de diff閞entes fa鏾ns. La plupart 閠ablissent que l'IED favorise une am閘ioration de l'efficacit?des entreprises d閠enues par des nationaux mais elles ne permettent pas aux auteurs de pr閏iser par quel biais s'exerce cette influence.
Il s'av鑢e que, dans les cinq premi鑢es ann閑s de leur commercialisation, les nouvelles technologies se diffusent ?l'閠ranger essentiellement par le biais des filiales des multinationales et non pas des exportations. Il appara顃 au surplus que, dans la plupart des cas, les technologies transf閞閑s aux filiales sont en moyenne plus r閏entes que celles qui sont c閐閑s ?des tiers par le jeu de licences ou dans le cadre de coentreprises. Ces constatations recoupent les r閟ultats d'une 閠ude qui montrent que les transferts de technologies au profit des filiales de multinationales l'emportent sur toutes les autres formes de transfert d'un pays ?l'autre. Une autre 閠ude analyse les effets, sur la croissance 閏onomique, de deux variables li閑s au transfert de technologie: les importations de machines et de mat閞iel de transport ne paraissent pas avoir d'impact alors que les apports d'IED ont une influence positive non n間ligeable sur les taux de croissance du revenu, au moins dans les pays en d関eloppement ?revenu relativement 閘ev?
Les 閠udes consacr閑s ?l'industrie manufacturi鑢e dans plusieurs pays d'accueil montrent que l'IED a un effet favorable sur la productivit?des entreprises locales. Au Mexique, par exemple, il a 閠?閠abli que plus la pr閟ence des multinationales 閠rang鑢es dans une branche d'activit?est forte, plus 閘ev閑 est la productivit?du travail et plus grande est la rapidit?avec laquelle le taux de productivit?se rapproche du taux enregistr?dans le secteur correspondant aux Etats-Unis. Ces r閟ultats corroborent les conclusions d'閠udes ant閞ieures men閑s au Mexique, en Australie et au Canada. Cependant, d'autres 閠udes empiriques ont constat?une corr閘ation beaucoup plus faible, voire n間ative, entre la pr閟ence de multinationales et la productivit?des entreprises manufacturi鑢es appartenant ?des nationaux. Ces constatations apparemment contradictoires pourraient s'expliquer par le fait que diverses caract閞istiques de la branche et du pays d'accueil peuvent influer sur l'incidence de l'IED. Ainsi, il appara顃 que les transferts de technologies de la soci閠?m鑢e 閠rang鑢e aux filiales locales augmentent avec le niveau d'instruction de la main-d'oeuvre, avec la formation de capital fixe, avec la concurrence locale et avec la r閐uction du nombre de prescriptions touchant les filiales locales de soci閠閟 閠rang鑢es.
D'autres observations concernant les effets de l'IED sur les pays en d関eloppement confirment que celui-ci a sur la croissance 閏onomique un effet global positif ?la mesure du stock de ressources humaines (comp閠ences) du pays d'accueil et qu'il a 間alement une influence favorable sur l'investissement int閞ieur. Ce constat d'un r鬺e important des ressources humaines est ?rapprocher de l'id閑 suivant laquelle il ne peut y avoir de retomb閑s que si le pays d'accueil a une main-d'oeuvre qualifi閑 ?m阭e de faire profiter les entreprises locales des connaissances qu'elle a acquises aupr鑣 des multinationales. Ces r閟ultats, s'ils n'閠ablissent pas de fa鏾n p閞emptoire l'existence de retomb閑s technologiques, cr閑nt de fortes pr閟omptions. La compl閙entarit?関idente de l'IED et de l'investissement local cadre avec l'id閑 que, m阭e si les filiales de multinationales 関incent des concurrents locaux, le bilan est positif du fait des investissements r閍lis閟 par les autres entreprises locales dont les activit閟 se d関eloppent parall鑜ement ?celles de la multinationale.
Des recherches men閑s sur les zones urbaines en Chine ont montr?en premier lieu que les entreprises d閠enues par des 閠rangers croissaient plus vite que les autres et que, m阭e si l'on isolait les autres influences, l'IED appara顃 comme l'une des causes des disparit閟 de croissance entre les r間ions. Les recherches ont 間alement r関閘?que le volume des IED r閍lis閟 dans une r間ion donn閑 expliquait les diff閞ences observ閑s dans les taux de croissance des entreprises d閠enues par des nationaux. D'autres 閠udes tendent ?confirmer qu'avec le temps, les multinationales d関eloppent g閚閞alement dans les pays en d関eloppement des liaisons verticales, ce qui pourrait 阾re une cons閝uence des transferts technologiques. Deux 閠udes connexes consacr閑s ? l'industrie de l'閘ectronique grand public en Asie du Sud-Est ont montr?que, si dans ce secteur tr鑣 tourn?vers l'exportation les liaisons verticales entre les multinationales et leurs fournisseurs locaux 閠aient rares au moment de la premi鑢e 閠ude, elles 閠aient sensiblement plus importantes cinq ans plus tard. Les multinationales se tournant de plus en plus vers des fournisseurs locaux, on peut en d閐uire que ces derniers sont devenus plus comp閠itifs du fait, au moins en partie, des retomb閑s technologiques des IED.
Conclusions
Malgr?la difficult?qu'il y a ?mesurer les effets d'am閘ioration de l'efficacit?induits par l'IED et, ?plus forte raison, ?関aluer les biais par lesquels les transferts de technologie affectent la productivit?locale, il se d間age de la litt閞ature empirique d'importantes conclusions. Premi鑢ement, il appara顃 qu'on s'accorde g閚閞alement ?admettre que l'IED est un vecteur important, peut-阾re m阭e le plus important, pour le transfert de technologie vers les pays en d関eloppement. Deuxi鑝ement, beaucoup s'accordent 間alement ?admettre que l'IED entra頽e une augmentation de la productivit?dans les entreprises d閠enues par des nationaux, en particulier dans l'industrie manufacturi鑢e. Troisi鑝ement, l'importance des transferts de technologie auxquels l'IED donne lieu varie en fonction des caract閞istiques du secteur et du pays d'accueil. Une concurrence plus forte, une formation plus importante de capital fixe, un niveau d'instruction plus 閘ev? et des conditions moins restrictives impos閑s aux filiales sont autant d'閘閙ents qui favorisent les transferts de technologie.
3) L'investissement 閠ranger direct et la situation de l'emploi
L'IED et l'emploi dans le pays d'origine
Dans les pays d'origine - c'est-?dire principalement dans les pays membres de l'OCDE - le d閎at public s'est focalis?sur l'impact de l'IED sur les salaires et l'emploi. Pendant la n間ociation de l'Accord de libre-閏hange nord-am閞icain (ALENA) et au moment de sa ratification, des membres du Congr鑣 ont exprim?la crainte qu'?la faveur d'un resserrement des liens commerciaux avec le Mexique et d'une multiplication des investissements, l'Accord ne tire vers le bas les salaires aux Etats-Unis, et en particulier ceux de la main-d'oeuvre non qualifi閑. Des pr閛ccupations similaires se sont fait jour en Europe de l'Ouest ?la suite du resserrement des liens commerciaux avec l'Europe de l'Est et l'Asie et de la multiplication des investissements. Compte tenu des projections d閙ographiques, il sera encore beaucoup question de la relation entre les investissements 閠rangers, le commerce et l'emploi ?mesure que le syst鑝e commercial mondial 関oluera.
Les recherches empiriques consacr閑s aux effets de l'IED sur la situation de l'emploi dans le pays d'origine ont suivi une approche indirecte: partant de l'id閑 qu'une augmentation nette des exportations se traduirait par un accroissement net de l'emploi et qu'une augmentation nette des importations entra頽erait une diminution nette de l'emploi, elles ont 閠?centr閑s sur les liens qui unissaient l'IED au commerce. L'id閑 de base est que les exportations cr閑nt des emplois alors que les importations en d閠ruisent et que les filiales 閠rang鑢es se substituent aux unit閟 de production du pays d'origine pour approvisionner les march閟 externes et internes. Les donn閑s empiriques mettent largement ?mal cette derni鑢e hypoth鑣e. Pour ce qui est de la premi鑢e, il faudrait souligner que la notion de cr閍tion ou de destruction d'emplois n'est pas si simple. La question n'est pas en fait de savoir si un projet d'IED pris isol閙ent cr閑 ou d閠ruit des emplois mais si les IED pris globalement sont g閚閞ateurs ou non d'emplois dans le pays.
Des 閠udes effectu閑s aux Etats-Unis concluent ?une perte nette d'emplois sous l'effet des d閘ocalisations, et ce m阭e en tenant compte des cr閍tions d'emplois li閑s aux exportations de biens interm閐iaires vers les filiales. Cependant, d'autres 閏onomistes se montrent r閟erv閟 quant ?la m閠hode suivie et aux estimations qui en d閏oulent (et qui, en tout 閠at de cause, repr閟entent au plus 0,10% du total des emplois aux Etats-Unis). Une r閏ente 閠ude consacr閑 aux liens entre les investissements directs r閍lis閟 ?l'閠ranger et la situation de l'emploi a abouti au constat qu'on ne peut tirer aucune conclusion d閒initive quant au lien entre les flux sortants d'IED et l'emploi dans le pays d'origine.
Une 閠ude sur les liens entre les flux sortants d'IED et l'emploi du point de vue du commerce effectu閑 en France a montr?que les branches d'activit?qui avaient r閍lis?des investissements directs ?l'閠ranger de 1989 ?1992 閠aient principalement celles dans lesquelles l'augmentation des exportations avait entra頽?des cr閍tions plut魌 que des pertes d'emplois. D'autres 閠udes consacr閑s aux investissements 閠rangers ont abouti ?la conclusion que l'IED 閠ait le plus souvent motiv?par le d閟ir d'approvisionner les march閟 r間ionaux et non pas par la volont?de d閘ocaliser la production.
En fin de compte, l'effet de l'IED sur la situation de l'emploi dans le pays d'origine para顃 donc au plus limit?
L'IED et l'emploi dans le pays d'accueil
Qu'en est-il des effets de l'IED sur la situation de l'emploi dans les pays d'accueil? L'histoire montre que les avis sont tr鑣 partag閟, allant du plus favorable au plus d閒avorable. Du c魌? des avis d閒avorables, on fait valoir que les comp閠ences en mati鑢e de gestion et d'encadrement, les technologies et les contrats ?l'閠ranger offerts par les multinationales ne contribuent sans doute gu鑢e au d関eloppement de la source locale de ces ressources et comp閠ences rares et peuvent en fait l'entraver, les multinationales dominant les march閟 locaux. Les donn閑s empiriques apportent toutefois un d閙enti cat間orique. Une autre th鑣e corrobor閑 par les observations r閏entes 関oqu閑s plus haut est que les multinationales peuvent pallier de graves insuffisances en mati鑢e de gestion, en facilitant l'emploi de la main-d'oeuvre locale et en transmettant un savoir-faire aux cadres et chefs d'entreprise locaux. Il est clair que les effets d閜endent dans chaque cas des pratiques des multinationales elles-m阭es, du cadre r間lementaire dans lequel elles 関oluent et du niveau initial de qualification du personnel local. Cela appelle l'attention sur le fait que les effets de l'IED sur le march?du travail sont en grande partie 閠roitement li閟 aux aspects de ces investissements qui touchent au transfert de technologie; c'est en particulier vrai de l'am閘ioration des comp閠ences.
L'afflux d'IED accro顃 間alement la masse des capitaux disponibles dans le pays d'accueil. M阭e si le niveau de qualification et la technologie restent constants, cela peut soit tirer vers le haut les salaires et la productivit?du travail, soit permettre ?davantage de personnes de trouver un emploi ?un niveau de r閙un閞ation inchang? soit provoquer une combinaison des deux ph閚om鑞es (il est 関ident que, si les entr閑s de capitaux sont n間ligeables par rapport ?la taille de la population active, les effets sur la productivit?et les salaires seront 間alement n間ligeables pour le travailleur moyen). Dans un petit nombre de pays en d関eloppement, le ratio IED/formation brute de capital fixe a 閠?閘ev?au cours des derni鑢es ann閑s (par exemple, 37,5% pour Singapour, 24,5% pour la Malaisie et 10,5% pour la Chine). A Maurice, c'est l'IED qui a aliment?la croissance tir閑 par les exportations et l'am閘ioration de l'emploi enregistr閑s ces dix derni鑢es ann閑s.
4) La course ?l'investissement 閠ranger direct
Le d閟ir de profiter des retomb閑s potentielles de l'investissement 閠ranger direct et l'adoption g閚閞alis閑 de strat間ies de d関eloppement fond閑s sur une plus grande int間ration dans l'閏onomie mondiale font que la plupart des pays recherchent activement des IED, en s'appuyant souvent sur des incitations ?l'investissement. Au fur et ?mesure que cette concurrence s'intensifie, il est de plus en plus difficile pour les gouvernements des pays souhaitant attirer des IED d'offrir des conditions moins favorables que les autres pays.
Les incitations ?l'investissement peuvent 阾re class閑s comme suit:
• les incitations financi鑢es, c'est-?dire la fourniture directe de fonds ? l'investisseur 閠ranger par le gouvernement du pays d'accueil, par exemple sous la forme de primes ?l'investissement et de cr閐its bonifi閟;
• les incitations fiscales, destin閑s ?r閐uire la charge fiscale globale pour les investisseurs 閠rangers. Entrent dans cette cat間orie des mesures telles que les exon閞ations temporaires d'imp魌s et les exemptions des droits d'importation sur les mati鑢es premi鑢es, les intrants interm閐iaires et les biens d'閝uipement;
• les incitations indirectes, destin閑s ?accro顃re par plusieurs moyens indirects la rentabilit?d'un IED. Par exemple, le gouvernement peut fournir du terrain et certaines infrastructures ?des prix inf閞ieurs aux prix du march? ou offrir ? l'entreprise 閠rang鑢e une situation privil間i閑 sur le march?sous la forme d'un acc鑣 pr閒閞entiel aux march閟 publics, d'un monopole, d'une fermeture du march?aux nouveaux venus, d'une protection contre la concurrence des importations ou d'un r間ime r間lementaire sp閏ial.
Plusieurs gouvernements ont fait part de leur pr閛ccupation face ?la prolif閞ation des incitations ?l'investissement per鐄es comme faussant la structure de l'investissement ?l'avantage des pays les mieux lotis. En m阭e temps, les accords bilat閞aux et r間ionaux concernant l'investissement examin閟 dans la Partie IV r関鑜ent que les gouvernements sont peu enclins ?soumettre les incitations ?l'investissement ?des disciplines. L'inclusion de certaines dispositions dans l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est ce qui s'approche le plus d'une action collective des Etats en vue de limiter l'utilisation des incitations ?l'investissement (voir Partie V).
Dans un mod鑜e tr鑣 simplifi?de l'閏onomie mondiale o?l'information ne co鹴erait rien, o?il n'y aurait pas de groupes d'int閞阾 particuliers et o?les d閏isions d'orientation seraient guid閑s uniquement par le d閟ir d'utiliser les ressources d'une mani鑢e plus efficace, le recours ?des incitations ?l'investissement pourrait se justifier. En effet, les effets positifs de l'IED sur les pays d'accueil, comme les retomb閑s technologiques et les autres externalit閟 positives d閏rites plus haut, ne sont pas enti鑢ement accapar閟 par les entreprises investisseuses. S'il n'y a pas d'incitations ?l'investissement, il n'y a aucune raison pour qu'une soci閠? multinationale prenne en compte ces retomb閑s lorsqu'elle choisit le lieu d'affectation d'un IED. Dans le mod鑜e d閏rit, les incitations constitueraient un m閏anisme qui permettrait d'affecter l'IED d'une mani鑢e efficiente en “internalisant” au moins une partie des retomb閑s positives dont b閚閒icient les pays d'accueil.
Or, la situation dans le monde r閑l o?il y a une v閞itable concurrence pour l'IED est tr鑣 diff閞ente - tellement diff閞ente, en fait, que le principe de l'utilisation d'incitations ?l'investissement doit 阾re assorti des plus extr阭es r閟erves, pour ne pas dire totalement rejet? Quatre grandes cat間ories d'arguments plaident en ce sens.
Consid閞ations en rapport avec l'affectation. Les incitations ?l'investissement transf鑢ent une partie de la valeur des retomb閑s li閑s ?l'IED des pays d'accueil vers les soci閠閟 multinationales. Plus la concurrence entre pays d'accueil potentiels est vive, plus grande est la proportion des gains potentiels transf閞閑 aux soci閠閟 multinationales. Si le montant des incitations offertes influe peu sur le stock total d'IED disponible pour une r間ion, les pays d'accueil risquent de se retrouver en train d'offrir des incitations qui ne servent qu'?neutraliser celles des autres pays, sans accro顃re le montant des IED obtenus. De telles incitations ne sont ni plus ni moins qu'un transfert de revenu de ces pays vers les entreprises investisseuses.
Consid閞ations en rapport avec la connaissance. Les arguments en faveur des incitations sont en grande partie fond閟 sur l'hypoth鑣e que les gouvernements ont une connaissance approfondie de la valeur/taille des externalit閟 positives associ閑s ?chaque projet d'IED. Dans la pratique, il est presque impossible d'関aluer ces effets avec pr閏ision, m阭e avec l'aide de sp閏ialistes exp閞iment閟. En fait, se laisser entra頽er dans une comp閠ition pour attirer un projet d'IED 閝uivaut ?envoyer des fonctionnaires ?une vente aux ench鑢es pour faire des offres sur un bien dont la valeur r閑lle est en grande partie un myst鑢e pour le pays. Comme le pays d'accueil choisi est g閚閞alement celui qui a (sur)関alu?de la fa鏾n la plus optimiste la valeur que pr閟ente pour lui le projet, la course aux incitations peut donner lieu ?une surench鑢e, une sorte de “mal閐iction du vainqueur”. Si un pays offre 185 millions de dollars d'incitations pour attirer un projet d'IED rapportant au total 135 millions de dollars de retomb閑s, le pays entier aura perdu 50 millions de dollars avec cet investissement.
Consid閞ations d'閏onomie politique. Les lacunes en mati鑢e de connaissance ne sont pas la seule raison qui fait qu'un gouvernement peut offrir des incitations d'un montant sup閞ieur aux retomb閑s de l'IED. En g閚閞al, les retomb閑s d'un projet d'IED profitent ?certains groupes ? l'int閞ieur de l'閏onomie - par exemple ?une r間ion ou aux travailleurs qui ont la chance d'阾re embauch閟 par la nouvelle filiale - alors que le co鹴 des incitations est r閜arti de fa鏾n plus uniforme sur l'ensemble de la soci閠? Cette diff閞ence dans l'incidence des retomb閑s et des co鹴s entre groupes dans le pays d'accueil est une porte ouverte ?l'entr閑 en action de groupes d'int閞阾 particuliers politiquement influants qui vont faire pression sur le gouvernement pour qu'il accorde des incitations ?l'investissement dont ils seront les premiers b閚閒iciaires, mais qui seront en grande partie financ閑s par d'autres groupes. Les lacunes en mati鑢e de connaissance mentionn閑s plus haut accentuent le ph閚om鑞e.
Introduction de nouvelles distorsions. On s'est jusqu'ici fond?sur l'hypoth鑣e que le co鹴 de la fourniture de 1 million de dollars d'incitations pour un pays d'accueil est exactement de 1 million de dollars. Cette hypoth鑣e est trop optimiste. Les incitations financi鑢es doivent 阾re financ閑s, or les taxes g閚鑢ent leurs propres insuffisances. La situation n'est pas meilleure pour les incitations fiscales, et elle peut m阭e 阾re pire pour les incitations non p閏uniaires (indirectes). Par exemple, accorder un monopole ?une soci閠?閠rang鑢e permet au gouvernement du pays d'accueil d'関iter des d閜enses budg閠aires directes en transf閞ant les co鹴s sur les consommateurs qui paieront des prix plus 閘ev閟 qu'il n'est n閏essaire. Les pays en d関eloppement, surtout, peuvent pour des raisons budg閠aires ou de balance des paiements se sentir oblig閟 de recourir ?des incitations fortement perturbatrices comme des droits de monopole et des garanties contre la concurrence des importations pour attirer des projets d'investissement 閠ranger. De leur c魌? les pays d関elopp閟 les mieux lotis peuvent offrir des aides financi鑢es directes causant moins de distorsions. Cette asym閠rie handicape encore plus les pays en d関eloppement dans la course aux IED, et le probl鑝e va plus loin qu'un simple manque de moyens financiers.
En r閟um? si l'on prend en compte les aspects concrets de l'utilisation d'incitations ? l'investissement dans la course aux IED, il est tr鑣 difficile de ne pas conclure que l'閏onomie mondiale - et la grande majorit?des pays pris isol閙ent - tirerait avantage d'un accord multilat閞al pr関oyant des limitations ?l'utilisation des incitations ? l'investissement. Ces incitations ne diff鑢ent en rien des autres types de subventions et, comme avec la plupart des autres types de subventions, les pays d関elopp閟 (et aussi, dans le cas pr閟ent, les principaux pays en d関eloppement) peuvent d閜enser plus que la grande majorit?des autres pays. Soumises ?des conditions tr鑣 strictes, les incitations ?l'investissement peuvent corriger des imperfections du march? Mais, dans les faits, les connaissances n閏essaires font d閒aut, les programmes peuvent tr鑣 facilement 阾re accapar閟 au niveau politique par des groupes d'int閞阾 particuliers et il y a un risque consid閞able non seulement que de nouvelles distorsions soient introduites, mais aussi que les revenus soient redistribu閟 d'une mani鑢e r間ressive. Ce dernier effet est particuli鑢ement pr閛ccupant dans la mesure o?les pays en d関eloppement en tant que groupe sont des destinataires nets d'IED.
IV. Arrangements juridiques et institutionnels r間issant l'investissement 閠ranger
Les arrangements intergouvernementaux existants dans le domaine de l'investissement 閠ranger comprennent un large 関entail d'instruments bilat閞aux, r間ionaux, plurilat閞aux et multilat閞aux qui diff鑢ent entre eux quant ?leur nature juridique, leur champ d'application et leur objet. Les accords contraignants sont principalement ceux qui ont 閠?conclus aux niveaux bilat閞al, r間ional et plurilat閞al, tandis que les instruments multilat閞aux sont pour la plupart non contraignants. Certains arrangements visent exclusivement l'investissement 閠ranger. D'autres r間issent l'investissement 閠ranger dans le cadre plus g閚閞al des questions relatives ?la coop閞ation et ?l'int間ration 閏onomiques. Les arrangements existants portent sur des aspects tr鑣 divers: admission et traitement de l'investissement 閠ranger, promotion de l'investissement 閠ranger, garantie des investissements, r鑗les de conduite des soci閠閟, fiscalit? concurrence et probl鑝es juridiques, et proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends.
L'関olution r閏ente des activit閟 normatives internationales dans ce domaine est marqu閑 par l'importance croissante des arrangements bilat閞aux, r間ionaux et plurilat閞aux qui visent ?encourager l'investissement 閠ranger en instituant des r鑗les de fond concernant l'admission et le traitement de l'investissement 閠ranger dans les pays d'accueil. Dans le pass? par contre, l'accent 閠ait surtout mis sur le droit du pays d'accueil de contr鬺er l'investissement 閠ranger et sur les r鑗les de conduite des soci閠閟. Un grand nombre d'arrangements r閏ents sont juridiquement contraignants mais, comme dans le cas des principes non contraignants de l'APEC en mati鑢e d'investissement, d'autres approches ont aussi 閠?adopt閑s.
Quant aux r鑗les et concepts qui figurent dans les instruments les plus r閏ents, on d閚ote une tendance g閚閞ale ?accepter l'id閑 que la protection de l'investissement 閠ranger devrait englober certaines r鑗les g閚閞ales en mati鑢e de traitement, associ閑s ?des r鑗les r間issant des questions sp閏ifiques telles que l'expropriation, l'indemnisation et le transfert des fonds, ainsi qu'un m閏anisme international de r鑗lement des diff閞ends. Par contre, des diff閞ences profondes demeurent en ce qui concerne l'admission de l'investissement 閠ranger et seuls quelques accords contiennent des engagements juridiquement contraignants ?ce sujet.
L'関olution de la situation au niveau intergouvernemental est influenc閑 par celle de la situation ? l'閏helon national. Il est donc utile de commencer par examiner tr鑣 bri鑦ement les derniers faits intervenus dans les r間lementations nationales relatives ? l'investissement 閠ranger.
1) R鑗lementations nationales
Depuis le d閎ut des ann閑s 80, il y a eu une tendance g閚閞ale vers la lib閞alisation des lois et r間lementations nationales relatives ?l'investissement 閠ranger, surtout dans les pays en d関eloppement et les pays en transition. Dans nombre de cas, ce mouvement s'inscrivait dans le cadre d'une vaste r閒orme, orient閑 vers le march? de la politique 閏onomique et s'est d閞oul?parall鑜ement ?la lib閞alisation du commerce, ?la d閞間lementation et ?la privatisation.
La tendance r閏ente vers des politiques d'investissement plus lib閞ales s'est surtout manifest閑 par la suppression ou l'all間ement des obstacles r間lementaires ? l'admission de l'IED. Les proc閐ures de s閘ection par le biais d'autorisations pr閍lables ont 閠?supprim閑s ou leur champ d'application r閐uit. Dans le m阭e ordre d'id閑, les restrictions sectorielles ?l'admission de l'investissement 閠ranger et la limitation des participations 閠rang鑢es dans le capital des soci閠閟 locales ont 閠?lev閑s ou att閚u閑s. On a aussi renonc??imposer des prescriptions en mati鑢e de r閟ultats et les r鑗lements concernant les transferts de fonds ont 閠?assouplis. En outre, les dispositions pr関oyant un traitement non discriminatoire des investisseurs 閠rangers et les r鑗les internationales sur des questions telles que l'indemnisation en cas d'expropriation sont de plus en plus largement accept閑s. Enfin, les m閏anismes d'arbitrage international pour le r鑗lement des diff閞ends entre investisseurs 閠rangers et pays d'accueil sont aujourd'hui largement accept閟.
Ce bilan de la lib閞alisation doit cependant 阾re nuanc? D'abord, la tendance n'a pas 閠?uniforme et des diff閞ences profondes persistent entre les r間imes applicables ? l'investissement 閠ranger. Ensuite, presque tous les pays maintiennent des restrictions, souvent de caract鑢e sectoriel, ?l'admission de l'investissement 閠ranger. A cet 間ard, une question qui a retenu l'attention est l'existence d'obligations de r閏iprocit?concernant l'admission et le traitement de l'investissement 閠ranger.
La lib閞alisation des lois et r間lementations nationales s'est accompagn閑 d'une prolif閞ation rapide d'arrangements intergouvernementaux concernant des questions li閑s ?l'investissement 閠ranger aux niveaux bilat閞al, r間ional et plurilat閞al. La lib閞alisation unilat閞ale des cadres juridiques nationaux n'a pas 閠?jug閑 suffisante et de plus en plus de pays reconnaissent la n閏essit?cruciale de prendre des engagements internationaux en vue d'assurer un cadre juridique stable et pr関isible pour l'IED.
2) Accords bilat閞aux
Les efforts d閜loy閟 apr鑣 la guerre pour 閠ablir un accord multilat閞al contraignant et contenant des r鑗les d閠aill閑s relatives ?l'investissement 閠ranger n'ayant pas abouti (voir ci-apr鑣), les accords bilat閞aux de promotion et de protection de l'investissement 閠ranger sont devenus la premi鑢e source de droit en ce qui concerne le traitement de l'investissement 閠ranger. Le fait que ces accords ont uniquement pour objet de r間lementer l'investissement 閠ranger est la principale caract閞istique qui les distingue des nombreux trait閟 d'amiti? de commerce et de navigation conclus pendant les ann閑s suivant imm閐iatement la guerre.
La multiplication des accords bilat閞aux d'investissement a 閠?particuli鑢ement forte depuis la fin des ann閑s 80. D'apr鑣 la CNUCED, environ les deux tiers des quelque 1 160 accords bilat閞aux existants en juin 1996 ont 閠?conclus dans les ann閑s 90. Cette 関olution refl鑤e trois grandes tendances. Premi鑢ement, jusqu'?la fin des ann閑s 70, les accords bilat閞aux d'investissement conclus par les pays membres de l'OCDE concernaient uniquement un nombre assez restreint de pays, principalement europ閑ns. Par la suite, dans les ann閑s 80, la n間ociation de tels accords est devenue une pratique g閚閞alis閑 parmi les pays de l'OCDE et, en 1994, 18 d'entre eux en ont conclu au moins dix. Deuxi鑝ement, l'orientation g閛graphique des accords conclus par les pays de l'OCDE, initialement caract閞is閑 par la pr閜ond閞ance des pays en d関eloppement d'Asie et d'Afrique, a nettement chang?apr鑣 la deuxi鑝e moiti?des ann閑s 70 ?la suite des accords pass閟 avec les pays d'Europe centrale et orientale, la Chine, l'Am閞ique latine, ainsi que l'Union sovi閠ique et les r閜ubliques qui lui ont succ閐? Troisi鑝ement, depuis les ann閑s 80, un grand nombre d'accords bilat閞aux d'investissement ont 閠?conclus entre les pays non membres de l'OCDE.
L'importance des accords bilat閞aux d'investissement tient non seulement ?la forte augmentation de leur utilisation mais aussi au fait que les concepts et r鑗les qui en d閏oulent sont repris dans de nombreux arrangements r間ionaux et plurilat閞aux en mati鑢e d'investissement mis en place r閏emment. Ces accords sont pour la plupart assez concis et en gros comparables quant ?leur structure. Presque tous contiennent des dispositions concernant le champ d'application, l'admission des investissements, les r鑗les g閚閞ales et sp閏ifiques en mati鑢e de traitement et le r鑗lement des diff閞ends. Malgr?cette structure similaire et une grande analogie sur certains points, il y a aussi des aspects sur lesquels les dispositions de fond diff鑢ent beaucoup entre elles. Les accords bilat閞aux sont g閚閞alement fond閟 sur le principe de la r閏iprocit?et 閚oncent des r鑗les applicables aux investissements effectu閟 par les investisseurs d'une partie sur le territoire de l'autre partie. Con鐄s en vue de promouvoir et de prot間er l'investissement 閠ranger, ils contiennent cependant rarement des dispositions faisant obligation aux pays d'origine de prendre activement des mesures pour encourager leurs ressortissants ?investir sur le territoire de l'autre partie. Pour promouvoir l'investissement 閠ranger, on cherche plut魌 ?r閐uire de diff閞entes mani鑢es les incertitudes qui lui sont propres.
Les accords bilat閞aux d'investissement contiennent tr鑣 souvent une d閒inition large et souple de l'“investissement”, envisag?comme une forme de propri閠?et g閚閞alement d閒ini par le biais d'une liste indicative et non exhaustive d'actifs: biens mobiliers et immobiliers, droits de propri閠?dans des soci閠閟, cr閍nces mon閠aires et droits de propri閠?intellectuelle, par exemple. Dans certains cas, il est clairement sp閏ifi?que seuls sont vis閟 les investissements effectu閟 conform閙ent au droit interne du pays d'accueil ou qui sont approuv閟 ou d鹠ent enregistr閟 par le pays d'accueil. Un autre aspect important est la d閒inition des personnes et des soci閠閟 r閜ut閑s 阾re investisseurs de l'une des parties. A cet 間ard, il y a entre les accords bilat閞aux des diff閞ences assez marqu閑s, surtout en ce qui concerne la d閒inition de la nationalit?des soci閠閟.
Il existe deux principales approches pour ce qui est de l'admission de l'investissement 閠ranger. La plupart des accords bilat閞aux pr関oient que, sans pr閖udice de la l間islation nationale, les parties doivent encourager et admettre sur leur territoire les investissements effectu閟 par des ressortissants et soci閠閟 de l'autre partie. La r閒閞ence ?la l間islation nationale signifie que l'engagement d'encourager l'investissement 閠ranger est subordonn?aux restrictions ?l'admission de tels investissements qui sont d閖?pr関ues par le droit interne ou qui peuvent l'阾re ? l'avenir. La priorit?donn閑 dans ces accords au droit interne tient au fait que, ? l'origine, ils avaient essentiellement pour objectif de r間lementer le traitement de l'investissement 閠ranger apr鑣 l'admission. A cet 間ard, la plupart des accords bilat閞aux d'investissement conclus par les Etats-Unis sont fond閟 sur une approche fondamentalement diff閞ente. Ils pr関oient l'application du r間ime NPF et du traitement national au moment de l'admission des investissements mais aussi ult閞ieurement, sous r閟erve, toutefois, du droit de chaque partie d'閚oncer ou de maintenir des exceptions pour des secteurs ou questions sp閏ifi閟 dans une annexe aux accords.
Les r鑗les g閚閞ales en mati鑢e de traitement qui figurent habituellement dans les accords bilat閞aux disposent que les investissements vis閟 doivent b閚閒icier d'un traitement juste et 閝uitable ainsi que d'une protection et d'une s閏urit?totales, et que les parties doivent s'abstenir d'entraver, par des mesures d閞aisonnables ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l'utilisation, l'exploitation ou l'ali閚ation des actifs investis vis閟. En outre, de nombreux accords pr関oient l'obligation pour chaque partie d'ex閏uter toutes les obligations qu'elle peut avoir contract閑s au sujet des investissements effectu閟 par les investisseurs de l'autre partie. La plupart des accords contiennent aussi des clauses concernant le traitement NPF et le traitement national, m阭e si beaucoup d'entre elles mentionnent uniquement le traitement NPF. L'閚onc?exact des clauses relatives au traitement NPF et au traitement national peut 阾re tr鑣 diff閞ent d'un accord ?l'autre. Outre les exceptions pour des secteurs ou mesures sp閏ifi閟, les accords bilat閞aux pr関oient g閚閞alement des exceptions au traitement NPF ou au traitement national pour ce qui est des avantages accord閟 aux investisseurs d'un Etat tiers au titre de la participation ?un accord d'int間ration r間ionale ou en vertu d'accords bilat閞aux visant ?関iter la double imposition. Presque tous les accords bilat閞aux contiennent des prescriptions concernant les transferts de fonds au titre d'investissements, l'expropriation et l'indemnisation, et la protection contre les pertes dues ?la guerre et ?d'autres circonstances exceptionnelles. La plupart mentionnent aussi des questions li閑s au fonctionnement des r間imes de garantie nationaux. D'autres dispositions moins courantes, qui figurent surtout dans les accords conclus par les Etats-Unis, portent sur les prescriptions de r閟ultat, l'admission temporaire de certaines cat間ories de personnel en relation avec l'閠ablissement ou la gestion d'un investissement, et le droit des investisseurs 閠rangers de recruter des cadres sup閞ieurs ind閜endamment de la nationalit?
Les m閏anismes de r鑗lement des diff閞ends institu閟 dans les accords bilat閞aux pr関oient l'arbitrage contraignant des diff閞ends se rapportant ?l'application et ? l'interpr閠ation de l'accord que les parties n'ont pas pu r閟oudre par voie diplomatique. L'arbitrage des diff閞ends au niveau intergouvernemental est r間i par des r鑗les sp閏ifiques 閚onc閑s dans chaque accord bilat閞al concernant, par exemple, le mode de d閟ignation des arbitres, le r鑗lement int閞ieur, le d閘ai d'ach鑦ement de la proc閐ure d'arbitrage, l'imputation des co鹴s et le droit applicable. En outre, il y a aussi souvent des dispositions sur l'arbitrage international contraignant des diff閞ends entre l'une des parties et un ressortissant de l'autre partie. Ces dispositions renvoient g閚閞alement ?des r鑗les d'arbitrage existantes, notamment celles de la Convention du Centre international pour le r鑗lement des diff閞ends relatifs aux investissements (CIRDI). La tendance r閏ente ?une acceptation g閚閞alis閑 de ce type de clause marque un net changement d'attitude, mais certaines questions comme le caract鑢e inconditionnel du droit d'un investisseur 閠ranger de recourir ?l'arbitrage international et l'application du principe de l'閜uisement des voies de recours locales, sont abord閑s de mani鑢e tr鑣 diff閞ente d'une clause ?l'autre. L'exp閞ience est assez limit閑 en ce qui concerne les m閏anismes de r鑗lement des diff閞ends institu閟 par les accords bilat閞aux et il n'y a eu aucun cas d'arbitrage intergouvernemental dans le cadre d'un accord bilat閞al. La premi鑢e affaire port閑 devant un tribunal arbitral du CIRDI en vertu de la clause d'arbitrage entre un investisseur et un Etat figurant dans un accord bilat閞al ne remonte qu'?1987.
D'autres accords bilat閞aux peuvent avoir une incidence indirecte sur l'IED. Les accords bilat閞aux d'encouragement des investissements conclus entre les Etats-Unis et plusieurs pays en d関eloppement, qui pr関oient la garantie des investissements par la soci閠? am閞icaine Overseas Private Investment Corporation (OPIC), en sont un exemple. Ils disposent que les pays d'accueil reconnaissent les droits de subrogation de l'OPIC en cas de paiement d'une cr閍nce, et 閠ablissent un m閏anisme pour le r鑗lement des diff閞ends par voie d'arbitrage international contraignant. Les nombreux accords bilat閞aux relatifs ?la double imposition sont un autre exemple.
3) Instruments r間ionaux et plurilat閞aux
Aux niveaux r間ional et plurilat閞al, on peut distinguer, d'une part, les arrangements visant uniquement l'investissement 閠ranger et, d'autre part, ceux qui r間issent l'investissement 閠ranger dans le cadre plus large de r鑗les relatives ?la coop閞ation et ? l'int間ration 閏onomiques (tableaux 2 et 3). Parmi les seconds figurent, par exemple, le Trait?instituant la Communaut?閏onomique europ閑nne, l'Accord de libre-閏hange nord-am閞icain et le Trait?sur la Charte europ閑nne de l'閚ergie. Dans la premi鑢e cat間orie, on peut citer les codes de l'OCDE de la lib閞ation des mouvements de capitaux et de la lib閞ation des op閞ations invisibles courantes, le Protocole de Colonia sur la promotion et la protection r閏iproque des investissements ?l'int閞ieur du MERCOSUR et les principes non contraignants de l'APEC relatifs ?l'investissement. Ces arrangements se diff閞encient davantage entre eux que les accords bilat閞aux d'investissement, pour ce qui est de leurs objectifs et de leur champ d'application. Par exemple, certains visent essentiellement ?supprimer les obstacles ?l'investissement entre les parties, tandis que d'autres mettent surtout l'accent sur les objectifs de promotion et de protection propres aux accords bilat閞aux. Par ailleurs, alors que la plupart des arrangements r間ionaux et plurilat閞aux sont ax閟 sur les questions relatives ?l'admission et au traitement de l'investissement, la D閏laration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales mentionne certains aspects qui ne sont g閚閞alement pas abord閟 dans les accords d'investissement, tels que les r鑗les de conduite des soci閠閟 et les proc閐ures pour le r鑗lement des conflits de comp閠ence juridique.
Tableau 2
Instruments r間ionaux
Instrument |
Date |
Instrument |
Date |
I. Instruments distincts |
|||
Convention commune sur les investissements dans les Etats membres de l'Union douani鑢e et 閏onomique de l'Afrique centrale |
1965 |
Accord sur l'閠ablissement d'un r間ime applicable aux entreprises des pays membres du CARICOM |
1987 |
Accord sur l'investissement et la libre circulation des capitaux arabes entre pays arabes |
1970 |
Accord de base r関is?sur les coentreprises industrielles des pays membres de l'ANASE |
1987 |
Convention portant cr閍tion de la Soci閠?interarabe de garantie des investissements |
1971 |
Accord de promotion et de protection des investissements conclu entre les gouvernements du Brun閕 Darussalam, de la R閜ublique d'Indon閟ie, de la Malaisie, de la R閜ublique des Philippines, de la R閜ublique de Singapour et du Royaume de Tha飈ande |
1987 |
Convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'閠ablissement dans l'Union douani鑢e et 閏onomique de l'Afrique centrale |
1972 |
Charte relative ?un r間ime applicable aux entreprises industrielles multinationales dans la zone d'閏hanges pr閒閞entiels des Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe |
1990 |
Accord sur l'harmonisation des mesures d'incitation fiscales en faveur des entreprises |
1973 |
D閏ision n?24 de la Commission de l'Accord de Carthag鑞e: r鑗les communes r間issant les mouvements de capitaux 閠rangers, les marques de commerce, les brevets, les licences et les redevances et D閏ision n?291 de la Commission de l'Accord de Carthag鑞e: code commun relatif au traitement des capitaux 閠rangers et aux marques de commerce, brevets et redevances |
1970
1991 |
Code des soci閠閟 multinationales dans l'Union douani鑢e et 閏onomique de l'Afrique centrale |
1975 |
D閏ision n?292 de la Commission de l'Accord de Carthag鑞e: code uniforme des entreprises multinationales andines |
1991 |
Accord unifi?sur l'investissement de capitaux arabes dans les pays arabes |
1980 |
Protocole de Colonia sur la promotion et la protection r閏iproque des investissements ?l'int閞ieur du MERCOSUR |
1994 |
Code des investissements communautaires de la Communaut?閏onomique des pays des Grands Lacs (CEPGL) |
1987 |
Protocole sur la promotion et la protection des investissements originaires d'Etats non membres du MERCOSUR |
1994 |
II. Instruments s'inscrivant dans un cadre plus g閚閞al |
|||
Trait?instituant la Communaut?閏onomique europ閑nne |
1957 |
Trait?instituant l'Association latino-am閞icaine d'int間ration |
1980 |
Accord d'Union 閏onomique des Etats de la Ligue arabe |
1957 |
Trait?instituant la Communaut?閏onomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest |
1983 |
Accord sur l'int間ration sous-r間ionale andine |
1969 |
Accord de libre-閏hange nord-am閞icain |
1992 |
Trait?instituant la Communaut?des Cara颾es |
1973 |
Trait?portant cr閍tion du March?commun des Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe |
1993 |
Tableau 3
Instruments plurilat閞aux
Instrument |
Date |
Instrument |
Date |
Code de la lib閞ation des mouvements de capitaux (OCDE) |
1961 |
Quatri鑝e Convention de Lom? ACP-CEE |
1989 |
Code de la lib閞ation des op閞ations invisibles courantes (OCDE) |
1961 |
Principes non contraignants de l'APEC relatifs ?l'investissement |
1994 |
D閏laration sur l'investissement international et les entreprises multinationales (OCDE) |
1976 |
Acte final de la Conf閞ence sur la Charte europ閑nne de l'閚ergie, Trait?sur la Charte de l'閚ergie, D閏isions relatives ?la Charte et annexes du Trait?/td> | 1994 |
Accord entre les Etats membres de l'Organisation de la Conf閞ence islamique sur la promotion, la protection et la garantie des investissements |
1981 |
Des accords qui r間issent l'investissement 閠ranger dans le cadre g閚閞al de la coop閞ation r間ionale, le Trait?instituant la CEE (Trait?de Rome) est celui qui a la plus grande port閑. Il envisage la suppression des restrictions au droit d'閠ablissement et au mouvement des capitaux comme l'un des moyens d'閠ablir un march?commun, ce qui le distingue de tous les autres arrangements dans le domaine de l'investissement 閠ranger. Les articles 52 ?58 du Trait?de Rome pr関oient la suppression progressive des restrictions ?la libert?d'閠ablissement des personnes physiques et morales ayant la nationalit?d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, et les articles 67 ?73 portent sur la suppression progressive des restrictions ?la libre circulation des capitaux. Ces questions sont aussi trait閑s dans les accords entre la CE et les pays tiers, y compris les accords d'association conclus r閏emment avec les pays d'Europe centrale et orientale. Le Trait?instituant la Communaut?des Cara颾es (1973) et le Trait?instituant la Communaut?閏onomique des Etats d'Afrique centrale (1983) sont d'autres exemples dans lesquels la lib閞alisation des investissements est un aspect de l'int間ration 閏onomique r間ionale.
Par contre, les dispositions relatives ?l'investissement qui figurent dans le chapitre 11 de l'Accord de libre-閏hange nord-am閞icain sont plus proches des accords bilat閞aux d'investissement. Comme ces derniers, elles contiennent une d閒inition au sens large du terme “investissement”, des r鑗les g閚閞ales en mati鑢e de traitement (traitement national, traitement NPF et traitement conforme au droit international), des r鑗les sp閏ifiques pour l'indemnisation en cas d'expropriation et en cas de pertes subies en raison d'un conflit arm?ou d'une guerre civile, des r鑗les concernant les transferts, ainsi qu'un m閏anisme d'arbitrage des diff閞ends entre un investisseur et une partie ?l'ALENA. Sur des points importants, cependant, les disciplines de l'ALENA en mati鑢e d'investissement vont beaucoup plus loin que celles qui figurent dans un accord bilat閞al d'investissement type. Par exemple, l'obligation d'accorder le traitement national et le traitement NPF s'applique ?la fois ?l'admission des investissements et au traitement ult閞ieur des investissements et investisseurs, et l'interdiction des prescriptions de r閟ultat a une port閑 sans pr閏閐ent par rapport aux autres accords internationaux d'investissement ou de commerce. Les r鑗les de l'ALENA en mati鑢e d'investissement pr閟entent en outre la particularit?de r間ir aussi les mesures environnementales et d'inclure une clause de jonction pour la proc閐ure d'arbitrage entre Etat et investisseur dans le cas de plaintes multiples portant sur les m阭es points de droit ou de fait.
Le Trait?sur la Charte europ閑nne de l'閚ergie 閠ablit un cadre juridique pour promouvoir la coop閞ation ?long terme dans le secteur de l'閚ergie et porte sur diff閞entes questions: commerce, concurrence, technologie, acc鑣 aux capitaux, promotion et protection des investissements, et questions environnementales. Malgr?un champ d'application sectoriel limit? le nombre 閘ev?des pays concern閟 lui donne un caract鑢e unique par rapport aux autres arrangements internationaux contraignants qui contiennent des r鑗les de fond relatives au traitement des investissements. Comme les dispositions de l'ALENA en mati鑢e d'investissement, le Trait?est comparable aux accords bilat閞aux d'investissement quant aux r鑗les de fond r間issant le traitement de l'investissement 閠ranger (articles 10 ?17) et la proc閐ure pr関ue ?l'article 26 pour l'arbitrage international des diff閞ends entre un investisseur et une partie contractante. Il se distingue cependant de l'ALENA sur un point important: en ce qui concerne le traitement des investissements apr鑣 l'admission, il fait obligation aux parties contractantes d'accorder aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement national ou le traitement NPF, le r間ime le plus favorable 閠ant retenu, mais pour l'admission de l'investissement, il dispose simplement que chaque partie contractante “s'efforce” d'accorder ce traitement (il pr関oit la conclusion d'un trait? compl閙entaire au 1er janvier 1998 qui 閠endra ?l'admission de l'investissement 閠ranger l'obligation d'accorder le traitement national ou le traitement NPF). Le Trait? va aussi beaucoup moins loin que l'ALENA pour ce qui est des prescriptions en mati鑢e de r閟ultats, au sujet desquelles il incorpore les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce.
Outre la promotion et la protection de l'investissement 閠ranger ainsi que les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce, le Trait?aborde aussi la question de l'acc鑣 aux capitaux. A ce sujet, l'article 9 dispose que chaque partie contractante s'efforce de favoriser l'acc鑣 ?son march?des capitaux aux fins du financement des 閏hanges de mati鑢es et produits 閚erg閠iques et des investissements dans le secteur de l'閚ergie, sur la base d'un traitement non moins favorable que celui qui est accord? dans des circonstances similaires ?ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le r間ime ?retenir 閠ant celui qui est le plus favorable.
Plusieurs instruments r間ionaux et plurilat閞aux traitent des questions relatives ? l'investissement 閠ranger en instituant un cadre pour la conclusion d'accords bilat閞aux d'investissement entre les parties. Un exemple important ?cet 間ard est la quatri鑝e Convention ACP-CEE de Lom? Le chapitre 3 du Titre III (coop閞ation pour le financement du d関eloppement) de la Convention contient des dispositions r間issant la promotion, la protection et le financement des investissements, l'appui aux investissements, les paiements courants et les mouvements de capitaux, ainsi que le r間ime applicable aux entreprises. Il 閚once les principes g閚閞aux applicables au traitement de l'investissement 閠ranger, tels que l'obligation d'accorder un traitement juste et 閝uitable, et pr関oit que les aspects plus sp閏ifiques des politiques relatives ? l'investissement 閠ranger seront trait閟 par le biais de la n間ociation d'accords bilat閞aux entre les parties contractantes. L'article 260 affirme la n閏essit?de conclure des accords bilat閞aux de promotion et de protection des investissements et l'article 261 pr関oit, notamment, que la n間ociation et la mise en oeuvre de ces accords se feront sur une base non discriminatoire. En vue de faciliter la n間ociation de ces accords, une D閏laration commune figurant ?l'annexe LIII de la Convention pr閏ise que les parties contractantes effectueront une 閠ude des principales clauses d'un accord bilat閞al d'investissement type.
Parmi les arrangements r間ionaux et plurilat閞aux portant exclusivement sur l'investissement 閠ranger, il faut signaler les codes juridiquement contraignants de l'OCDE, en l'occurrence le Code de la lib閞ation des mouvements de capitaux et le Code de la lib閞ation des op閞ations invisibles courantes. Adopt閟 en 1961, ils visent ? supprimer progressivement sur une base non discriminatoire les restrictions aux paiements courants et transferts de capitaux en provenance ou ?destination d'autres pays, nonobstant les r閟erves que peuvent formuler des signataires, les exceptions g閚閞ales et les d閞ogations temporaires. Le Code de la lib閞ation des mouvements de capitaux a 閠?modifi?en 1984 pour inclure le droit d'閠ablissement. La mise en oeuvre de ces codes est actuellement examin閑 par le Comit?des mouvements de capitaux et des transactions invisibles de l'OCDE. La question du traitement de l'investissement apr鑣 l'admission fait l'objet d'un instrument distinct de l'OCDE, la D閏ision relative au traitement national, qui est une section de la D閏laration sur l'investissement international et les entreprises multinationales. La D閏laration et ses annexes, adopt閑s initialement en 1976 et r関is閑s pour la derni鑢e fois en 1991, 閚oncent aussi des principes directeurs ?l'intention des entreprises multinationales, des proc閐ures de coop閞ation en vue d'関iter ou de limiter au maximum les obligations contradictoires impos閑s aux entreprises multinationales, et des proc閐ures de coop閞ation concernant les stimulants et obstacles aux investissements. La D閏laration elle-m阭e n'est pas juridiquement contraignante mais sa mise en oeuvre est examin閑 au Comit?de l'investissement international et des entreprises multinationales conform閙ent ?des d閏isions proc閐urales ayant force ex閏utoire.
En mai 1995, apr鑣 plusieurs ann閑s de travaux pr閜aratoires, les membres de l'OCDE ont engag?des n間ociations en vue de conclure un accord multilat閞al sur l'investissement. Les principaux 閘閙ents de l'accord envisag?sont les suivants: une approche descendante - 閘閙ent central - pour la lib閞alisation des r間imes d'investissement moyennant l'application de r鑗les concernant le traitement national et le traitement NPF aussi bien ?l'閠ablissement qu'au traitement ult閞ieur de l'investissement; une d閒inition de l'investissement compris au sens large et sous forme d'actifs; des dispositions relatives aux r閟erves sp閏ifiques par pays; des obligations en mati鑢e de statu quo et de d閙ant鑜ement; des dispositions sur la transparence des lois, r間lementations et politiques nationales; un nombre limit?d'exceptions g閚閞ales; des r鑗les pour la protection des investissements (r鑗les g閚閞ales en mati鑢e de traitement et r鑗les sp閏ifiques concernant l'expropriation et l'indemnisation, le transfert des fonds, la protection contre les guerres civiles, etc.); et des proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends par voie d'arbitrage entre Etats et entre investisseurs et Etats. En outre, il est envisag?d'y inclure 関entuellement des disciplines concernant les mesures d'incitation ?l'investissement, les prescriptions en mati鑢e de r閟ultats, le mouvement et l'emploi de personnel-cl? les pratiques des soci閠閟, la privatisation, les monopoles et les entreprises d'Etat.
Il reste ?d閏ider si cet Accord multilat閞al doit 閚oncer des engagements en vue d'une lib閞alisation substantielle d鑣 l'entr閑 en vigueur ou plut魌 doit pr関oir un statu quo assorti d'un m閏anisme de lib閞alisation progressive. Il s'agit en principe d'un accord international autonome, ouvert ?la signature des membres de l'OCDE et de la Communaut?europ閑nne et ?l'accession des pays non membres de l'OCDE. L'objectif est d'achever les n間ociations avant la r閡nion minist閞ielle de l'OCDE en 1997 (qui se tiendra comme d'habitude en mai).
L'accord de promotion et de protection des investissements conclu entre les membres de l'ANASE en 1987 et le Protocole de Colonia sur la promotion et la protection r閏iproque des investissements ?l'int閞ieur du MERCOSUR (1994), sont des exemples d'arrangements r間ionaux portant exclusivement sur l'investissement 閠ranger et fond閟 sur une approche analogue ?celle de la plupart des accords bilat閞aux d'investissement. L'accord de l'ANASE adopte, en ce qui concerne l'admission de l'investissement 閠ranger, la m阭e approche que celle qui figure dans la grande majorit?des accords bilat閞aux, c'est-?dire qu'il dispose que les parties encourageront l'investissement 閠ranger en provenance des autres parties, sous r閟erve toutefois de leurs lois et objectifs nationaux. De plus, l'octroi du traitement national apr鑣 l'admission n'est pas une obligation g閚閞ale mais une question ?n間ocier entre les parties ?l'accord. Par contre, le Protocole de Colonia fait obligation aux parties d'accorder le traitement national ou le traitement NPF, le r間ime le plus favorable 閠ant retenu, aussi bien lors de l'admission de l'investissement 閠ranger en provenance des autres parties qu'ult閞ieurement. Cette obligation est limit閑 par le droit de chaque partie de maintenir des exceptions pendant une p閞iode de transition dans les secteurs 閚um閞閟 en annexe au Protocole.
Les principes non contraignants de l'APEC relatifs ?l'investissement, adopt閟 en novembre 1994, portent sur les aspects ci-apr鑣: transparence, non-discrimination entre les pays d'origine, traitement national, encouragement des investissements, prescriptions en mati鑢e de r閟ultats, expropriation et indemnisation, rapatriement et convertibilit? r鑗lement des diff閞ends, admission et s閖our de personnel, mesures pour 関iter la double imposition, comportement des investisseurs et suppression des obstacles ?l'exportation de capitaux. Outre qu'ils ne sont juridiquement pas contraignants, ces principes sont pour la plupart formul閟 en des termes beaucoup moins pr閏is et rigoureux que les dispositions d'arrangements comparables mis en place r閏emment.
4) Instruments multilat閞aux
Plusieurs tentatives ont 閠? faites pendant les d閏ennies suivant la deuxi鑝e guerre mondiale pour adopter un instrument multilat閞al ayant force ex閏utoire et contenant des r鑗les de fond d閠aill閑s sur l'investissement 閠ranger, mais aucune n'a abouti. Les instruments multilat閞aux existants qui sont juridiquement contraignants ont g閚閞alement une port閑 limit閑 et ne contiennent pas de r鑗les de fond, tandis que les instruments multilat閞aux 閚on鏰nt des r鑗les de fond ne sont pas contraignants.
A l'int閞ieur du Groupe de la Banque mondiale, deux instruments multilat閞aux juridiquement contraignants ont 閠?adopt閟 qui r間issent express閙ent l'investissement 閠ranger (tableau 4). Le premier est la Convention pour le r鑗lement des diff閞ends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, conclue en 1965 et entr閑 en vigueur en octobre 1966. La Convention institue un m閏anisme de r鑗lement des diff閞ends entre investisseurs et Etats par voie de conciliation et d'arbitrage au Centre international pour le r鑗lement des diff閞ends relatifs aux investissements (CIRDI). Le nombre des parties contractantes ?la Convention a fortement augment?ces derni鑢es ann閑s et de nombreux accords bilat閞aux et r間ionaux d'investissement mentionnent la Convention CIRDI comme 閠ant le cadre du r鑗lement des diff閞ends entre investisseurs et Etats.
Tableau 4
Instruments multilat閞aux
Instrument |
Date |
Instrument |
Date |
I. Instruments contraignants |
|||
Convention pour le r鑗lement des diff閞ends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (Banque mondiale) |
1965 |
Principes directeurs pour le traitement de l'investissement direct 閠ranger (Groupe de la Banque mondiale) |
1992 |
Convention portant cr閍tion de l'Agence multilat閞ale de garantie des investissements (Banque mondiale) |
1985 |
||
II. Instruments non contraignants |
|||
R閟olution 1803 (XVII) de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies: Souverainet?permanente sur les ressources naturelles |
1962 |
Projet d'accord international sur les paiements illicites (non adopt?par l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies) |
1979 |
R閟olution 3201 (S-VI) de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies: D閏laration concernant l'instauration d'un nouvel ordre 閏onomique international et R閟olution 3202 (S-VI) de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies: Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre 閏onomique international |
1974 |
Ensemble de principes et de r鑗les 閝uitables convenus au niveau multilat閞al pour le contr鬺e des pratiques commerciales restrictives (adopt?en tant que R閟olution 35/63 de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies) et R閟olution adopt閑 par la Conf閞ence charg閑 de revoir tous les aspects de l'Ensemble de principes et de r鑗les |
1980
1990 |
R閟olution 3281 (XXIX) de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies: Charte des droits et devoirs 閏onomiques des Etats |
1974 |
Projet de code de conduite des Nations Unies des soci閠閟 transnationales (non adopt?par l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies) |
1983 |
D閏laration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale et Proc閐ure pour l'examen des diff閞ends relatifs ?l'application de la D閏laration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale par interpr閠ation de ses dispositions |
1977
1986 |
R閟olution 89/248 de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies: Principes directeurs pour la protection du consommateur Projet de code international de conduite pour le transfert de technologie (non adopt?par l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies) |
1985
1985 |
Note: Voir le chapitre 5 pour les instruments multilat閞aux 閠ablis dans le cadre de l'OMC.
Le deuxi鑝e accord adopt?sous les auspices du Groupe de la Banque mondiale est la Convention portant cr閍tion de l'Agence multilat閞ale de garantie des investissements, conclue en 1985 et entr閑 en vigueur en avril 1988. Partant de l'id閑 qu'il est possible de faciliter et de promouvoir les apports d'investissement 閠ranger aux pays en d関eloppement en att閚uant les pr閛ccupations li閑s aux risques non commerciaux, l'Agence multilat閞ale de garantie des investissements a principalement pour objectif de compl閠er les syst鑝es nationaux, r間ionaux et priv閟 d'assurance pour les investissements. La Convention pr関oit aussi que l'Agence a un r鬺e ?jouer en ce qui concerne les r鑗les de fond r間issant le traitement des investissements. Aux termes de l'article 12 d) de la Convention, elle doit, lorsqu'elle garantit un investissement, s'assurer en particulier “des conditions offertes aux investissements dans le pays d'accueil et, notamment, de l'existence d'un r間ime juste et 閝uitable et de protections juridiques”. L'article 23 traite de la promotion de l'investissement et dispose que, outre les activit閟 de recherche et d'assistance technique, l'Agence doit faciliter la conclusion d'accords entre les pays signataires pour la promotion et la protection de l'investissement 閠ranger.
Des r鑗les de fond multilat閞ales pour le traitement de l'investissement 閠ranger figurent dans les Principes directeurs (non contraignants), pour le traitement de l'investissement direct 閠ranger 閘abor閟 au Groupe de la Banque mondiale pour donner suite ?la demande formul閑 en avril 1991 par le Comit?du d関eloppement du FMI et de la Banque mondiale en vue de l'閘aboration d'un rapport sur un cadre juridique global incorporant des principes de droit essentiels propre ?promouvoir l'investissement 閠ranger direct. Les Principes directeurs ont 閠?port閟 ?l'attention des membres du Groupe de la Banque mondiale par le Comit?du d関eloppement en septembre 1992, et 閠aient pr閟ent閟 comme 閠ant des param鑤res utiles pour l'admission et le traitement de l'investissement 閠ranger priv?sur le territoire des membres, sans pr閖udice des r鑗les contraignantes du droit international. Ils diff鑢ent principalement sur deux aspects des travaux engag閟 en 1977 ?l'ONU au sujet d'un code de conduite des soci閠閟 transnationales. D'abord, ils comportent uniquement des principes g閚閞aux visant ?orienter les gouvernements sur le comportement ?adopter ?l'間ard des investisseurs 閠rangers, lesquels ne font pas l'objet de r鑗les de conduite. Ensuite, ils ne visent pas ?codifier le droit coutumier international en ce qui concerne le traitement de l'investissement 閠ranger mais ?閚oncer des normes internationales g閚閞alement acceptables en vue de promouvoir l'investissement 閠ranger. Leurs cinq sections portent, respectivement, sur les questions suivantes: champ d'application, admission de l'investissement 閠ranger, r鑗les r間issant le traitement de l'investissement 閠ranger, expropriation et modification ou r閟iliation unilat閞ale des contrats, et r鑗lement des diff閞ends.
Il faut aussi mentionner d'autres instruments multilat閞aux ayant une port閑 diff閞ente mais qui pr閟entent un int閞阾 dans ce contexte. Plusieurs r閟olutions adopt閑s par l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies dans les ann閑s 60 et 70 contiennent des dispositions sur l'investissement 閠ranger qui visent principalement ?affirmer certains droits des pays d'accueil. Les questions relatives ?la politique sociale ont 閠? abord閑s dans la D閏laration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, texte non contraignant adopt?en 1977 et entr? en vigueur en 1978. La D閏laration 閚once des principes dont l'application est recommand閑 aux gouvernements, aux organisations patronales et syndicales des pays d'accueil et d'origine, ainsi qu'aux soci閠閟 multinationales. Ces principes portent sur les politiques g閚閞ales, l'emploi, la formation, les conditions de vie et de travail et les relations professionnelles. Les pratiques commerciales restrictives sont vis閑s par un instrument de l'ONU, l'Ensemble de principes et de r鑗les 閝uitables convenus au niveau multilat閞al pour le contr鬺e des pratiques commerciales restrictives. Cet instrument, adopt?en 1980 sous forme d'une r閟olution non contraignante de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies, 閚once ?l'intention des Etats comme des entreprises des principes pour le contr鬺e des pratiques commerciales restrictives ainsi que des dispositions concernant les consultations, la coop閞ation et l'assistance technique dans le cadre de la CNUCED. Les questions relatives ?la sant?et ?la s閏urit?font l'objet de la R閟olution 39/248 de l'Assembl閑 g閚閞ale des Nations Unies sur les principes directeurs pour la protection du consommateur.
Les n間ociations ont commenc?en 1977 ?l'ONU en vue de l'閘aboration d'un code de conduite des soci閠閟 transnationales visant ?閠ablir un cadre g閚閞al de r鑗les de conduite des soci閠閟 et de r鑗les pour le traitement des soci閠閟 transnationales dans les pays d'accueil. L'un des principaux objectifs du Code envisag?閠ait “d'accro顃re au maximum la contribution des soci閠閟 transnationales au d関eloppement et ?la croissance 閏onomiques et de r閐uire au minimum les effets n間atifs de leurs activit閟”. En ce qui concerne les activit閟 des soci閠閟 transnationales, le projet de code 閚once certaines dispositions g閚閞ales ainsi que des r鑗les de conduite plus sp閏ifiques concernant des questions 閏onomiques, financi鑢es et sociales et la divulgation de renseignements. La question du traitement appliqu?aux soci閠閟 transnationales par les Etats d'accueil est r間ie par des principes g閚閞aux et des dispositions concernant la nationalisation et l'indemnisation, la comp閠ence judiciaire et le r鑗lement des diff閞ends. Il a 閠?mis fin en 1992 aux n間ociations sur le Code et aucune proposition n'a 閠?formul閑 en vue de leur reprise.
V. R鑗les et disciplines de l'OMCqui touchent aux investissements
Il fut un temps o?les r鑗les commerciales multilat閞ales ne contenaient que tr鑣 peu d'閘閙ents ayant un rapport direct avec le traitement de l'investissement 閠ranger. Toutefois, comme le GATT s'est progressivement d関elopp?au fil des s閞ies de n間ociations commerciales successives et, en particulier, en devenant l'OMC, les questions touchant aux investissements ont 閠?de plus en plus souvent abord閑s. Cela tient au fait qu'il y a une plus grande interrelation entre investissement et commerce dans les op閞ations des entreprises et qu'il est de plus en plus difficile de s閜arer les aspects des conditions de la concurrence internationale li閟 au mouvement transfronti鑢es des biens et services de ceux qui concernent l'investissement 閠ranger.
Tout d'abord, il convient de rappeler que le GATT a 閠?cr殫 parce qu'il n'a pas 閠? possible d'閠ablir l'Organisation du commerce international. Cette derni鑢e aurait englob? en plus des questions trait閑s par le GATT, les pratiques commerciales restrictives, les accords de produit, et l'investissement 閠ranger (articles 11 et 12).
La question de l'investissement a 閠?abord閑 ?nouveau dans le cadre de la conf閞ence de r関ision de l'Accord g閚閞al de 1955, entreprise lorsqu'il est devenu 関ident que la Charte de La Havane n'entrerait pas en vigueur. Il en est r閟ult?une R閟olution sur les investissements internationaux destin閟 au d関eloppement 閏onomique, qui reconnaissait qu'un apport croissant de capitaux dans les pays o?se fait sentir le besoin d'investissements de l'閠ranger et, en particulier, dans les pays sous-d関elopp閟, faciliterait la r閍lisation des objectifs de l'Accord g閚閞al. Elle recommandait que les parties contractantes qui 閠aient en mesure de fournir des capitaux pour les investissements internationaux et celles qui d閟iraient obtenir ces capitaux unissent leurs efforts pour cr閑r des conditions qui tendent ?favoriser le mouvement international des capitaux, en tenant compte notamment de l'importance que pr閟entait ? cette fin l'adoption de m閠hodes appropri閑s destin閑s ?garantir la s閏urit?des investissements existants et futurs, ?関iter les doubles impositions et ?pr関oir des facilit閟 pour le transfert du produit des investissements 閠rangers. Elle demandait instamment que les parties contractantes du GATT, ?la requ阾e de toute partie contractante, engagent des consultations et participent ?des n間ociations tendant ?la conclusion d'accords bilat閞aux ou multilat閞aux sur ces questions.
Dans les ann閑s qui ont suivi, le GATT a d?de plus en plus souvent se prononcer sur des instruments de politique interne pouvant fausser les conditions du commerce international. Avant le Cycle d'Uruguay, cette 関olution est apparue tr鑣 nettement lors des n間ociations du Tokyo Round dans les ann閑s 70, lorsque des r鑗les concernant des questions telles que les subventions, les normes techniques et les march閟 publics ont 閠?n間oci閑s. M阭e si, pour la plupart, ces instruments de politique ont 閠? examin閟 du point de vue de leur incidence sur le mouvement transfronti鑢es des marchandises, les r鑗les mises au point ont aussi, dans bien des cas, un rapport avec les conditions de concurrence que rencontrent les investisseurs 閠rangers. Par exemple, comme il est expliqu?ci-apr鑣 de mani鑢e plus d閠aill閑, les r鑗les du GATT et maintenant de l'OMC en mati鑢e de subventions ont un rapport avec les aides ?l'investissement.
Un deuxi鑝e fait nouveau est intervenu dans le cadre du GATT/de l'OMC qui a un rapport plus direct avec les investissements; il s'agit de l'閠ablissement de r鑗les internationales r間issant le traitement des entreprises 閠rang鑢es. A l'origine, les r鑗les du GATT imposaient des obligations aux gouvernements uniquement pour ce qui 閠ait du traitement des produits 閠rangers. Elles ne concernaient pas le traitement des personnes 閠rang鑢es, morales ou physiques, exer鏰nt une activit?sur leur territoire, question qui est au centre de la politique d'investissement. Toutefois, ?la suite des n間ociations du Cycle d'Uruguay, l'OMC a impos?des obligations importantes aux gouvernements en ce qui concerne le traitement des ressortissants 閠rangers ou des entreprises 閠rang鑢es sur leur territoire - dans l'AGCS et l'Accord sur les ADPIC, ainsi que dans l'Accord plurilat閞al sur les march閟 publics.
1) Accord g閚閞al sur le commerce des services
L'int間ration de l'investissement et du commerce transfronti鑢es dans le cadre de l'OMC est des plus 関identes dans l'Accord g閚閞al sur le commerce des services (AGCS). Comme il a 閠? indiqu? la fourniture de nombreux services sur un march?est difficile voire impossible sans la pr閟ence physique du fournisseur des services. L'article I:2 de l'Accord d閒init le “commerce des services” comme englobant quatre modes de fourniture, dont la fourniture “par un fournisseur de services d'un Membre gr鈉e ?une pr閟ence commerciale sur le territoire de tout autre Membre”. L'expression “pr閟ence commerciale” est d閒inie ?l'article XXVIII d) comme s'entendant de “tout type d'閠ablissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou ii) de la cr閍tion ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de repr閟entation, sur le territoire d'un Membre en vue de la fourniture d'un service”. Par cons閝uent, l'AGCS couvre des formes d'閠ablissement qui correspondent ?la notion d'investissement 閠ranger direct (IED). Autre mode de fourniture vis??l'article I:2 qui a un rapport avec l'investissement: la fourniture “par un fournisseur de services d'un Membre, gr鈉e ?la pr閟ence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre”. Ce mode de fourniture est 閠roitement li??celui qui prend la forme d'une pr閟ence commerciale dans la mesure o?il inclut l'entr閑 temporaire de personnes en voyage d'affaires et de personnes transf閞閑s ?l'int閞ieur d'une soci閠?qui font partie du personnel d'encadrement ou autre personnel indispensable.
Tous les Membres de l'OMC ont 閠abli des engagements sp閏ifiques dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne les quatre modes de fourniture. Ces engagements font obligation aux gouvernements d'offrir des conditions d'acc鑣 aux march閟 garanties pour les modes et les secteurs indiqu閟 dans les listes d'engagements sp閏ifiques. Sauf indication contraire, les Membres garantissent ?la fois le droit d'entr閑 sur le march?(article XVI) et le droit au traitement national (article XVII) dans les secteurs figurant sur leur liste. Une liste de six conditions qui peuvent 阾re impos閑s en ce qui concerne l'acc鑣 aux march閟 figure ?l'article XVI. Quatre d'entre elles se rapportent ?diff閞entes sortes de limitations quantitatives qui peuvent s'appliquer aux services ou aux fournisseurs de services 閠rangers. Les deux autres conditions concernent uniquement la pr閟ence commerciale. Elles englobent les mesures qui “restreignent ou prescrivent des types sp閏ifiques d'entit?juridique ou de coentreprise par l'interm閐iaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service” et les “limitations concernant la participation de capital 閠ranger, exprim閑s sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la d閠ention d'actions par des 閠rangers, ou concernant la valeur totale d'investissements 閠rangers particuliers ou des investissements 閠rangers globaux”. Les limitations relatives au traitement national ne sont quant ?elles pas d閒inies d'une mani鑢e analogue, et elles peuvent englober toute forme de discrimination, selon les indications donn閑s dans la liste du Membre.
L'AGCS renferme un cadre de r鑗les 閠ablissant le contexte dans lequel les listes d'engagements sp閏ifiques doivent 阾re lues, y compris pour ce qui est de l'investissement. Certaines de ces r鑗les sont d'application g閚閞ale, tandis que d'autres ne s'appliquent que dans le cas o?un Membre a contract?un engagement sectoriel sp閏ifique. La r鑗le d'application g閚閞ale la plus importante est celle du traitement de la nation la plus favoris閑. Ainsi, l'AGCS exige que les Membres accordent le traitement NPF dans tous les secteurs de services. Certaines obligations en mati鑢e de transparence sont aussi de caract鑢e g閚閞al, mais beaucoup d'autres dispositions - visant des questions telles que la r間lementation int閞ieure, les monopoles et fournisseurs exclusifs de services, les paiements et transferts, et les mesures destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des paiements - n'interviennent que dans le contexte des engagements sp閏ifiques.
Lorsqu'on envisage l'AGCS comme un cadre pour des r鑗les internationales concernant l'investissement, deux constatations s'imposent quant au contenu et ?la structure de l'Accord. Ces deux constatations sont ?prendre en consid閞ation dans toute r閒lexion sur la fa鏾n dont un accord international largement repr閟entatif destin??r間ir les investissements devrait 阾re structur? Premi鑢ement, l'AGCS n'est pas un accord sur l'investissement ?proprement parler. Il envisage l'investissement comme un des diff閞ents moyens d'acc閐er ?un march? Il ne contient pas de dispositions visant ? prot間er les investissements comme on en trouve g閚閞alement dans un grand nombre des accords d'investissement bilat閞aux et r間ionaux examin閟 ant閞ieurement. Il ne comporte pas non plus de syst鑝e offrant aux investisseurs priv閟 la possibilit? d'acc閐er directement ?un m閏anisme international de r鑗lement des diff閞ends. D'un autre c魌? en consid閞ant l'investissement comme un des 閘閙ents du commerce des services, l'AGCS traite non seulement des modalit閟 et conditions r間issant l'acc鑣 aux march閟 des investisseurs 閠rangers, mais aussi du "commerce par le biais d'un 閠ablissement" - en d'autres termes, des conditions d'exploitation dans la phase post閞ieure ?l'investissement, ce qui est aussi une caract閞istique d'un grand nombre des accords d'investissement bilat閞aux et r間ionaux analys閟 plus haut.
Deuxi鑝ement, en d閒inissant le traitement national comme une obligation qui porte uniquement sur les engagements inscrits dans les listes, l'AGCS s'閏arte d'un certain nombre d'autres accords intergouvernementaux relatifs aux investissements dans lesquels le traitement national a le m阭e statut que le traitement NPF, ?savoir celui d'un principe d'application g閚閞ale (mais soumis, dans bien des cas, ?des r閟erves). Par ailleurs, il 閠ablit une structure dans laquelle il est possible pour les gouvernements, en accord avec les partenaires commerciaux, d'accorder le traitement national sous certaines conditions, ou en partie seulement. De m阭e, la notion d'acc鑣 aux march閟 contenue dans l'article XVI de l'AGCS permet aux gouvernements de d閠erminer la mesure dans laquelle l'entr閑 des fournisseurs 閠rangers sera autoris閑. Cette capacit?d'ouvrir les march閟 nationaux ?la concurrence des fournisseurs 閠rangers par degr?est obtenue dans les autres accords au moyen d'exceptions et de r閟erves.
Lorsqu'il s'agit de d閒inir le champ d'application d'un accord, on peut faire une distinction entre la m閠hode de la liste "n間ative" et celle de la liste "positive". Dans le premier cas, les gouvernements doivent sp閏ifier les secteurs ou mesures auxquelles les obligations ne s'appliquent pas. Dans le second cas, au contraire, il faut 閚um閞er les secteurs ou mesures au sujet desquelles des obligations vont 阾re contract閑s. Dans les 閏hanges de vues sur la meilleure m閠hode ?suivre pour d閠erminer l'閠endue d'engagements, d'aucuns ont fait valoir que la m閠hode de la liste n間ative assure davantage de transparence et encourage les gouvernements ?donner plus d'informations lors des n間ociations au sujet de leurs engagements. Il a 間alement 閠? relev?qu'avec cette m閠hode, les nouvelles activit閟 d閏oulant des progr鑣 technologiques seront automatiquement vis閑s, alors qu'avec la m閠hode de la liste positive il faudrait pour cela ins閞er une disposition expresse ?cet effet. Un certain nombre des accords internationaux examin閟 ant閞ieurement reposent sur la m閠hode de la liste n間ative. En fait, l'AGCS est une combinaison des deux m閠hodes, puisqu'il utilise celle de la liste positive pour les secteurs et celle de la liste n間ative pour les limitations concernant l'acc鑣 aux march閟 et le traitement national.
Enfin, il convient de souligner deux points de caract鑢e plus g閚閞al en ce qui concerne l'AGCS. Premi鑢ement, c'est un nouvel accord, qui est entr?en vigueur en 1995, et les gouvernements savaient fort bien lorsqu'ils l'ont n間oci?qu'il restait beaucoup ? faire. Comme l'Accord g閚閞al avant lui, l'AGCS est un cadre destin??permettre la lib閞alisation progressive du commerce des services moyennant d'autres n間ociations. En fait, il contient un engagement implicite ?l'article XIX, ?savoir de continuer ? n間ocier la lib閞alisation au moyen de s閞ies de n間ociations successives dont la premi鑢e devrait commencer avant l'an 2000. Deuxi鑝ement, il est un des rares accords visant l'investissement 閠ranger ayant un caract鑢e ?la fois multilat閞al et contraignant. En raison de la nature multilat閞ale de l'AGCS, les accords d'investissement bilat閞aux et r間ionaux actuels et futurs devront tenir pleinement compte de ses dispositions, et en particulier de l'engagement ferme concernant le traitement NPF.
2) Accord sur les aspects des droits de propri閠? intellectuelle qui touchent au commerce
L'Accord sur les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est un autre exemple important de l'関olution du syst鑝e commercial multilat閞al qui, d'un ensemble de r鑗les destin閑s essentiellement ?r間lementer les politiques touchant le commerce transfronti鑢es des marchandises, est devenu un ensemble de r鑗les englobant aussi le traitement accord?par le pays d'accueil aux entreprises 閠rang鑢es. Bien que l'Accord sur les ADPIC ne traite pas directement de l'investissement 閠ranger, ses dispositions sur les normes minimales pour la protection de la propri閠?intellectuelle, les proc閐ures nationales destin閑s ?faire respecter les ADPIC, et le r鑗lement des diff閞ends internationaux ont un rapport direct avec l'environnement juridique touchant l'investissement 閠ranger (dans de nombreux accords d'investissement intergouvernementaux, la d閒inition du terme "investissement" inclut express閙ent la propri閠?intellectuelle).
En vertu de l'Accord sur les ADPIC, chaque Membre de l'OMC est tenu d'accorder sur son territoire la protection prescrite par ledit accord ?la propri閠?intellectuelle des ressortissants des autres Membres de l'OMC. L'Accord couvre tous les grands domaines de la propri閠?intellectuelle - droit d'auteur et droits connexes, marques de fabrique ou de commerce, indications g閛graphiques, dessins et mod鑜es industriels, brevets, sch閙as de configuration de circuits int間r閟 et renseignements non divulgu閟 ou secrets commerciaux. En ce qui concerne ces domaines, il contient deux grands ensembles d'obligations fondamentales.
Premi鑢ement, il 閚once des normes minimales de protection fondamentale pour chacune des cat間ories de droits qui doivent 阾re offertes dans la l間islation nationale de chaque membre, ?un niveau qui est proche de celui qui existe de nos jours dans les principaux pays industriels. Pour cela, il dispose que les obligations fondamentales des principales conventions de l'OMPI, ?savoir la Convention de Paris pour la protection de la propri閠?industrielle et la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litt閞aires et artistiques, doivent 阾re respect閑s et il y ajoute un nombre important d'obligations concernant des points sur lesquels ces conventions sont soit muettes soit jug閑s insuffisantes. Pour chaque domaine de la propri閠?intellectuelle, il indique l'objet de la protection, les droits minimaux qui doivent d閏ouler de cette protection et les exceptions autoris閑s ?ces droits, ainsi que la dur閑 minimale de la protection.
La seconde caract閞istique majeure de l'Accord est le fait que, pour la premi鑢e fois dans l'histoire du droit international, on sp閏ifie d'une mani鑢e plus ou moins d閠aill閑 les proc閐ures et les mesures correctives que chaque membre doit pr関oir dans sa l間islation nationale de sorte que les ressortissants des autres membres puissent effectivement faire respecter leurs droits de propri閠?intellectuelle - que ce soit par la voie judiciaire civile normale, au moyen d'une proc閐ure douani鑢e contre les importations de marchandises contrefaites et pirat閑s, ou par des poursuites p閚ales pour contrefa鏾n et piraterie volontaires ?une 閏helle commerciale.
3) Accord sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce
L'Accord sur les mesures concernant les investissements et li閑s au commerce (MIC) vise, comme il est dit dans son pr閍mbule, non seulement ?promouvoir l'expansion et la lib閞alisation progressive du commerce mondial mais aussi ?faciliter les investissements ?travers les fronti鑢es internationales. Il pr閟ente trois grandes caract閞istiques. Premi鑢ement, il pr閏ise que certains types de MIC appliqu閑s aux entreprises, qui figurent dans une liste exemplative, sont incompatibles avec le GATT. Celles-ci concernent essentiellement les prescriptions relatives ?la teneur en produits nationaux et ?l'閝uilibrage des 閏hanges, et comprennent non seulement les mesures obligatoires mais aussi celles auxquelles il faut se conformer pour obtenir un avantage. De telles mesures apparaissent fr閝uemment dans le contexte de l'IED, mais les r鑗les en mati鑢e de MIC s'appliquent 間alement aux mesures impos閑s aux entreprises nationales. Les r鑗les s'appliquent aussi ?la fois aux mesures touchant les investissements actuels et ?celles qui visent les nouveaux investissements.
Deuxi鑝ement, l'Accord exige que toutes les MIC qui sont incompatibles avec les articles III et XI du GATT, et qui ne peuvent pas se justifier au titre de l'une des exceptions pr関ues dans le cadre du GATT, soient notifi閑s dans un d閘ai de 90 jours ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Ces mesures doivent 阾re 閘imin閑s dans un certain d閘ai - deux ans dans le cas des pays d関elopp閟, cinq ans pour les pays en d関eloppement et sept ans pour les pays les moins avanc閟. Pour 関iter de fausser les conditions de concurrence entre les nouveaux investissements et les entreprises 閠ablies d閖?soumises ?une MIC, les membres peuvent appliquer la m阭e MIC aux nouveaux investissements pendant la p閞iode de transition, sous r閟erve de certaines conditions.
La troisi鑝e caract閞istique importante de l'Accord sur les MIC est le fait qu'il pr関oit un examen dans les cinq ans, examen au cours duquel il sera d閠ermin?s'il convient de compl閠er l'Accord par des dispositions relatives ?la politique en mati鑢e d'investissement et la politique en mati鑢e de concurrence.
4) Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) d閒init la notion de “subvention” et 閠ablit les disciplines r間issant l'octroi des subventions. Dans la taxonomie des aides ?l'investissement expos閑 plus haut (Partie III), quelques types de mesures au moins dans chacune des trois cat間ories (incitations fiscales, incitations financi鑢es et incitations indirectes) sont des subventions au sens de l'Accord SMC. En effet, elles peuvent comporter une contribution financi鑢e des pouvoirs publics ou d'un organisme public, et conf鑢ent un avantage. Les incitations fiscales, par exemple, rel鑦ent g閚閞alement de la d閒inition donn閑 dans l'Accord SMC du cas o?“des recettes publiques normalement exigibles sont abandonn閑s ou ne sont pas per鐄es (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les cr閐its d'imp魌)”. Les incitations financi鑢es, telles que le transfert direct de fonds sous la forme de dons et de cr閐its subventionn閟, correspondent g閚閞alement ?la d閒inition donn閑 dans l'Accord SMC du cas o?“une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, pr阾s et participation au capital social)”. Enfin, quelques types d'incitations indirectes au moins semblent 阾re des subventions au sens de l'Accord SMC; en particulier, la fourniture d'un terrain ou d'une infrastructure ?un prix inf閞ieur ?celui du march?semble relever de la d閒inition du cas o?“les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure g閚閞ale ou ach鑤ent des biens”.
Un certain nombre de disciplines multilat閞ales s'appliquent normalement, en vertu de l'Accord SMC, aux aides ?l'investissement qui correspondent ?ces d閒initions. Les aides ?l'investissement correspondant ?la d閒inition d'une subvention et dont l'octroi est subordonn??l'exportation des marchandises produites (ou ?produire) par un investisseur ou ?l'utilisation de produits nationaux de pr閒閞ence aux produits import閟, sont interdites par l'Accord. En outre, les incitations ?l'investissement autres que celles qui correspondent ?la d閒inition des subventions prohib閑s sont 間alement soumises aux disciplines de l'Accord SMC. En effet, m阭e si elles ne sont pas prohib閑s, les incitations qui ont des “effets d閒avorables” au sens de l'Accord SMC pourraient fort bien faire l'objet de mesures compensatoires, soit au niveau multilat閞al soit dans le cadre de la l間islation nationale des Membres de l'OMC. Dans le contexte multilat閞al, les dispositions de l'Accord SMC concernant le pr閖udice grave se r閒鑢ent directement aux incitations ?l'investissement. L'annexe IV en particulier, qui donne des lignes directrices pour le calcul permettant de d閠erminer si le taux de subventionnement ad valorem total d'un produit est suffisant pour donner lieu ? une pr閟omption de pr閖udice grave, inclut les subventions accord閑s aux entreprises en situation de d閙arrage, c'est-?dire les cas o?des engagements financiers ont 閠? contract閟 pour le d関eloppement d'un produit ou la construction d'installations mais o?la production n'a pas encore commenc?
Cela dit, les principes qui sous-tendent l'Accord SMC sont ax閟 sur le commerce des marchandises, et en tant que tels, ne sont pas toujours ais閙ent applicables aux aides ? l'investissement. Cette question serait ?prendre en consid閞ation dans le contexte d'un code d'investissement multilat閞al, pour autant que ce code vise en partie ?discipliner l'utilisation des incitations. Comme on l'a vu plus haut, la concurrence entre les aides ?l'investissement des diff閞ents pays, lesquelles peuvent 阾re un 閘閙ent d閠erminant du lieu d'implantation qui sera en dernier ressort choisi pour un investissement, peut ais閙ent donner lieu ?des distorsions 閏onomiques. Parce qu'elles concernent les 閏hanges de marchandises, qui par d閒inition interviennent uniquement apr鑣 que l'investissement a 閠?effectu? les disciplines de l'Accord SMC r間issant les subventions ne peuvent pas ?elles seules rem閐ier enti鑢ement ?de telles distorsions.
5) Accord plurilat閞al sur les march閟 publics
Le premier pas important du syst鑝e GATT/OMC dans le domaine du traitement des entreprises 閠rang鑢es par les pays d'accueil a 閠?l'Accord de 1979 relatif aux march閟 publics. S'agissant des op閞ations de passation de march閟 vis閑s, cet accord disposait qu'il ne devait pas y avoir de discrimination ?l'間ard des produits 閠rangers, ni ?l'間ard des fournisseurs 閠rangers, ni surtout ?l'間ard des fournisseurs 閠ablis dans le pays selon le degr?de participation ou de contr鬺e 閠ranger. Un nouvel accord sur les march閟 publics, dont la n間ociation a 閠?achev閑 en m阭e temps que le Cycle d'Uruguay, est maintenant en vigueur. La r鑗le fondamentale de non-discrimination susmentionn閑 est maintenue et la valeur des march閟 vis閟 est d閏upl閑, le champ d'application s'閠endant d閟ormais aux services en plus des marchandises, et aux march閟 pass閟 aux niveaux des entit閟 des gouvernements sous-centraux et des services publics ainsi qu'au niveau des entit閟 du gouvernement central. Le nouvel accord contient aussi un certain nombre de nouvelles r鑗les importantes, par exemple, le droit pour les fournisseurs de contester devant les tribunaux nationaux la conformit?des d閏isions dans ce domaine avec les r鑗les internationales elles-m阭es - c'est ce qu'on appelle les “proc閐ures de contestation”.
6) R鑗lement des diff閞ends
Les futurs diff閞ends faisant intervenir les r鑗les et disciplines de l'OMC li閑s ?l'IED seront r間l閟 dans le cadre du m閏anisme de r鑗lement des diff閞ends int間r?de l'OMC, contenu dans le M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends. C'est un m閏anisme renforc?et unifi?de r鑗lement des diff閞ends entre les gouvernements membres qui s'appliquera ?tous les aspects des accords annex閟 ? l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris ceux qui concernent les MIC, les services, les ADPIC, les subventions et mesures compensatoires et les march閟 publics dont on vient de parler. Le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends a 閠? consid閞ablement renforc?par rapport ?celui du GATT, notamment par la suppression des moyens qui permettaient aux Membres de retarder ou de bloquer le processus de r鑗lement d'un diff閞end. Il y a maintenant des d閘ais plus stricts ?respecter pour mener ? bien les diff閞entes 閠apes du processus et les rapports de groupes sp閏iaux seront consid閞閟 comme adopt閟 ?moins qu'il n'en soit d閏id?autrement par consensus. La possibilit?de faire appel est aussi une nouveaut?par rapport ?l'ancien syst鑝e, cette 閠ape ayant 閠?ajout閑 en raison de la nature plus contraignante et plus automatique du nouveau m閏anisme.
VI. R閟um?et conclusions
Il est incontestable qu'il y a synergie entre l'investissement 閠ranger direct et le commerce international en g閚閞al et qu'ils forment ensemble le moteur de l'int間ration en cours de l'閏onomie mondiale. Par le jeu de l'investissement et du commerce, les entreprises de chaque pays sont en mesure de se sp閏ialiser pour produire ce qu'elles sont capables de produire avec le plus d'efficacit? Le commerce facilite ce processus en permettant ?une 閏onomie de se sp閏ialiser dans une production, puis d'閏hanger une partie de cette production ? l'閠ranger afin d'obtenir la gamme particuli鑢e de produits et de services que ses citoyens veulent consommer. L'IED facilite ce processus en accroissant la mobilit? internationale, et partant, l'utilisation efficace, des apports mondiaux en capitaux et en technologie, y compris en comp閠ences au plan de l'organisation, de la gestion et de la commercialisation. Cette synergie est au coeur des strat間ies de d関eloppement et, d'une mani鑢e plus g閚閞ale, des efforts d閜loy閟 ?l'閏helle mondiale pour accro顃re les niveaux de richesse et de vie.
La pr閟ente section finale commence par un r閟um?des principales constatations, tout d'abord sous la forme de certains faits marquants, puis d'un aper鐄 des principales relations 閏onomiques, institutionnelles et juridiques entre l'IED et le commerce. Elle s'ach鑦e par un tour d'horizon des grands probl鑝es de politique auxquels se heurtent les Membres de l'OMC en ce qui concerne l'investissement 閠ranger direct.
1) Faits marquants
L'analyse pr閏閐ente portait sur un grand nombre de questions et de points concernant l'IED et, tout particuli鑢ement, les liens r閏iproques entre l'IED et le commerce. Les constatations les plus importantes du pr閟ent rapport sont notamment les suivantes:
L'importance croissante de l'IED
• De 1986 ?1989 et de nouveau en 1995, l'IED a augment?beaucoup plus rapidement que le commerce mondial. Au cours de la p閞iode 1973-1995, la valeur estim閑 des flux entrants annuels d'IED a 閠?multipli閑 par 12 (passant de 25 milliards de dollars ?315 milliards), et celle des exportations de marchandises a augment?de 8 fois et demie (4 900 milliards de dollars contre 575).
• Selon des estimations, les ventes des filiales 閠rang鑢es de soci閠閟 multinationales ont 閠?sup閞ieures ?la valeur du commerce mondial de marchandises et de services (celui-ci se chiffrant ?6 100 milliards de dollars en 1995).
• Toujours selon les estimations, les 閏hanges intragroupe des soci閠閟 multinationales ont repr閟ent?environ un tiers du commerce mondial et les exportations de ces soci閠閟 destin閑s ?toutes les autres entreprises un autre tiers, le tiers restant 閠ant constitu?par les 閏hanges entre entreprises nationales (autres que les soci閠閟 multinationales).
R閜artition g閛graphique
• Les pays d関elopp閟 fournissent ou absorbent la majeure partie de l'IED, mais les pays en d関eloppement prennent de plus en plus d'importance en tant que pays d'accueil et pays d'origine.
• La part des pays non membres de l'OCDE dans les flux entrants mondiaux d'IED, qui avait d閏ru dans les ann閑s 80, est pass閑 de pr鑣 de 20 ?environ 35% entre 1990 et 1995. Toutefois, ces flux ont 閠?fortement concentr閟, dix pays absorbant pr鑣 de 80% du total (78 milliards de dollars sur 102 milliards).
• Pr鑣 d'un tiers des 20 premi鑢es 閏onomies d'accueil d'IED entre 1985 et 1995 sont des 閏onomies en d関eloppement. La Chine vient au quatri鑝e rang et le Mexique, Singapour, la Malaisie, l'Argentine, le Br閟il et Hong Kong figurent aussi sur cette liste.
• Les pays non membres de l'OCDE ont repr閟ent?15% des flux sortants mondiaux d'IED en 1995, contre 5% seulement au cours de la p閞iode 1983-1987.
Une large gamme de liens r閏iproques
• Les politiques commerciales peuvent affecter l'IED de bien des fa鏾ns. Un faible niveau de protection ?l'importation - surtout s'il est consolid?- peut agir comme un puissant aimant sur l'IED orient?vers l'exportation. Par contre, des droits de douane 閘ev閟 peuvent inciter l'IED qui les contourne ?desservir le march?local et des IED dits “quid pro quo” peuvent 阾re effectu閟 afin de parer ?une menace de protectionnisme.
• Le March?unique europ閑n a suscit?une activit?d'investissement substantielle tant ?l'int閞ieur de l'Union europ閑nne que vers celle-ci en provenance de pays tiers, et des effets similaires sur les flux d'IED ont 閠?observ閟 dans le cadre d'autres accords commerciaux r間ionaux.
• Aucun argument empirique s閞ieux ne plaide en faveur de l'opinion selon laquelle l'IED exerce un effet n間atif important sur le niveau global des exportations du pays d'origine. Au contraire, il est empiriquement prouv?qu'il existe un lien mod閞閙ent positif entre l'IED et les exportations et les importations du pays d'origine. Il est 間alement prouv?que l'IED et les exportations du pays d'accueil sont compl閙entaires, mais que l'IED et les importations de ce pays peuvent 阾re soit substituables soit compl閙entaires selon les composantes de la situation, notamment la politique appliqu閑 (l'IED attir?par de faibles co鹴s de production et des r間imes de commerce lib閞aux semblent devoir 阾re compl閙entaires des importations, et vice versa pour l'IED qui contourne les droits de douane).
• L'IED peut 阾re une source non seulement de capitaux, mais aussi de nouvelles technologies et d'autres 閘閙ents incorporels, par exemple comp閠ences en mati鑢e d'organisation et de gestion et r閟eaux de commercialisation. Il peut aussi 阾re propice au commerce, ?la croissance 閏onomique et ?l'emploi dans les pays d'accueil en stimulant les productions nationales, ainsi qu'?la concurrence, ?l'innovation, ? l'閜argne et ?la formation de capital. En outre, l'IED conf鑢e ?l'investisseur un atout dans le d関eloppement 閏onomique futur du pays d'accueil. En bref, c'est un 閘閙ent capital de promotion de la croissance et du progr鑣 dans les pays en d関eloppement.
La r閍lit?des incitations ? l'IED
• Les incitations destin閑s ?attirer l'IED sont tr鑣 fortes dans certains des pays les plus industrialis閟. Non seulement ces incitations d閠ournent l'IED vers les pays les mieux lotis, mais la r閍lit?de leur fonctionnement - elles ne sont pas diff閞entes de n'importe quelle autre sorte de programme de subvention - est une source de vive pr閛ccupation. Tr鑣 souvent, on ne sait gu鑢e ou pas du tout quel est l'int閞阾 r閑l d'un projet pour le pays d'accueil (ce qui est pourtant n閏essaire pour une utilisation efficace des incitations). En outre, les incitations risquent d'阾re accapar閑s au niveau politique par des groupes d'int閞阾s particuliers, le danger d'introduire de nouvelles distorsions est tr鑣 grand et la surench鑢e entre pays d'accueil en puissance en mati鑢e d'octroi d'incitations peut alourdir le prix ?payer pour attirer l'IED, ce qui r閐uit, voire annule, tout gain net pour le pays d'accueil.
Une multitude de r鑗les
• Depuis le d閎ut des ann閑s 80, il existe une tendance g閚閞alis閑 ?la lib閞alisation des l間islations et r間lementations nationales concernant l'investissement 閠ranger, en particulier dans les pays en d関eloppement et dans les pays en transition. Toutefois, une action unilat閞ale n'a pas 閠?jug閑 suffisante en ce qui concerne le caract鑢e irr関ersible des r閒ormes et leur cr閐ibilit?aux yeux des investisseurs ou la compatibilit?avec les autres r間imes de l'IED. En l'absence d'un r間ime multilat閞al, la lib閞alisation des r間imes nationaux de l'IED s'est accompagn閑 d'une prolif閞ation rapide des arrangements intergouvernementaux concernant les questions relatives ?l'investissement 閠ranger aux niveaux bilat閞al, r間ional (par exemple, l'ALENA et le MERCOSUR) et plurilat閞al. Sur pr鑣 de 1 160 accords bilat閞aux d'investissement conclus jusqu'en juin 1996, environ deux tiers ont 閠? sign閟 au cours des ann閑s 90.
• En outre, les membres de l'OCDE, qui sont actuellement ?l'origine d'environ 85% des flux sortants mondiaux d'IED, sont en n間ociation depuis mai 1995 dans le but de conclure un Accord multilat閞al sur les investissements en 1997. Il s'agit d'un trait?international ind閜endant, ouvert aux membres de l'OCDE et ?la Communaut?europ閑nne et ? l'accession des pays non membres de l'OCDE.
L'OMC aussi a des r鑗les touchant l'IED
• Alors que les r鑗les initiales du GATT n'imposaient des obligations aux gouvernements qu'en ce qui concerne le traitement des produits 閠rangers, l'OMC, ?travers l'AGCS et l'Accord sur les ADPIC, ainsi que l'Accord plurilat閞al sur les march閟 publics, impose des obligations importantes aux gouvernements en ce qui concerne le traitement des ressortissants et soci閠閟 閠rangers sur leurs territoires. Par l'inclusion de r鑗les sur la “pr閟ence commerciale” (qui s'entend de n'importe quel type d'閠ablissement commercial ou professionnel), l'AGCS reconna顃 que l'IED est une condition pr閍lable pour exporter de nombreux services.
• L'Accord sur les MIC pr関oit un examen dans cinq ans, dans le cadre duquel sera examin閑 la question de savoir s'il doit 阾re compl閠?par des dispositions sur la politique en mati鑢e d'investissement et de concurrence.
• L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires entend par subventions certains types de mesures dans chacune des trois grandes cat間ories d'incitations ?l'IED (incitations fiscales, incitations financi鑢es et incitations indirectes).
• Les Membres de l'OMC examinent actuellement, dans le cadre des pr閜aratifs pour la R閡nion minist閞ielle de l'OMC qui se tiendra ?Singapour en d閏embre 1996, une proposition d'閠ablissement d'un programme de travail sur le commerce et l'investissement visant ?clarifier les questions dans ce domaine.
Consid閞ations de politique
• Les r鑗les de l'OMC touchant les investissements sont contraignantes, comme le sont celles de la quasi-totalit?des accords bilat閞aux, r間ionaux et plurilat閞aux. Par contre, les divers instruments multilat閞aux concernant l'IED, dont aucun n'est tr鑣 d閠aill? sont en g閚閞al non contraignants. De fa鏾n plus g閚閞ale, l'une des caract閞istiques frappantes de la structure actuelle des r鑗les ?niveaux multiples en mati鑢e d'investissement r閟ide dans la diversit?des approches et des principes juridiques de base.
• En cons閝uence, ce qui importe principalement pour l'heure, c'est la coh閞ence des politiques actuelles et futures. Les gouvernements ont le choix entre deux options: continuer ?traiter les probl鑝es d'IED sur le plan bilat閞al ou en petits groupes avec, en compl閙ent, un ensemble disparate de r鑗les ?l'OMC, ou rechercher les possibilit閟 d'閠ablir un cadre d閠aill?destin??assurer que les r鑗les en mati鑢e d'investissement et de commerce soient compatibles et synergiques. Il ne fait gu鑢e de doute que les investisseurs ont une forte pr閒閞ence pour la seconde option.
2) Les liens 閏onomiques
IED et commerce
Le lien 閏onomique le plus 関ident entre l'IED et le commerce est celui qui est examin?dans la Partie II, ? savoir l'incidence de l'IED sur le commerce des pays d'accueil et des pays d'origine, et partant, sur le niveau et la structure du commerce mondial. Pour de nombreux services, le producteur doit disposer ?l'閠ranger d'installations de production (succursales bancaires, h魌els, bureaux de comptabilit? pour exporter le service. Bien que pas n閏essairement dans la m阭e mesure, cela est de plus en plus vrai pour les entreprises de production de marchandises. Dans une 閏onomie globale o?la concurrence augmente progressivement, une entreprise tourn閑 vers l'exportation peut fort bien devoir se doter de moyens d'op閞er dans d'autres pays pour rester concurrentielle, c'est-?dire pour survivre. Ces moyens peuvent comprendre des r閟eaux de distribution qui s'occupent de commercialisation, des stocks et du service apr鑣-vente. Le r閟ultat semble devoir 阾re non seulement le maintien, mais l'accroissement, du niveau de l'activit?commerciale de cette entreprise.
IED et commerce sont 間alement des parties int間rantes des efforts que les soci閠閟 d閜loient pour organiser leurs processus de production de mani鑢e efficace. En fractionnant un processus de production en diff閞entes op閞ations, en localisant chaque op閞ation dans un pays o?elle peut s'effectuer avec efficacit?et en reliant toutes les diverses op閞ations par le biais du commerce, ces soci閠閟 peuvent fournir aux acheteurs du monde entier des biens et services produits dans des conditions d'efficacit? Etant donn?que les 閏hanges intragroupe des soci閠閟 multinationales repr閟entent approximativement un tiers du commerce mondial et que les exportations de ces soci閠閟 destin閑s ?des entreprises autres que leurs filiales en repr閟entent environ un autre tiers, il est 関ident que l'IED peut am閘iorer l'acc鑣 des pays d'accueil aux march閟 閠rangers. L'IED a 間alement une incidence sur les courants d'閏hanges gr鈉e au transfert de technologie ainsi que gr鈉e ?son r鬺e de stimulant de la concurrence, de l'innovation, de la productivit? de l'閜argne et de la formation de capital dans les pays d'accueil.
Liens au niveau des politiques
La r閍lit?de l'IED est donc beaucoup plus complexe que ne le sugg鑢e l'opinion traditionnelle selon laquelle IED et commerce sont des moyens alternatifs pour fournir un march?閠ranger, et donc substituables. L'IED et le commerce des pays d'origine et des pays d'accueil sont, comme on l'a d閖?not? g閚閞alement compl閙entaires. A ce sujet, des politiques lib閞ales en mati鑢e de commerce et d'investissement stimulent l'IED et renforcent la relation positive entre IED et commerce. Par contre, des droits de douane 閘ev閟, des menaces de protection contingente et des subventions financi鑢es ou fiscales peuvent pousser fortement ?opter pour le commerce plut魌 que pour l'investissement, et m阭e - dans le cas de pays dont les march閟 int閞ieurs sont vastes par rapport ?ceux de leurs voisins - ?un transfert d'investissements par des soci閠閟 voisines dans le pays offrant une protection. Comme c'est le cas avec la totalit?de l'IED qui contourne les droits de douane, ce transfert d'investissements ? tout prix, non seulement se fait au d閠riment d'autres pays, mais aussi grossit le nombre des entreprises du nouveau pays d'accueil qui ne sont pas concurrentielles sur le plan international.
Certes, la politique commerciale d'un pays n'est qu'un des nombreux facteurs qui d閠erminent les flux entrants d'IED. Cependant, l'un des 閘閙ents extr阭ement importants dans toute d閏ision d'investir est le degr?d'incertitude et le risque que l'investissement envisag?court ?“souvent long” terme. Il s'ensuit que la structure et la stabilit?des politiques commerciales actuelles et des politiques futures possibles, tant des pays d'accueil en puissance que des march閟 閠rangers potentiels, exerceront une influence importante sur la volont?des entreprises de trouver des clients sur des march閟 閠rangers, d'implanter des productions dans des pays d'accueil ou de fractionner les processus de production en op閞ations s'effectuant dans diff閞ents pays d'accueil. Cette “dimension politique commerciale” des programmes destin閟 ?attirer l'IED est importante non seulement pour la grande majorit?des pays qui ne disposent pas d'un grand march?int閞ieur, mais de plus en plus pour tous les march閟, 閠ant donn? qu'un nombre croissant d'entreprises “pensent mondial” et consid鑢ent souvent que m阭e de grands march閟 constituent des bases d'exportation potentielles.
La politique d'investissement est un facteur important dans la mesure o?un pays peut b閚閒icier des syst鑝es internationaux de distribution des soci閠閟 multinationales, d'閏hanges internationaux intragroupe et de transferts de technologie. Elle est 間alement importante dans la mesure o?les partenaires commerciaux b閚閒icient d'un acc鑣 effectif au march?de ce pays, non seulement pour des services, mais aussi, de plus en plus, pour de nombreux types de produits. Aussi est-il important non seulement que l'IED soit tr鑣 recherch?par un grand nombre de pays ?tout niveau de d関eloppement, mais que beaucoup de pays aient lib閞alis?leurs r間imes d'investissement parall鑜ement ?leurs r間imes commerciaux. Au cours de la p閞iode 1991-1994, pratiquement toutes les modifications (368 sur 373) apport閑s aux r間imes d'investissement nationaux allaient dans le sens d'une lib閞alisation. Ce processus de lib閞alisation a 閠?particuli鑢ement marqu?dans les pays en d関eloppement et les pays en transition qui ont 間alement entrepris de lib閞aliser consid閞ablement et, dans une grande mesure, de mani鑢e autonome, leurs r間imes commerciaux. Le changement d'attitude des pays en d関eloppement et des pays en transition, face ?l'IED, qui n'閜rouvaient auparavant que scepticisme, voire hostilit? ?son 間ard, ainsi que la lib閞alisation et une plus grande pr関isibilit?de leurs politiques en mati鑢e de commerce et d'investissement, ont jou?un tr鑣 grand r鬺e dans l'accroissement de la part de l'IED global destin??ces pays.
Un coup de pouce potentiel ? l'IED en faveur des pays les moins avanc閟
La relation de compl閙entarit?entre l'IED et le commerce est aussi un 閘閙ent majeur de l'un des probl鑝es les plus urgents auxquels la communaut?internationale est confront閑, ? savoir comment inverser la croissance de l'閏art entre bien des pays les plus pauvres du monde et le reste de l'閏onomie mondiale. En 1994, les pays en d関eloppement (beaucoup figurant parmi les moins avanc閟) dont les exportations de marchandises 閠aient inf閞ieures ?leurs niveaux de 1985 閠aient au nombre de 35. Comme la valeur du commerce mondial des marchandises a plus que doubl?au cours de cette p閞iode de dix ans, m阭e un niveau inchang?d'exportations aurait d閚ot?un retard important par rapport ?l'int間ration en cours de l'閏onomie mondiale. Or, bien que la part des pays en d関eloppement dans les flux entrants mondiaux d'IED ait plus que doubl?entre 1990 et 1994, les pays les moins avanc閟 ne b閚閒icient toujours pratiquement pas d'IED. Au cours de la p閞iode 1988-1994, les flux d'aide publique au d関eloppement ont repr閟ent?98% des flux financiers nets en leur faveur.
Le bas niveau des 閏hanges commerciaux et des flux entrants d'IED est plus un sympt鬽e qu'une cause de la situation critique de bien des pays les plus pauvres. En outre, si les mesures correctives prises par ces pays eux-m阭es et par d'autres pays pr閛ccup閟 par leur situation ne conduisent pas - entre autres am閘iorations - ?un accroissement des apports d'IED et des 閏hanges, on voit mal comment une importante am閘ioration de leurs perspectives 閏onomiques peut 阾re obtenue. Ainsi qu'il a 閠?soulign?plus haut, l'IED s'accompagne de ressources qui font tr鑣 gravement d閒aut dans les pays pauvres, ?savoir capitaux, technologie et actifs incorporels telles que comp閠ences en mati鑢e d'organisation, de gestion et de commercialisation. Ces ressources peuvent jouer ?leur tour un r鬺e capital dans les efforts d閜loy閟 pour restructurer et diversifier l'閏onomie et la rendre plus comp閠itive.
3) Les liens institutionnels juridiques
Comme dans le domaine du commerce, les pays se sont rendus compte qu'une action purement unilat閞ale dans le domaine de l'investissement n'est pas suffisante - en l'occurrence pas suffisante pour imprimer l'impulsion d閟ir閑 aux flux d'IED. Le besoin s'est alors fait largement sentir de n間ocier des accords internationaux qui offrent un cadre pour la protection et la promotion des investissements. Cela s'est traduit notamment par la forte augmentation, d閖?not閑, des accords bilat閞aux en mati鑢e d'investissement depuis 1990, dont un nombre croissant entre pays en d関eloppement. On a aussi assist??une prolif閞ation des arrangements r間ionaux et autres visant ?r閜ondre ?la n閏essit?per鐄e de r鑗les internationales concernant l'investissement 閠ranger. La plupart traitent des questions d'investissement dans le cadre d'arrangements d'int間ration 閏onomique plus large centr閟 sur le commerce. Certains de ces arrangements existent depuis longtemps, par exemple la Communaut?europ閑nne, dont les r鑗les en la mati鑢e ont maintenant 閠?閠endues ?l'ensemble de l'Europe occidentale. Un autre exemple est celui de la Zone de libre-閏hange nord-am閞icaine (ALENA) o?les questions d'investissement s'ins鑢ent dans un accord commercial unique. Dans les pays en d関eloppement, des efforts sont 間alement d閜loy閟 dans le cadre d'un certain nombre d'arrangements commerciaux r間ionaux, par exemple l'ANASE et le MERCOSUR. De fa鏾n plus g閚閞ale, des travaux sont en cours dans le cadre de l'APEC et de la Zone de libre-閏hange des Am閞iques. Au niveau plurilat閞al, il y a le Trait?sur la Charte europ閑nne de l'閚ergie, adopt? par 41 pays et la Communaut?europ閑nne en d閏embre 1994, qui contient des engagements d閠aill閟 en mati鑢e d'investissement dans le secteur de l'閚ergie, ainsi que les n間ociations d閖?mentionn閑s concernant un accord multilat閞al sur les investissements, qui sont en cours ?l'OCDE. Enfin, au niveau multilat閞al, on compte deux conventions et un ensemble de lignes directrices qui ont 閠?n間oci閑s ?la Banque mondiale entre 1965 et 1992, ainsi qu'un instrument non contraignant de l'OIT et sept des Nations Unies.
Comme indiqu?plus haut dans la Partie V, la tendance ?une int間ration plus pouss閑 de l'investissement et du commerce dans l'閏onomie mondiale s'est aussi manifest閑 de plus en plus dans les travaux du GATT et se refl鑤e aujourd'hui dans ceux de l'OMC. En particulier, les Accords de l'OMC sur les services et la propri閠?intellectuelle, ainsi que l'Accord plurilat閞al sur les march閟 publics, 閠ablissent des r鑗les internationales concernant le traitement des soci閠閟 閠rang鑢es op閞ant sur le territoire d'un pays, question qui est au coeur de la politique concernant l'investissement. L'int間ration du commerce et de l'investissement est la plus 関idente dans l'Accord g閚閞al sur le commerce des services (AGCS), qui traite de l'approvisionnement du march?par des soci閠閟 閠rang鑢es au moyen d'une “pr閟ence commerciale” locale comme une forme de commerce de services. Certaines incitations que les gouvernements pourraient envisager d'offrir dans le cadre de leurs efforts destin閟 ?attirer l'IED sont vis閑s par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Pour ce qui est de l'avenir, l'AGCS et l'Accord sur les MIC pr関oient d'importants programmes implicites de travail concernant les questions li閑s ?l'investissement dans les domaines des services et des marchandises. Dans l'imm閐iat, dans le cadre des pr閜aratifs pour la R閡nion minist閞ielle de d閏embre ?Singapour, les Membres de l'OMC 閠udient actuellement des propositions relatives aux travaux futurs de l'OMC sur ces questions.
Il existe un ample lien institutionnel - non seulement entre l'IED et le commerce, mais entre l'investissement en g閚閞al et le commerce - qui tient au fait que les r鑗les et proc閐ures de l'OMC ont pour fonction premi鑢e de r閐uire l'incertitude qui entoure les transactions 閏onomiques transfronti鑢es. De cette mani鑢e, ces r鑗les et proc閐ures, ainsi que la r閐uction des obstacles au commerce, favorisent l'investissement li?au commerce sur le plan int閞ieur et ?l'閠ranger et apportent les avantages qui d閏oulent d'une sp閏ialisation internationale accrue. Certes, une partie des avantages de la lib閞alisation du commerce se mat閞ialise par le biais d'une baisse des prix ?la consommation mais, pour que les ressources d'un pays soient utilis閑s avec le maximum d'efficacit? il faut qu'une partie de la main-d'oeuvre, du capital et des terres qui existent passe des moins productives au plus productives des utilisations et que les augmentations futures de ces ressources soient affect閑s aux utilisations les plus productives. Ceci exige de nouveaux investissements.
Il ne suffit pas que les obstacles au commerce soient r閐uits. Les investisseurs nationaux et 閠rangers chez qui la comp閠itivit?internationale figure parmi leurs pr閛ccupations et qui constituent certainement une majorit?croissante ?mesure que progresse la mondialisation, attachent du prix ?la s閏urit?de l'acc鑣 futur aux march閟 telle que celle qu'offrent les r鑗les et disciplines de l'OMC. Comme les avantages que l'OMC apportent ? l'閏onomie mondiale tiennent principalement ?l'influence qu'elle exerce sur les d閏isions en mati鑢e d'investissements, il n'est pas exag閞?de dire que l'investissement est au coeur de ses travaux.
4) Probl鑝es de politiques internationale
L'une des caract閞istiques les plus marquantes de l'関olution actuelle des r鑗les en mati鑢e d'investissement est la diversit?des approches et des principes juridiques de base. Dans bien des cas, les parties sont parties simultan閙ent ?des accords bilat閞aux, r間ionaux, plurilat閞aux et multilat閞aux. Ces accords peuvent 阾re contraignants ou non, comporter ou non des engagements imm閐iats et des dispositions sur le comportement des soci閠閟, 阾re fond閟 sur des approches “descendantes” ou “ascendantes” et entrer ou non dans le cadre d'accords de commerce plus larges. Comme indiqu?plus haut, cette diversit?des approches pose d'importants probl鑝es de coh閞ence des politiques, mais elle refl鑤e aussi la vari閠?des moyens par lesquels les pays participants ont r閡ssi ?閠ablir un 閝uilibre des avantages mutuels sur le plan normatif dans ce domaine.
L'analyse que contient le pr閟ent chapitre a montr?essentiellement qu'aussi bien au niveau des d閏isions d'affaires des entreprises qu'?celui de la politique nationale, r間ionale ou multilat閞ale, il est de plus en plus difficile de s閜arer les questions d'investissement des questions commerciales traditionnelles. De ce fait, la prolif閞ation des trait閟 et arrangements visant ?閠ablir des r鑗les internationales en mati鑢e d'investissement soul鑦e un grand nombre de probl鑝es.
La situation dans le domaine de l'investissement rappelle celle qui a exist?dans le domaine du commerce. Dans la seconde moiti?du XIXe si鑓le, le commerce a 閠?lib閞alis?en Europe au moyen d'un grand nombre de trait閟 bilat閞aux (pr鑣 de 80 en 1865 et bien plus de 100 en 1908) contenant des clauses de la nation la plus favoris閑 calqu閑s sur celles du Trait?Cobden-Chevalier de 1860 entre l'Angleterre et la France. Ce syst鑝e s'est effondr?et c'est en grande partie sans succ鑣 qu'on a tent?de lui redonner vie dans la deuxi鑝e moiti?des ann閑s 30. Au milieu des ann閑s 40, alors que des plans 閠aient 閘abor閟 en vue d'instaurer l'ordre 閏onomique international de l'apr鑣-guerre, les auteurs de la Charte de La Havane (et par la suite du GATT) ont vu clairement qu'un syst鑝e commercial stable, non discriminatoire et lib閞al pourrait 阾re mis sur pied beaucoup plus facilement au moyen d'un ensemble unique de r鑗les et de disciplines multilat閞ales juridiquement contraignantes que par la n間ociation de milliers d'accords de commerce bilat閞aux.
Il est rarement facile pour un gouvernement de renoncer ?une partie de la libert?d'action dont il dispose dans un domaine particulier de la politique. Or, les gouvernements ont 閠?convaincus des avantages qu'il y aurait ?le faire dans celui des politiques commerciales. Ce qu'ils ont abandonn?de libert?en mati鑢e de politique en acceptant les r鑗les et disciplines de l'OMC est largement compens?par la pr関isibilit?et la stabilit?accrues des politiques commerciales. Chaque pays profite de l'impulsion que cette renonciation ainsi que la lib閞alisation du commerce impriment au commerce et ? l'investissement li?au commerce.
Un grand nombre de ces m阭es consid閞ations sous-tendent les efforts visant ?閠ablir des r鑗les internationales concernant le traitement de l'IED. Tout comme une lib閞alisation du commerce qui ne serait pas consolid閑 aurait beaucoup moins d'utilit?que des r閐uctions consolid閑s des obstacles ?l'importation, une possibilit?de consolider des r鑗les lib閞alis閑s concernant l'IED renforcerait beaucoup leur cr閐ibilit?et leur int閞阾 aux yeux des investisseurs 閠rangers. Les politiques des autres pays en mati鑢e d'IED s'en trouveraient aussi plus pr関isibles, par exemple en ce qui concerne le recours ?des incitations dans la course ?l'IED. Une cr閐ibilit?accrue du r間ime de chaque pays en mati鑢e d'IED serait tout particuli鑢ement b閚閒ique pour les pays non membres de l'OCDE qui rivalisent avec les pays riches pour accueillir de l'IED.
Comme dans ces deux domaines les 関olutions 閏onomiques et la formulation des politiques sont de plus en plus indissociables, il n'est pas surprenant que bon nombre des probl鑝es actuels qui d閏oulent des interrelations entre commerce et IED aient un rapport avec la coh閞ence des politiques. Se pose en premier lieu le probl鑝e de la “coh閞ence des r鑗les” entre les accords et instruments concernant l'investissement ?diff閞ents niveaux, national, r間ional et multilat閞al. L'existence, dans le domaine de l'investissement, d'un grand nombre d'instruments juridiques et d'arrangements qui se recoupent cr閑 des risques de confusion, d'incertitude et de conflits juridiques, notamment dans les cas o?les accords en question proc鑔ent d'approches diff閞entes. A cet 間ard, se pose, en particulier, le probl鑝e de la coh閞ence entre les r鑗les en mati鑢e d'investissement et celles relatives au commerce - notamment celui de l'interaction de la multitude des accords et arrangements 関oqu閟 plus haut dans la Partie IV avec les r鑗les multilat閞ales et le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l'OMC.
Se pose aussi la question de la coh閞ence des efforts d閜loy閟 en vue de d関elopper encore la coop閞ation internationale dans les domaines du commerce et de l'investissement. De toute 関idence, la relation entre ces domaines de la politique devrait 阾re trait閑 de mani鑢e ?ne pas isoler les uns des autres des domaines qui sont en r閍lit?de plus en plus entrelac閟. L'absence de coh閞ence des r鑗les et des politiques constitue un danger pour la s閏urit?et la pr関isibilit? objectifs fondamentaux des accords en mati鑢e de commerce et d'investissement. L'investissement 閠ranger direct, comme le commerce, est particuli鑢ement sensible ?l'incertitude et ? l'instabilit? De fait, l'engagement ?long terme qu'une soci閠?qui investit prend en transf閞ant des ressources et en localisant des op閞ations commerciales dans un autre pays expose particuli鑢ement cette soci閠??un risque en ce qui concerne non seulement l'investissement lui-m阭e mais aussi les courants d'閏hanges dont d閜end la rentabilit?de cet investissement.
La question de la coh閞ence et celle de la discrimination et de la marginalisation sont li閑s. Exception faite de ce que pr関oit la clause NPF de l'AGCS, le r閟eau actuel des accords internationaux dans le domaine de l'investissement n'offre gu鑢e de protection contre une discrimination ?l'間ard des pays non participants. Des r鑗les v閞itablement multilat閞ales permettraient d'閘aborer et d'appliquer des engagements bilat閞aux et r間ionaux dans un cadre qui prot鑗e les int閞阾s des tierces parties. Une pr閛ccupation connexe est que les travaux actuels sur les questions li閑s ? l'investissement sont en g閚閞al ax閟 davantage sur les pays vers lesquels se dirigent d閖?d'importants flux d'investissement 閠rangers que sur ceux dont les besoins en la mati鑢e sont peut-阾re plus grands. Ces travaux ne pr関oient pas non plus toujours la participation effective ?la formulation de nouvelles r鑗les de tous ceux qui risquent d'阾re affect閟 par celles-ci.
Face ?ces liens 閏onomiques, institutionnels et juridiques croissants entre commerce et IED, les Membres de l'OMC se trouvent devant un choix fondamental en mati鑢e de politique: doivent-ils continuer ?envisager la question de l'IED comme ils l'ont fait jusqu'? pr閟ent, c'est-?dire sur le plan bilat閞al, r間ional et plurilat閞al, ainsi qu'occasionnellement dans les accords sectoriels et autres accords sp閏ifiques de l'OMC, ou doivent-ils s'efforcer d'int間rer ces arrangements dans un cadre d閠aill?et global qui reconnaisse les liens 閠roits qui existent entre commerce et investissement, qui assure la compatibilit?des r鑗les en mati鑢e d'investissement et de commerce, et surtout qui tienne compte de mani鑢e 閝uilibr閑 des int閞阾s de tous les Membres de l'OMC: pays d関elopp閟, pays en d関eloppement et pays les moins avanc閟. Seule une n間ociation multilat閞ale au sein de l'OMC, en temps opportun, peut offrir un cadre aussi global et 閝uilibr? La d閏ision des Membres aura une importante incidence sur l'efficacit?avec laquelle les maigres apports en capitaux et en technologie seront utilis閟 au cours de la prochaine d閏ennie et au-del? Elle aura aussi une incidence sur la vigueur, la coh閞ence et l'utilit?des efforts d閜loy閟 pour int間rer tous les pays en d関eloppement dans le syst鑝e commercial multilat閞al.
Bibliographie
Aitken, B., G. H. Hanson et A. E. Harrison (1994), “Spillovers, Foreign Investment, and Export Behavior”, NBER Working Paper No. 4967, 1-40 d閏embre.
Aitken, B. et A. Harrison (1991), “Are there Spillovers from Foreign Direct Investment? Evidence from Panel Data for Venezuela”, document ron閛typ? MIT et Banque mondiale.
Aitken, B., A. Harrison et R. E. Lipsey (1995), “Wages and Foreign Ownership: a Comparative Study of Mexico, Venezuela, and the United States”, Journal of International Economics, mai.
Ariff, M. (1989), “TRIMs: a North-South Divide or a Non-issue?”, World Economy 12(3): 347-60 septembre.
Asante, S. K. B. (1989), “The Concept of Good Corporate Citizen in International Business”, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 1-38.
Asian Agricultural Products LTD. (1991), “(AAPL) v. Republic of Sri Lanka”, I.L.M.: 30.
Baldwin, R. E. (1993), “Adapting the GATT to a More Regionalized World: A Political Economy Perspective”, dans Regional Integration and the Global Trading System, publi?sous la direction de K. Anderson et R. Blackhurst, Gen鑦e: Harvester Wheatsheaf.
Baldwin, R. E. (1995), "The Effect of Trade and Foreign Direct Investment on Employment and Relative Wages", NBER Working Paper No. 5037, 1-62 f関rier.
Banque mondiale (1995), Le monde du travail dans une 閏onomie sans fronti鑢es, Washington, D.C.: Banque mondiale.
Batra, R. (1994), “The Fallacy of Free Trade I”, Review of International Economics 2(1): 85-95.
Bhagwati, J. N. (1987), “VERS, Quid Pro Quo DFI et VIEs: Political Economy Theoretic Analyses”, International Economic Journal 1(1): 1-14.
Blomstr鰉, M. (1986), “Foreign Investment and Productive Efficiency: the Case of Mexico”, Journal of Industrial Economics 35(1): 97-110 septembre.
Blomstr鰉, M., A. Kokko et M. Zejan (1992), “Host Country Competition and Technology Transfer by Multinationals”, NBER Working Paper No. 4131, ao鹴.
Blomstr鰉, M., R. E. Lipsey et K. Kulchycky (1988), “U.S. and Swedish Direct Investment and Exports”, dans Trade Policy Issues and Empirical Analysis, publi?sous la direction de R. E. Baldwin; Chicago: University of Chicago Press.
Blomstr鰉, M., R. E. Lipsey, et M. Zejan (1992), “What Explains Developing Country Growth?”, NBER Working Paper No. 4132, ao鹴.
Blomstr鰉, M., R. E. Lipsey, et M. Zejan (1996), “Is Fixed Investment the Key to Economic Growth?”, Quarterly Journal of Economics 111(1): 269-76.
Blomstr鰉, M. et H. Persson (1983),“Foreign Investment, and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industry”, World Development 11(6): 493-501 juin.
Blomstr鰉, M., et E. N. Wolff (1994), “Multinational Corporations and Productivity Convergence in Mexico”, NBER Working Paper No. 1923.
Blonigen, B. A. et R. C. Feenstra (1996), “Protectionist Threats and Foreign Direct Investment”, NBER Working Paper No. 5475.
Borensztein, E., J. De Gregorio et J-W. Lee (1995), “How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth ?”, NBER Working Paper No. 5057.
Brainard, S. L. (1993a),“A Simple Theory of Multinational Corporations and Trade with a Trade-off Between Proximity and Concentration”, NBER Working Paper No. 4269, 1-40 f関rier.
Brainard, S. L. (1993b), “An Empirical Assessment of the Factor Proportions Explanation of Multinational Sales”, NBER Working Paper No. 4583, 1-32 d閏embre.
Brainard, S. L. (1993c), “An Empirical Assessment of the Proximity-Concentration Tradeoff Between Multinational Sales and Trade”, NBER Working Paper No. 4580.
Buckley, P. J. et M. C. Casson (1976), The Future of the Multinational Enterprise, Londres: MacMillan.
Calvo, G., L. Leiderman, et C. Reinhart (1996), "Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s", Journal of Economic Perspectives 10(2): 123-139.
Cantwell, J. A. (1989), Technological Innovation and Multinational Corporations, Oxford, Massachusetts: Blackwell.
Caves, R. E. (1974), “Multinational Firms, Competition, and Productivity in Host-Country Markets”, Economica 41(162): 176-93 mai.
Caves, R. E. (1982), Multinational Enterprises and Economic Analysis, Cambridge, Royaume-Uni: Cambridge University Press.
Caves, R. et R. Jones (1985), World Trade and Payments: An Introduction (4鑝e 閐ition), Boston: Little Brown.
Chan, S. (1995), Foreign Direct Investment in a Changing Global Political Economy, Londres: MacMillan.
Chen, E. (1994), Transnational Corporations and Technology Transfer to Developing Countries, United Nations Library on Transnational Corporations, Londres: Routledge.
CIRDI (1995), “Rapport annuel 1995”, Centre international pour le r鑗lement des diff閞ends relatifs aux investissements.
CNUCED (1993), Rapport sur l'investissement dans le monde 1993, New York et Gen鑦e: Nations Unies.
CNUCED (1994), Rapport sur l'investissement dans le monde 1994, New York et Gen鑦e: Nations Unies.
CNUCED (1995), Rapport sur l'investissement dans le monde 1995, New York et Gen鑦e: Nations Unies.
CNUCED (1996a), Incentives and Foreign Direct Investment, New York et Gen鑦e: Nations Unies.
CNUCED (1996b), “Niveau record des flux d'investissement 閠ranger en 1995: 325 milliards de dollars” (TAD/INF/2671), Communiqu?de presse de la CNUCED, 4 juin.
CNUCED (1996c), “Les instruments internationaux r間issant l'investissement 閠ranger direct” (TD/B/43/5), 1er ao鹴.
CNUCED (1996d, ?para顃re), “International Investment Instruments, a Compendium”, (DTCI/30) vol. 1 ?3.
CNUCED (1996e), Rapport sur l'investissement dans le monde 1996, New York et Gen鑦e: Nations Unies.
Curzon, G. (1965), Multilateral Commercial Diplomacy, Londres: Michael Joseph.
Dasgupta, S., A. Mody et S. Sarbajit (1996), Japanese Multinationals in Asia: Capabilities and Motivations, Washington D.C.: Banque mondiale.
Deloitte et Touche Tohmatsu International Consulting Group (1996), “1995 Foreign Direct Investment Trends of U.S. Multinationals and U.S. Manufacturers”, Institute for Manufacturing Research.
Dolzer, R. et M. Stevens (1995), Bilateral Investment Treaties, La Haye: Martinus Nijhoff Publishers.
Dunning, J. H. (1977), “Trade, Location of Economic Activity and MNE: A Search for an Eclectic Approach”, dans the International Allocation of Economic Activity, publi? sous la direction de B. Ohlin, P. O. Hesselborn et P. M. Wijkman, Londres: MacMillan.
Dunning, J. H. (1981), International Production and the Multinational Enterprise, Londres: George Allen and Unwin.
Dunning, J. H. (1986), “The Investment Development Cycle”, Weltwirtschafliches Archiv 122: 667-77.
Dunning, J. H. (1993a), Multinational Enterprises and the Global Economy, Wokingham, Royaume-Uni et Reading, MA: Addison Wesley.
Dunning, J. H. (1993b), The Globalization of Business, Londres et New York: Routledge.
Fatouros, A. A. (閐.) (1994), Transnational Corporations: The International Legal Framework.
Fatouros, A. A. (1996), “Towards an International Agreement on Foreign Direct Investment”, dans Towards Multilateral Investment Rules, Paris: OCDE.
Findlay, R. (1978), “Relative Backwardness, Direct Foreign Investment, and the Transfer of Technology: a Simple Dynamic Model”, Quarterly Journal of Economics 92(1): 1-16 f関rier.
FMI (1996), Balance of Payments Statistics, Cassette, juin.
Frank, R. H. et R. T. Freeman (1978), “The Distributional Consequences of Direct Foreign Investment”, dans Impact of International Trade and Investment on Employment, publi?sous la direction de W. G. Dewald; Direction des questions internationales en mati鑢e de travail, D閜artement du travail des Etats-Unis.
GATT (1955), Instruments de base et documents divers, Suppl閙ent n? 3.
Glickman, N. J. et D. P. Woodward (1989), The New Competitors: How Foreign Investors are Changing the U.S. Economy, New York: Basic books.
Globerman, S. (1979), “Foreign Direct Investment” and Spillover “Efficiency Benefits in Canadian Manufacturing Industries”, Revue canadienne d'閏onomies 12(1): 42-56 f関rier.
Graham, E. M. (1996a), Global Corporations and National Governments, Washington, D.C.: Institut d'閏onomie internationale.
Graham, E. M. (1996b), “Direct Investment and the Future Agenda of the World Trade Organization”, Conference Draft, 24 juin, Institut d'閏onomie internationale, Washington, D.C.
Graham, E. M. (1996c),“The (not wholly Satisfactory) State of the Theory of Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise”, Journal of International and Comparative Economics 20, 183-286.
Graham, E. M. (1996d), “On the Relationship Among Direct Investment and International Trade in the Manufacturing Sector: Empirical Results for the United States and Japan”, non publi?
Graham, E. M. et Krugman P. R. (1993),“The Surge in Foreign Direct Investment in the 1980s” dans Foreign Direct Investment, publi?sous la direction de K. A. Froot; Chicago: University of Chicago Press.
Graham, E. M. et Anzai N. T. (1994),“The Myth of a De Facto Asian Economic Bloc: Japan's Foreign Direct Investment in East Asia” The Columbia Journal of World Business 24(3): 7-20.
Haddad, M. et A. Harrison (1993), “Are there Dynamic Externalities from Foreign Direct Investment?”, dans TNCs, Market Structure, and Industrial Performance, publi? sous la direciton de R. Newfarmer et C. Frischtak; Londres: Routledge.
Halbach, A. J. (1989),“Multinational Enterprises and Subcontracting in the Third World: A Study of Inter-Industrial Linkages”, Working Paper No. 58 de l'Organisation internationale du travail, Gen鑦e.
Hill, H. (1990), “Foreign Direct Investment and East Asian Economic Development”, Asian-Pacific Economic Literature 4: 21-58.
Hindley, B. (1990), Foreign Direct Investment: The Effects of Rules of Origin, Discussion Paper No. 30, Londres: Royal Institute of International Affairs.
Hufbauer, G. C., D. Lakdawalla, et A. Malani (1994), “Determinants of Foreign Direct Investment and its Connection to Trade”, UNCTAD Review, 39-51.
Hummels, D. L. et R. M. Stern (1994),“Evolving Patterns of North American Merchandise Trade and Foreign Direct Investment, 1960-1990”, World Economy 17(1): 5-29 janvier.
Irwin, D. A. (1993), “Multilateral and Bilateral Trade Policies in the World Trading System: An Historical Perspective”, dans New Dimensions in Regional Integration, publi?sous la direction de J. de Melo et A. Panagariya, Cambridge: Cambridge University Press.
Khalil, M. I. (1992),“Treatment of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties”, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 339-83.
Kishoiyian, B. (1994),“The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law”, Northwestern Journal of International Law & Business, 327-75 .
Kline, J. M. (1993),“International Regulation of Transnational Business: Providing the Missing Leg of Global Investment Standards”, dans Transnational Corporations, Transnational Corps (U-N) 2: 153-64 f関rier.
Kojima, K. (1977), “Direct Foreign Investment Between Advanced Specialized Countries”, Hitotsubashi Journal of Economic 28: 1-18.
Kokko, A. (1992),“Foreign Direct Investment, Host Country Characteristics, and Spillovers”, Th鑣e de doctorat, EFI / Stockholm School of Economics, Stockholm.
Kokko, A. (1994),“Technology, Market Characteristics, and Spillovers”, Journal of Development Economics 43(2): 279-93 avril.
Kokko, A. et M. Blomstr鰉 (1995), “Politics to Encourage Inflows of Technology through Foreign Multinationals”, World Development, 23(3): 1-10.
Krueger, A. (1995), “Free Trade Agreements Versus Customs Unions”, NBER Working Paper No. 5080, 1-26 avril.
Krugman, P. et R. Z. Lawrence (1993), “Trade, Jobs, and Wages”, NBER Working Paper No. 4478, 1-18 septembre.
Lall, S. (1980), “Vertical Linkages: an Empirical Study”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 42: 203-06.
Lall, S. et S. Mohammad (1993), "Foreign Ownership and Export Performance in the Large Corporate Sector of India", dans Transnational Corporations and International Trade and Balance of Payments, publi?sous la direction de H. P. Gray; Londres: Routledge.
Landi, J. (1986), “The Sourcing Policies of MNEs: A Case Study of Nigeria”, Th鑣e de doctorat, Reading, Royaume-Uni: Universit?de Reading.
Laviec, J. P. (1985), Protection et Promotion des Investissements: Etude de Droit International Economique, Paris: Presse universitaire de France.
Lawrence, R. et M. Slaughter (1993), “Trade and U.S. Wages: Giant Sucking Sound or Small Hiccup”, Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics 1993.
Leamer, E. E. (1993), Wage Effects of a U.S.-Mexico Free Trade Agreement, Cambridge: MIT Press.
Leamer, E. E. (1994), “Trade, Wages and Revolving Door Ideas”, NBER Working Paper No. 4716.
Lim, L. Y. C. (1990), “Singapore”, dans Labour Standards and Development in the Global Economy, Direction des questions internationales en mati鑢e de travail, D閜artement du travail des Etats-Unis, Washington D.C.: Government Printing Office.
Lim, L. Y. C. et E. F. Pang (1977), “The Electronics Industry in Singapore: Structure, Technology, and Linkages”, Monograph Series No. 7, National University of Singapore Economic Research Press.
Lim, L. Y. C. et E. F. Pang (1982), “Vertical Linkages and Multinational Enterprises in Developing Countries”, World Development 10(7): 585-95 juillet.
Lipsey, R. E., M. Blomstr鰉 et I. B. Kravis (1990), “R and D by Multinational Firms and Host Country Exports”, dans Science and Technology Policy: Lessons for Developing Asia, publi?sous la direction de R. Evenson et G. Ramis, Boulder: Westview Press.
Lipsey, R. E. et M. Y. Weiss (1981), “Foreign Production and Exports in Manufacturing Industries”, Review of Economics and Statistics 63(4): 488-94 novembre.
Lipsey, R. E. et M. Y. Weiss (1984), “Foreign Production and Exports of Individual Firms”, Review of Economics and Statistics 66(2): 304-08 mai.
Low, P. et A. Subramanian (1995), “TRIMs in the Uruguay Round: An Unfinished Business?”, dans The Uruguay Round and the Developing Economies, publi?sous la direction de Martin et Winters; Document de travail n? 307 de la Banque mondiale, Washington, D.C..
MacDougall, G. D. A. (1960), “The Benefits and Costs of Private Investment from Abroad: A Theoretical Approach”, Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics 22(3): 189-211.
McDougall, R. et R. Tyers (1996), “Developing Country Expansion and Wages in Industrial Countries”, dans Global Trade Analysis: Modeling and Applications, publi? sous la direction de T. Hertel, Cambridge: Cambridge University Press.
Mansfield, E. (1987), “Transfer of Technology”, dans The New Palgrave Dictionary of Economics, publi?sous la direction de J. Eatwell, M. Milgate et P. Newman; Londres: MacMillan Press.
Mansfield, E. et A. Romeo (1980), “Technology Transfer to Overseas Subsidiaries by U.S.-Based Firms”, Quarterly Journal of Economics 95(4): 737-50 d閏embre.
Mansfield, E. et col. (1982), Technology Transfer, Productivity, and Economic Policy, New York: W.W. Norton.
Markusen, J. R. (1995), “The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade”, Journal of Economic Perspectives 9: 169-89.
Messerlin, P. A. (1995), “The Impact of Trade and Capital Movements on Labor: Evidence on the French Case”, Revue 閏onomique de l'OCDE n? 1, 89-124.
Muchlinski, P. T. (1995), Multinational Enterprises and the Law, Oxford, Royaume-Uni: Blackwell.
Mundell, R. (1957), “International Trade and Factor Mobility”, American Economic Review 67: 321-35.
Naujoks, P. et K-D. Schmidt (1995), “Foreign Direct Investment and Trade in Transition Countries: Tracing Links - A Sequel -”, Kiel Institute of World Economics Working Paper No. 704.
Nicolaides P. et S. Thomsen (1991), “Can Protectionism Explain Direct Investment”, Journal of Common Market Studies 29(6): 635-43 d閏embre.
OCDE (1996a), Annuaire des statistiques d'investissement direct international, Paris: OCDE.
OCDE (1996b), “Evolution r閏ente de l'investissement direct 閠ranger”, Tendances des march閟 des capitaux 64: 37-61 juin.
Ocran, T. M. (1987), “Bilateral Investment Protection Treaties: A Comparative Study”, New York School Journal of International Law and Comparative Law, 401-29.
Oman, C. (1994), Globalisation et r間ionalisation: Quels enjeux pour les pays en d関eloppement, Paris: OCDE.
OMC (1995a), Le commerce international: tendances et statistiques, Gen鑦e: OMC.
OMC (1995b), Le r間ionalisme et le syst鑝e commercial mondial, Gen鑦e: OMC.
OMC (1996), Examen des politiques commerciales: Costa Rica 1995, Gen鑦e: OMC.
OMC (?para顃re), Examen des politiques commerciales: Etats-Unis, Gen鑦e: OMC.
ONU (1996), Bulletin mensuel de statistique, juillet.
Parra, A. R. (1994), “A Comparison of the NAFTA Investment Chapter with Other International Investment Instruments”, News from ICSID, 3-6 hiver.
Peters, P. (1991), “Dispute Settlement Arrangements in Investment Treaties”, Netherlands Yearbook of International Law, 91-161.
Pfaffermayr, M. (1994), “Foreign Direct Investment and Exports: A Time Series Approach”, Applied Economics 26(4): 337-51 avril.
Rousslang, D. J. (1978), “Comment on Frank-Freeman Paper”, dans Impact of International Trade and Investment on Employment, publi?sous la direction de W. G. Dewald; Direction des questions internationales en mati鑢e de travail, D閜artement du travail des Etats-Unis.
Sachs, J. D. et H. J. Schatz (1994), “Trade and Jobs in U.S. Manufacturing”, Brookings Papers on Economic Activity (?para顃re).
Schreibner, J. S. (1970), U.S. Corporate Investment in Taiwan, New York: Cambridge University Press.
Sornarajah, M. (1994), The International Law on Foreign Investment, Cambridge: Cambridge University Press.
Sun, H. (1996), “Macroeconomic Impact of Direct Foreign Investment in China 1979-93”, The University of Sydney Working Papers in Economics No. 232, juin.
Swedenborg, B. (1979), The Multinational Operations of Swedish Firms: An Analysis of Determinants and Effects, Stockholm: Industrial Institute for Economic and Social Research.
Swedenborg, B. (1982), Swedish Industry Abroad, An Analysis of Driving Forces and Effects, Stockholm: Industrial Institute for Economic and Social Research.
Todaro, M. P. (1994), Economic Development (5鑝e 閐ition), New York: Longman.
Vernon, R. (1966), “International Investment and International Trade in the Product Cycle”, Quarterly Journal of Economics 83: 190-207.
Waelde, T. W. (1995), “International Investment under the 1994 Energy Charter Treaty - Legal, Negotiating and Policy Implications for International Investors Within Western and Commonwealth of Independent States/Eastern European Countries”, Journal of World Trade, 5-73 octobre
Wei, S. (1996), “Foreign Direct Investment in China: Sources and Consequences”, dans Financial Deregulation and Integration in East Asia, publi?sous la direction de T. Ito et A. O. Krueger, University of Chicago Press pour NBER, ?para顃re.
Wells, L. T. (1992), “Conflict or Indifference: US Multinationals in a World of Regional Trading Blocks”, OECD Research Programmes on Globalisation and Regionalisation, Technical Paper No. 57, Paris: OCDE.
Wells, L. T. (1993), “Mobile Exporters: New Foreign Investors in East Asia”, dans Foreign Direct Investment, publi?sous la direction de K. A. Froot; Chicago: University of Chicago Press.
Wong, K. (1988), “International Factor Mobility and the Volume of Trade”, dans Empirical Methods for International Trade, publi?sous la direction de R. Feenstra; Cambridge: MIT Press.
Wong, K. (1995), International Trade in Goods and Factor Mobility, Cambridge: MIT Press.
Wood, A. (1994), North-South Trade, Employment, and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World, Oxford: Clarendon Press.
Zejan, M. C. (1989), “Intra-Firm Trade and Swedish Multinationals”, Weltwirtschaftliches-Archiv, 125(4): 814-33.